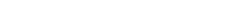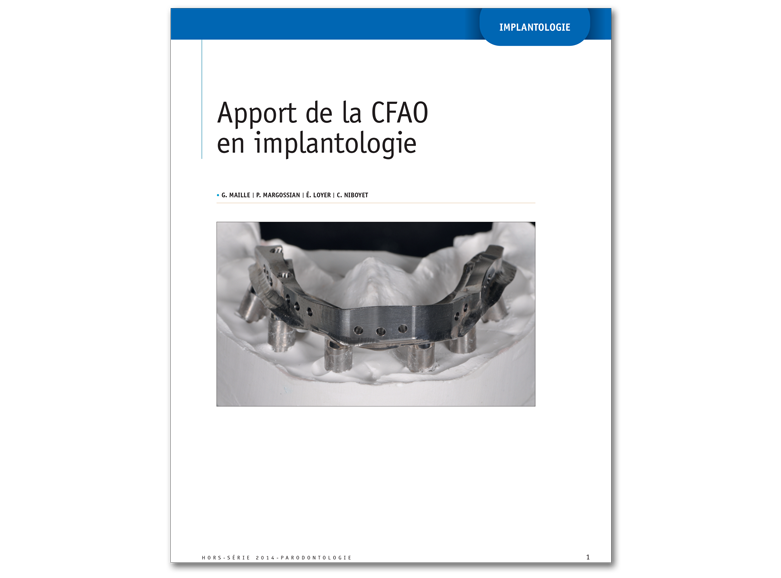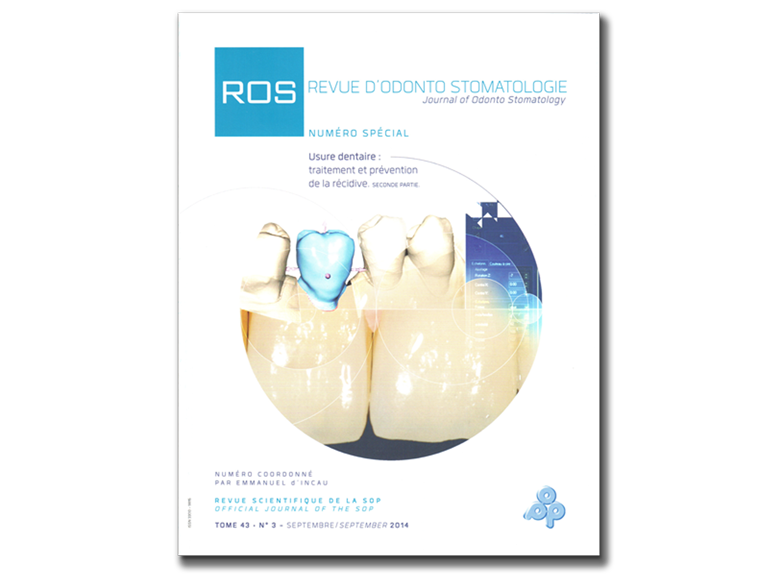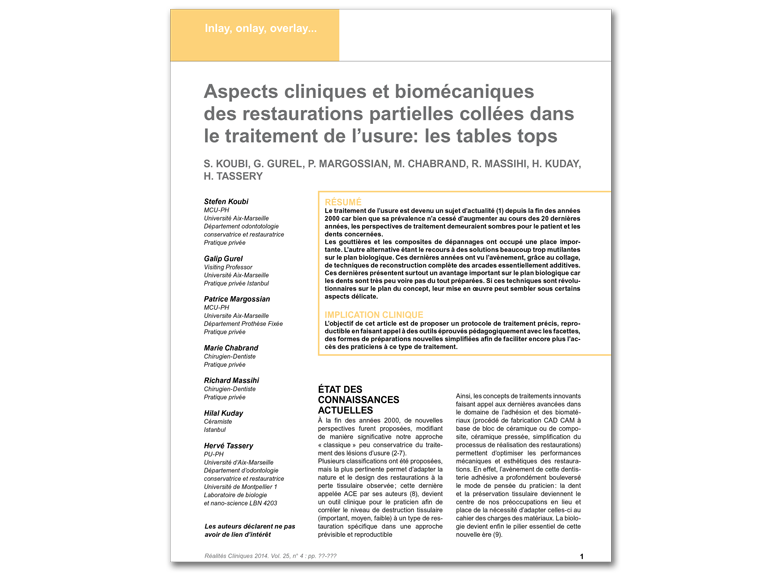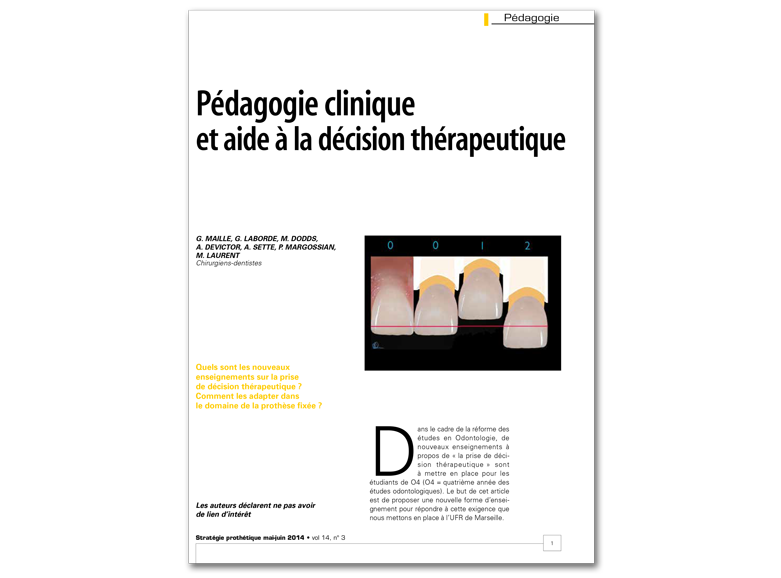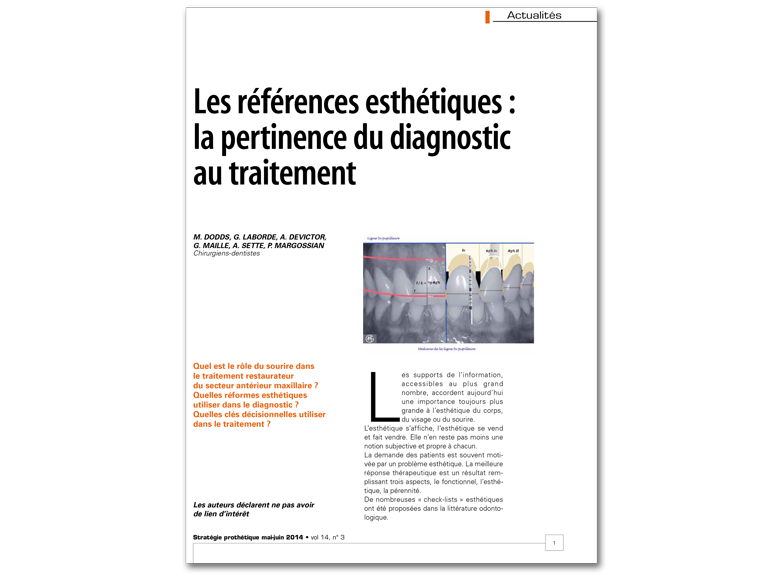Margossian P., Laurent M., Tosello A., Koubi S., Laborde G.
ALPHA OMEGA NEWS – N° 172 – avril 2015
Extraction-implantation-mise en fonction immédiate
Le savoir-faire prothétique au service de la chirurgie
L’implantologie moderne ne peut dissocier le geste chirurgical de la réflexion prothétique. Le projet prothétique pré-chirurgical est la seule garantie qui permet d’avoir des positions et des axes implantaires compatibles avec la future prothèse d’usage. Les protocoles d’Extraction-Implantation et Mise en Fonction Immédiate (EIMFI) limitent le nombre de chirurgies et permettent au patient de bénéficier d’une denture fixe pendant toute la durée du traitement, ce qui représente un confort et un avantage psychologique évidents.
Phase pré-chirurgicale
Dans les situations d’EIMFI, il est impossible d’essayer le projet prothétique de par la présence des dents sur l’arcade. La proposition thérapeutique sera donc simulée uniquement sur l’articulateur. La précision de l’analyse pré-chirurgicale tant esthétique que fonctionnelle prend ici tout son sens.
L’analyse fonctionnelle consiste à monter les modèles des arcades via un arc facial sur l’articulateur (Artex, Amann Girrbach). Dans les situations de réhabilitation total, la position de référence occlusale est toujours la relation centrée. En effet, les patients candidats à ce type de traitement ont la plupart du temps des dents en malposition du fait des migrations dentaires parodontales (Fig. 1 à 3). Cette OIM non fonctionnelle est très souvent associée à des troubles musculaires, voire articulaires. La construction d’un projet prothétique en relation centrée va permette de recentrer l’articulation dans son enveloppe fonctionnelle et de réorganiser la musculature autour de cette position grâce au centrage, calage et guidage dentaires. Dans le même temps une analyse précise de la dimension verticale d’occlusion, de la classe d’angle squelettique, de l’hyper ou hypo-divergence, permettra d’orienter un positionnement prothétique idéal. (Fig. 4 et 5)
Le deuxième versant de l’analyse pré-chirurgicale concerne bien entendu l’esthétique. Pour les mêmes raisons de migration dentaire, la position des dents sur l’arcade ne sert quasiment jamais de référence. Il va donc falloir ré-imaginer un nouveau projet en tenant compte des références faciales du patient. Cette réflexion est faite sur la base des analyses Fig.graphiques du visage du patient et par l’utilisation systématique du système Ditramax. (Fig. 6 et 7) Cet outil va permettre de marquer directement sur le modèle de travail maxillaire, les axes de référence esthétique faciaux (ligne Bi-pupillaire, Plan sagittal médian, Plan de Camper). Le prothésiste aura ainsi un guidage visuel direct sur le modèle, lui permettant de positionner les dents sur l’arcade tout en garantissant l’intégration du sourire dans l’harmonie faciale. Lorsque les deux arcades ne sont pas concernées par la réhabilitation, il est très fréquent d’avoir à réaliser des coronoplasties sur l’arcade opposée, afin d’idéaliser le plan d’occlusion (Fig. 8, 9 et 10). C’est à ce stade et en fonction du niveau de résorption et du positionnement idéal de la DVO, que se décide le choix prothétique de réhabilitation avec fausse gencive ou à émergence naturelle. Bien entendu, ce choix a des répercussions sur le geste chirurgical, tant au niveau du positionnement 3D des implants que pour les aménagements osseux qu’il conviendra de réaliser.
Phase chirurgicale
Ce projet sera dupliqué et transformé en guide chirurgical afin de contrôler avec précision le positionnement et les axes implantaires (Fig. 11 et 12). Dans le cadre d’ EIMFI maxillaire à émergence naturelle (sans fausse gencive), toute erreur de positionnement même minime (1 mm) génèrera des conséquences prothétiques esthétiques et fonctionnelles aussi graves qu’irrattrapables. Après les extractions et l’élévation d’un lambeau muco-périosté, le guide va permettre entre autres de positionner le plan osseux dans une situation horizontale parallèle au plan dentaire. Les implants (Nobel Biocare) seront alors positionnés avec un contrôle de tout instant sur la situation de leur point d’impact sur la crête, de leur axe et enfin de leur enfouissement. Une fois tous les implants et leurs piliers respectifs en place, les comblements osseux et diverses plasties gingivales seront réalisés avant la mise en place des sutures (Fig. 13).
Phase de temporisation
A l’issue de la chirurgie, une empreinte de situation des implants va être réalisée. Un duplicata du projet prothétique en résine transparente va permettre l’enregistrement de la relation inter- arcade par une manipulation en relation centrée du patient. Le
repositionnement du modèle de travail est permis grâce au rebasage de l’intrados de la maquette d’enregistrement avec un silicone à prise rapide dans une occlusion de relation centrée. Le modèle sera ainsi remonté sur l’articulateur grâce à cet enregistrement et transmis au laboratoire de prothèse. Le prothésiste va se servir de clés pour positionner les dents dans la même situation que celle du projet initial. Un renfort métallique sera ajusté et inséré juste avant la mise en place de la résine et sa cuisson. Le prothésiste contrôlera la passivité de la prothèse transitoire avant sa livraison. Environ 5h après la prise d’empreinte, la prothèse transitoire va être vissée sur les piliers MUA (Nobel Biocare) et l’occlusion va être scrupuleusement contrôlée. Il est primordial dans ce type de thérapeutique de retrouver en bouche exactement les mêmes engrènements dentaires que ceux organisés sur l’articulateur. Les recours à des meulages importants dûs à des erreurs d’enregistrement de la relation inter-arcade auront pour conséquence une perte obligatoire de l’efficience du calage dentaire. Celle-ci augmentera malheureusement le risque para-fonctionnel du patient avec les conséquences implantaires que cela représente (Fig. 14).
Phase de cicatrisation et maturation gingivale et osseuse
Les protocoles d’EIMFI ne changent rien à la cinétique de cicatrisation des implants. Il est donc important que le patient respecte durant plusieurs mois des habitudes alimentaires prudentes et contrôle ses attitudes para-fonctionnelles. Des examens cliniques seront en outre réalisés à intervalles réguliers, afin de réévaluer le contrôle de plaque et l’occlusion du patient (Fig. 15).
Phase de réalisation de la prothèse d’usage
A 6 mois post-opératoire les implants sont ostéo-intégrés et l’environnement tissulaire péri- implantaire a atteint sa maturation (Fig. 16). Dans les situations d’émergence naturelle, la mise en place de la prothèse provisoire le jour de la pose des implants a permis d’obtenir un modelage gingival harmonieux. Une empreinte de la situation implantaire est alors prise. Le plâtre est ici le matériau de choix de par sa stabilité dimensionnelle et sa rigidité après prise.
L’utilisation de l’articulateur va permettre de simuler le plus fidèlement possible la cinématique de l’appareil mandicateur. L’objectif est ici purement fonctionnel afin de garantir la parfaite intégration occlusale des restaurations et surtout le déplacement correct des arcades lors de la mastication, de la phonation et de la déglutition. Le positionnement du modèle maxillaire est réalisé grâce à l’utilisation d’un arc facial (Artex, Amann Girrbach). Pour plus de fiabilité et afin que l’enregistrement se fasse sur un support fixe, 4 transferts porte-empreintes fermés sont vissés sur 4 implants de l’arcade maxillaire uniformément répartis sur l’arcade. Il est aussi envisageable de faire cette manoeuvre directement sur la prothèse transitoire de mise en fonction immédiate, mais cela oblige à faire le montage sur articulateur au cabinet. Le modèle maxillaire est ainsi positionné par rapport au plan axial-orbitaire du patient.
Les maquettes d’occlusion maxillaire et mandibulaire sont ensuite ajustées pour enregistrer la relation inter-arcade à la bonne dimension verticale d’occlusion. La relation centrée est ici prise comme position de référence afin de pouvoir réorganiser la musculature autour d’une relation articulaire centrée et fonctionnelle. Le modèle mandibulaire est donc monté grâce à cet enregistrement en antagoniste de l’arcade maxillaire sur l’articulateur. Il est là aussi possible d’utiliser les prothèse transitoires de mise en fonction immédiate si l’occlusion de relation centrée et la dimension verticale d’occlusion sont correctes. Cela nécessite là encore l’immobilisation des prothèses durant le temps du montage sur l’articulateur. L’utilisation du système Artex (Amann Girrbach) permet d’avoir un articulateur au cabinet qui soit parfaitement calibré avec celui du laboratoire afin de n’avoir que les modèles à expédier.
L’utilisation du système Ditramax va permettre l’enregistrement des axes esthétiques faciaux et leur retranscription directe sur le modèle de travail maxillaire. Ainsi deux axes, un vertical et un horizontal, seront marqués sur le socle en plâtre du modèle maxillaire. L’axe vertical représente le plan sagittal médian et l’axe horizontal est quant à lui parallèle à la ligne bi-pupillaire en vue frontale et parallèle au plan de Camper dans la vue latérale. Ces marquages au plus près de la zone de travail vont guider le prothésiste lors du positionnement des dents. La ligne incisive aura ainsi de manière prédictible une orientation parallèle à la ligne bi-pupillaire et l’axe inter-incisif suivra une orientation parallèle au plan sagittal médian. Le marquage du plan de Camper donnera quant à lui la bonne indication sur l’orientation à donner au plan d’occlusion. L’ensemble de ces éléments associés à la transmission du modèle des restauration transitoire, rationalisent le positionnement des dents du point de vue esthétique et fonctionnel. (Fig. 17)
Dans les situations d’émergence naturelle, la prothèse est de type céramo-métallique ou céramo-céramique. L’armature sera réalisée en technique CFAO par l’usinage de bloc titane, de chrome-cobalt ou de zircone. Lorsque les restaurations transitoires donnent satisfaction, le modèle des provisoires est utilisé pour guider la réalisation de l’armature. Une technique de double scannage va permettre de dessiner l’armature tout en ayant les formes de contour externe sur la même vue. Cela facilite grandement l’obtention d’un design permettant un parfait soutien du matériau cosmétique. La prothèse sera alors transvissée sur l’arcade et les puits d’accès au vis refermés. L’occlusion est ajustée et re-contrôlée à 15 jours. Pour toutes les grandes réhabilitations dentaires ou implantaires, une gouttière de relaxation nocturne est systématiquement remise au patient. (Fig. 18, 19)
Phase de maintenance
La maintenance parodontale de ces patients est bisannuelle :
une fois chez le praticien ayant réalisé la prothèse, une autre au sein de la structure chirurgicale. Le démontage est réalisé 1 fois par an. Après un nettoyage des piliers implantaires avec des inserts en silicone spécifique, une re-motivation aux techniques de brossage est réalisée. De même qu’un contrôle de l’occlusion et la ré-évaluation des habitudes comportementales parafonctionnelles iatrogènes.
Conclusion
Les protocoles d’EIMFI chez l’édenté total apportent de nombreux bénéfices par rapport aux thérapeutiques implantaires conventionnelles. En limitant le nombre de chirurgies et grâce à des restaurations fixes tout au long du traitement, le patient bénéficie d’un confort immédiat à la fois physique et psychologique.
La réussite d’une reconstruction supra-implantaire totale est avant tout basée sur la prise en considération des impératifs chirurgicaux et prothétiques de la situation clinique. Ainsi, depuis le projet thérapeutique jusqu’à la prothèse d’usage, le cahier des charges biologique, fonctionnel et esthétique est scrupuleusement respecté.
G. MAILLE, P. MARGOSSIAN, É. LOYER, C. NIBOYET,
Hors – Série 2014 – Paradontologie
Au cours des cinq dernières décennies, l’apparition des implants et l’évolution de l’adhésion ont modifié l’approche traditionnelle de la dentisterie restauratrice, en améliorant la gestion des risques prothétiques et en développant le concept de moindre mutilation tissulaire. Ces changements de paradigme s’accompagnent d’une véritable révolution numérique dans nos cabinets et laboratoires : de l’acquisition à la fabrication, en passant par des logiciels de conception assistée de plus en plus sophistiqués, la part des techniques artisanales ne cesse de diminuer au profit d’un flux numérique permettant d’obtenir des infrastructures d’un même niveau de qualité avec un gain de temps certain, une grande fiabilité et une excellente reproductibilité [1]. La CFAO offre en effet une précision de joint dento-prothétique de 60 à 70 μm et les systèmes de fabrication permettent de travailler plusieurs matériaux, tels que le titane, la zircone, les alliages de métaux, les résines, les composites…, par technique soustractive ou additive [2-4]. Les logiciels de conception performants permettent de facilement concevoir des infrastructures parfaitement homothétiques : ainsi, la partie cosmétique, continue et uniforme, voit sa résistance être renforcée. L’implantologie bénéficie pleinement de ces apports de la CFAO en ce qui concerne :
• la réalisation de piliers et d’armature pour les reconstitutions à deux niveaux ;
• la réalisation de reconstitution directe implant ;
• la réalisation de piliers anatomiques dont le profil d’émergence respectera parfaitement le berceau gingival préalablement organisé ;
• les reconstitutions plurales, en permettant une précision absolue et une excellente passivité des armatures.
Deux situations cliniques vont nous permettre de mettre en évidence ces avancées techniques au profit de l’implantologie orale.
COIFFE IMPLANTAIRE SCELLÉE
La première situation clinique présente une restauration par coiffe céramique unitaire sur armature zircone scellée sur 35, dent naturelle, et 36 scellée sur implant (fig. 1). Après la prise d’empreinte conventionnelle avec transfert et coulée du modèle, celui-ci est numérisé une première fois afin de réaliser le pilier prothétique de 36. L’axe de l’implant est matérialisé et le pilier est conçu à l’écran de manière à s’inscrire dans le couloir dentaire, tout en respectant les concepts mécaniques de rétention, stabilisation et insertion ; la modélisation des limites cervicales peut être optimisée [5] afin d’assurer un soutien idéal de la muqueuse périimplantaire
(fig. 2 à 4).
Une fois usiné, le pilier est replacé sur le modèle de travail et une nouvelle numérisation est effectuée afin de réaliser les infrastructures des coiffes unitaires (fig. 5). Après matérialisation de l’espacement virtuel, le technicien de laboratoire va concevoir les chapes à partir d’un coping puis travailler les formes de contour afin de les rendre homothétiques à l’enveloppe finale de la reconstitution prothétique. Cette étape, primordiale, garantit le soutien du matériau cosmétique et, ainsi, sa pérennité (fig. 6 à 8). En fonction du logiciel ou de la technique choisie, il est également possible de réaliser cette réduction homothétique [6-7] :
• soit à partir d’un élément issu d’une base de données ;
• soit à partir du scannage du projet prothétique.
Des alertes logicielles permettent de ne pas dépasser les épaisseurs minimales relatives au type de matériau utilisé et de respecter les sections minimales des connexions lors de la réalisation d’éléments pluraux [8].
Après usinage et frittage, les chapes sont essayées cliniquement afin de valider leur adaptation.
Elles sont repositionnées sur le modèle de travail (fig. 9) et le céramiste peut alors procéder à la stratification du cosmétique pour obtenir les restaurations finales (fig. 10).
ÉDENTEMENT TOTAL MANDIBULAIRE
Pour cette seconde situation clinique (fig. 11), le patient a bénéficié d’une mise en charge immédiate sur 6 implants dotés de piliers droits par prothèse transvissée (MUA Nobel Biocare). À 4 mois postopératoires, la conception de la prothèse d’usage peut débuter et la réalisation de l’armature en titane par un procédé de CFAO apporte différents avantages :
• l’usinage du bloc de titane permet d’obtenir des infrastructures avec une adaptation et une passivité parfaites qu’il est difficile d’obtenir avec les techniques conventionnelles de coulée en alliage précieux (déformation sur les longues portées, nécessité de soudures) associées à une réduction des coûts et du poids [9] ;
• la modélisation de l’infrastructure grâce au logiciel de CAO permet, par la technique du double scannage, une parfaite corrélation entre le projet thérapeutique et l’armature, assurant ainsi le soutien de la partie cosmétique et une adaptation de la forme (en T ou L) de la barre au couloir prothétique, au profil d’émergence des implants et aux tissus de soutiens.
Ainsi, après l’empreinte de la situation des piliers réalisée au plâtre [10] (fig. 12), les modèles sont montés sur articulateur en utilisant la prothèse transitoire dont les caractéristiques fonctionnelles ont été validées par le patient durant la période de mise en charge : le montage esthétique peut alors être réalisé (fig. 13 et 14).
Grâce à la numérisation du modèle à laquelle est superposée celle du projet prothétique, le technicien de laboratoire va élaborer virtuellement l’armature qui répond au mieux aux exigences mécaniques et fonctionnelles de la reconstruction : épaisseur et forme du matériau, soutien du cosmétique (fig. 15 à 17). L’armature virtuelle ainsi validée (fig. 18 et 19) est usinée (fig. 20 à 22), puis validée cliniquement : la passivité de l’armature est ainsi objectivée par un serrage opposé et un contrôle radiologique (fig. 23 et 24). Le projet thérapeutique peut alors être transféré et polymérisé, puis mis en bouche (fig. 25 et 26).
CONCLUSION
De la réalisation simple d’un pilier prothétique à celle plus complexe d’une barre usinée, la CFAO apporte un confort indéniable aux réalisations implantaires : précision, reproductibilité, coût, gain de temps, diversité des matériaux sont autant de facteurs favorisant l’accès à ces techniques pour le plus grand nombre. Il ne faut néanmoins pas oublier que ces nouvelles techniques restent opérateur dépendantes et nécessitent une grande rigueur dans les protocoles cliniques et leur mise en oeuvre. Il faut garder à l’esprit qu’elles requièrent le savoir-faire et la compétence d’une équipe de cliniciens et de technicien formés à l’utilisation des logiciels informatiques et à la rigueur de l’élaboration prothétique, afin de pouvoir garantir l’intégration fonctionnelle, esthétique et biologique des restaurations.
Patrice Margossian, Chirurgien dentiste à Marseille, est spécialisé dans l’Implantologie dentaire, ainsi que les aménagements osseux et tissulaires (greffes osseuses intra sinusiennes, greffes d’apposition, greffes de gencives) parfois indispensables avant la pose des implants dentaires.Koubi. S., Galip G., Massihi R., Margossian P., Tassery H.
L’INFORMATION DENTAIRE n° 31 – 17 septembre 2014
L’usure devient réelle pour les patients lorsqu’ils sourient (sourire peu visible, dents trop courtes), qu’ils mangent et se plaignent de douleurs ou de bourrages alimentaires. Ces motifs de consultation sont de plus en plus fréquents dans nos cabinets. Le traitement de l’usure est devenu un challenge pour le praticien, car il représente, dans le contexte de la dentisterie contemporaine, un défi majeur sur les plans esthétique, biologique et fonctionnel. La conjonction d’un nouveau sourire et d’une nouvelle occlusion augmente la difficulté. En effet, dans les deux cas, le recours à une approche a minima doit être préconisé en raison de ses avantages esthétiques, biologiques et biomécaniques. Si ces techniques se démocratisent petit à petit au sein des structures dentaires, leur mise en oeuvre demeure difficile. La construction d’un projet esthétique et fonctionnel représente un défi quotidien et sa bonne intrégration en bouche tracera la route vers le succès. L’objectif de cet article est de mettre en lumière le rôle capital de ce projet, qu’il soit esthétique et/ou fonctionnel. Une fois validé, il servira de GPS au praticien.
Trois grands chapitres vont être développés ici afin d’intégrer ces concepts modernes à la vie quotidienne du cabinet :
– les prérequis à la réalisation d’un projet esthétique et fonctionnel, c’est-à-dire les éléments et les informations à recueillir pour commencer la reconstruction esthétique et fonctionnelle ;
– la réalisation en bouche du projet et ses différents rôles ;
– la fabrication et l’assemblage des restaurations en guise de conclusion.
Les prérequis : analyse esthétique et établissement de la nouvelle DVO
L’analyse esthétique
Les objectifs de la dentisterie esthétique sont de créer des dents aux proportions agréables et un agencement dentaire en harmonie avec la gencive, les lèvres et le visage du patient. Le visage peut s’analyser au travers de lignes de référence horizontales et verticales. La ligne bi-pupillaire représente la ligne de référence horizontale majeure par rapport aux autres lignes horizontales : ophriaques et intercommissurales. Le plan sagittal médian représente quant à lui l’axe de symétrie vertical du visage et forme avec la référence horizontale un T dont le centrage et la perpendicularité favoriseront grandement la perception d’une harmonie faciale. Dans un visage harmonieux, le plan incisif est parallèle à la ligne bi-pupillaire et le milieu interincisif est perpendiculaire à cette ligne. L’erreur la plus fréquemment rencontrée en dentisterie esthétique est le non-alignement du plan incisif par rapport aux références horizontales et verticales [4]. Cela est en partie dû à la difficulté de communiquer au laboratoire les références esthétiques du visage.
L’utilisation d’un nouvel instrument, le Ditramax® [1, 2, 3] permet d’enregistrer les lignes de référence esthétique de la face et de les transférer directement sur le modèle en plâtre servant à la réalisation des prothèses. Cet outil peut s’utiliser aussi bien durant la phase de diagnostic, pour la réalisation d’un projet thérapeutique, que lors de la réalisation de dents provisoires, ou lors de la phase finale de réalisation des prothèses d’usage. Le prothésiste aura ainsi la sensation de travailler devant le patient et pourra optimiser l’intégration esthétique des prothèses dès la première réalisation. Cette procédure évite de multiplier les essayages cliniques chronophages servant à corriger les formes et les axes des dents prothétiques en céramique.
La communication des références esthétiques de la face au laboratoire de prothèse est un élément fondamental qui conditionne la réussite d’un cas esthétique. Il est primordial, pour toutes réhabilitations antérieures, de passer par une phase de diagnostic qui a pour but de relever les différentes digressions esthétiques du sourire. L’analyse des photographies faciales et buccales lors du sourire et du rire permet d’orienter le traitement, en indiquant par exemple l’éventuel recours aux thérapeutiques associées comme la chirurgie parodontale ou l’orthodontie.
Une fois les préparations réalisées et l’empreinte prise, le Ditramax® permet l’enregistrement et le transfert au laboratoire des plans de références esthétiques.
La photographie est une aide importante dans la communication avec le laboratoire. Elle renseigne en effet le céramiste sur la personnalité du patient (âge, sexe, type facial, couleur de peau…). Il est important, avant tout envoi au laboratoire, de réorienter et recadrer les photos de façon à ce que le plan sagittal médian du visage soit strictement vertical afin de ne pas tromper la perception optique du sourire. Toutefois, même si la photo des restaurations provisoires ou de l’essayage permet de voir l’inclinaison du plan incisif par rapport à la référence horizontale, il est impossible pour le prothésiste de la quantifier et donc de faire les ajustements adéquats.
La restauration prothétique des dents antérieures maxillaires représente, de par leur situation, un défi esthétique majeur. Le diagnostic esthétique est basé sur la mise en relation des dents avec la gencive, les lèvres et le visage du patient. Le système Ditramax® permet de projeter aisément la ligne bi-pupillaire – axe horizontal de référence esthétique – sur la zone buccale afin de relever les digressions esthétiques majeures et de pouvoir proposer un projet thérapeutique visant à retrouver une composition dentaire et gingivale harmonieuse d’apparence naturelle. En plus du diagnostic, la transmission au laboratoire de l’ensemble de ces plans de référence représente une réelle avancée technique et permet une réduction importante des erreurs d’agencement des dents.
Une projection fiable et reproductible du plan de Camper, de la ligne bi-pupillaire et du plan sagittal médian sur le modèle, au plus près de la zone de travail, facilite grandement le travail du prothésiste et assure ainsi une meilleure prévisibilité du résultat esthétique.
Le protocole photographique vient s’ajouter dans l’arsenal des outils de communication avec le laboratoire ; c’est pourquoi certains clichés sont primordiaux tels que :
– les photos du visage sourire forcé ;
– les photos de l’étage inférieur sourire forcé face et ¾ profils droit et gauche afin d’analyser la ligne du sourire ;
– les photos intrabuccales des 10 dents antérieures afin de disposer d’une vision globale.
Ces informations collectées, le prothésiste va pouvoir élaborer le wax up dans les meilleures conditions.
La nouvelle DVO dans les réhabilitations de dentures usées
Pourquoi l’usure est-elle devenue un sujet à la mode ? « L’usure est au carrefour des doléances classiques des patients, qu’elles soient esthétiques, fonctionnelles et biologiques. » L’usure est devenue d’année en année l’une des préoccupations majeures récurrentes chez les patients qui craignent la fracture ou même la perte de leurs dents : la diminution du nombre des caries a permis à l’érosion de gagner du terrain. À travers le monde, des centaines de revues, d’articles et de congrès abordent ce thème qui suscite un véritable engouement parmi les praticiens. Les médias évoquent régulièrement le sujet que bon nombre de confrères semblent méconnaître en proposant souvent des solutions « de façade » qui ne prennent absolument pas en compte les causes profondes du phénomène. Lorsque cette usure s’intensifie de façon anormale, l’esthétique se trouve fortement altérée : perte de fragments des tissus durs de la dent dans le processus initial qui entraîne des modifications morphologiques dentaires, des troubles fonctionnels, des troubles sensoriels – hypersensibilités –, des rétentions alimentaires au niveau des zones cervicales et au niveau interdentaire à la suite de l’effondrement des crêtes marginales.
Tout praticien dento-conscient se doit d’identifier ces altérations structurelles, mais surtout leurs étiologies afin de freiner leur développement, d’éviter les récidives et d’améliorer le pronostic des traitements envisagés. Le diagnostic différentiel des différentes altérations des tissus dentaires doit être clairement établi avant d’entreprendre tout traitement de restauration.
Une augmentation très nette de la fréquence de ce type de lésions au sein des populations jeunes, l’accentuation du stress et des parafonctions, la surconsommation de sodas, les troubles du comportement alimentaire, l’environnement médiatique constituent autant de facteurs propices à exacerber le phénomène. Le praticien doit relever le challenge, à savoir traiter des patients jeunes et moins jeunes de la manière la plus minimaliste possible afin de ne pas compromettre le devenir de la dent.
L’analyse clinique (fig. 1 à 6) dans les cas d’usure doit permettre, à l’aide de moyens simples, de repositionner les futurs bords libres des deux incisives centrales par ajout de composites à main levée afin de communiquer au laboratoire le repère le plus précieux pour la construction du nouveau sourire par le biais du wax up. Pour cela, une empreinte des nouvelles proportions est réalisée ainsi que son antagoniste. Une fois les bases esthétiques posées, il est primordial de créer les conditions fonctionnelles nécessaires au rallongement du bloc incisivo-canin afin d’assurer la pérennité des futures restaurations.
Pour cela, le recours à l’augmentation de la DVO est l’une des options les plus répandues. Afin de quantifier le besoin de l’augmentation, on reconstruit, avec le même procédé que pour les bords libres, les faces palatines des incisives centrales. Plus l’usure est avancée, plus l’apport sera important.
On vérifie alors la simultanéité des contacts des deux incisives puis l’espace créé sur les dents adjacentes avec leurs antagonistes pour éviter des reconstructions trop volumineuses toujours déplaisantes pour le patient (fig. 7).
Le patient n’est pas manipulé et ferme plusieurs fois de manière à vérifier son bon positionnement. L’espace créé entre les deux arcades est alors vérifié. Il doit correspondre à l’épaisseur de la pièce souhaitée. Chez la majorité des patients présentant une usure marquée, il est rare de noter une dysharmonie faciale, en raison d’une égression compensatrice des process alvéolaires supports des dents usées.
L’augmentation de la DVO est presque exclusivement motivée par la biologie. En effet, l’espace ainsi créé se substitut à la réduction tissulaire. Le troisième élément indispensable à la communication avec le laboratoire est l’enregistrement des références
esthétiques du visage (ligne bi-pupillaire et axe médian) afin de les retranscrire sur le modèle de travail. Pour cela, le dispositif ditramax® est utilisé. Ainsi, les possibilités d’erreurs lors de la construction de la nouvelle ligne du sourire sont quasiment nulles. Des retouches importantes en bouche, au stade du mock up, sont toujours désagréables pour le praticien et le patient, et sont donc réduites à leur plus simple expression grâce à ce type d’enregistrement.
Le projet esthétique : 3 rôles
Validation sur le plan esthétique et fonctionnel par le patient
Le nouveau sourire
Comme dans la majorité des disciplines médicales, le chirurgien-dentiste va être perçu comme un chirurgien esthétique avec la notion d’obligation de résultat. Le transfert du projet en bouche va donc permettre au patient de visualiser directement, en situation, l’aspect (forme, volume) des nouvelles dents et d’apprécier les nouveaux rapports avec les tissus environnants (visage, lèvres, langue et joues) pendant la dynamique labiale (repos, sourire, rire, phonation) [4, 5].
Pour sa réalisation, on utilise successivement :
– une cire de diagnostic réalisée en fonction de l’enregistrement précédent et des lignes dessinées sur le modèle (référence horizontale et verticale) qui traduit morphologiquement les objectifs fixés lors de l’analyse esthétique (modification de forme, de position, fermeture de diastèmes…) (fig. 8) ;
– une clé en silicone pour transférer le projet, issue du wax up. Elle englobe au moins deux dents de chaque côté (non intéressées par le projet), afin de faciliter son repositionnement. Une résine fluide injectable chémopolymérisable « bis GMA » (Luxatemp Star, DMG) possédant des propriétés optiques, suffisamment translucide, sera injectée à l’intérieur de la clé silicone avant son repositionnement en bouche. Une fois la polymérisation de la résine achevée (environ 2 minutes), la clé est retirée. La majorité des excès se concentrent au niveau du vestibule muqueux et de la zone palatine. Ils devront être éliminés délicatement afin de ne pas perturber l’apparence des tissus mous et la phonation (soulèvement ou gonflement de la lèvre, modification de certains phonèmes en cas d’excès palatin). À ce stade, le patient peut se présenter face à un miroir afin de visualiser le projet esthétique. Cette étape de transfert du projet morphofonctionnel, grâce au « masque », est essentielle et doit aboutir à la validation par le patient et le praticien (fig. 9 et 10).
La nouvelle occlusion
Classiquement, on faisait appel à une clé en silicone complète incluant une surface palatine la plus large possible pour la stabilisation. Cependant, il n’existe pas de butée d’enfoncement précise lors de l’insertion de la clé en silicone en raison de la totalité des dents concernées par la réhabilitation. Récemment, l’apport du digital a simplifié de manière significative cette dernière étape. En effet, le wax up est scanné afin de disposer d’une empreinte 3D. Une fois scanné, un logiciel permet d’apposer une couche d’épaisseur calibrée sur le nouveau relief occlusal comme si l’on positionnait virtuellement une gouttière. Celle-ci est ensuite fabriquée par une imprimante 3D puis rebasée à l’aide d’un silicone light afin d’optimiser la friction et la précision de la gouttière lors de son insertion en bouche (fig. 11 à 13).
Cette gouttière en résine rigide est alors essayée en bouche puis remplie par une résine bis GMA fluide afin d’être placée en bouche (fig. 8). Son insertion est simple, précise. L’occlusion est alors vérifiée afin de valider l’intégration fonctionnelle du mock up. Ce dernier préfigure de manière très précise la nouvelle occlusion dans la nouvelle DVO ainsi que la ligne du sourire (fig. 9). Ainsi, le wax up est transféré de manière précise en bouche.
Guidage des préparations : une nécessité pour le praticien
L’idée directrice est d’utiliser le mock up esthétique et fonctionnel comme un guide de préparation aussi bien pour les facettes vestibulaires que pour les table tops occlusaux postérieurs (fig. 14, 15a et b). Deux questions majeures se posent alors :
– quelle profondeur de préparations pour nos restaurations postérieures ?
– quelles formes de préparation ?
Dans les réhabilitations de denture usée, il est important de souligner le caractère novateur des préparations en raison de leur approche moderne. La reconstruction est souvent additive et l’espace existant entre le volume initial et le volume final est déjà existant.
Les préparations antérieures
Toujours soucieux de réduire l’extension de nos préparations ainsi que le coût biologique [12], différentes techniques ont été proposées. Les préparations pour facettes vestibulaires sont aujourd’hui parfaitement codifiées ; en effet, elles font appel à l’utilisation d’un mock up qui sert de guide de préparation. Ainsi, la fraise dont le calibrage est connu peut pénétrer à travers le mock up afin de créer l’espace nécessaire pour la future restauration et garantir la réduction tissulaire nécessaire (fig. 16) [4-9]. Cette technique, proposée au début des années 2000 [4, 5], a connu un grand succès en raison de sa pédagogie et a ouvert une nouvelle voie dans la démocratisation des facettes en céramique. Dans le cas clinique présent, une variante de cette approche moderne a été utilisée afin d’optimiser la réduction tissulaire au niveau du secteur postérieur. En effet, aujourd’hui, les techniques de pénétrations contrôlées à partir d’un mock up sont parfaitement maîtrisées dans le secteur antérieur.
Les préparations postérieures
Quelle profondeur de pénétration ?
Il a été proposé d’utiliser la méthode des préparations à partir du mock up antérieur pour l’adapter aux préparations postérieures. En effet, une fois le mock up réalisé en bouche, stabilisé puis validé, il semble plus opportun de le maintenir en place au stade des préparations afin de réaliser une réduction homothétique à ce dernier en utilisant une fraise boule de diamètre connu et placée à l’horizontale de manière à bénéficier d’une butée d’enfoncement par l’intermédiaire de son mandrin.
Ainsi, différentes rainures (au nombre de 3) doivent être réalisées (versant interne de la cuspide vestibulaire, sillon central, versant interne cuspide palatine) (fig. 16a à c, 17a et b, 18).
Ainsi, le clinicien dispose de l’information la plus précieuse afin d’éviter toute surpréparation. Lors de la réalisation de ces rainures, il est important de ne pas empiéter sur les régions proximales afin d’optimiser les préparations sur le plan biologique et biomécanique [10-14].
Une fois la question de la profondeur de pénétration réglée, se pose celle de la forme de préparation.
Cette dernière demeure beaucoup plus simple dans sa réponse en raison du seul impératif de lecture des limites et de stabilisation de la pièce lors du collage. Si les formes de préparations pour facettes sont codifiées depuis de nombreuses années dans le secteur antérieur, quelques approfondissements doivent être apportés sur les formes de préparations dans la région postérieure lors de la réalisation de facettes occlusales appelées aussi table tops.
Quelles formes de préparations pour les restaurations postérieures ?
Il faut préciser qu’étant donné la faible épaisseur des préparations, celles-ci peuvent être réalisées dans une majorité de cas sans pratiquer d’anesthésie.
Les restaurations partielles collées ont vocation à protéger la dent, mais aussi à recréer l’anatomie occlusale initiale qui autorisera l’augmentation de la DVO.
Pour y parvenir, plusieurs options thérapeutiques ont été proposées au cours des années.
Initialement, la couronne périphérique fut pendant longtemps la solution de choix pour remplir ce cahier des charges ; ne répondant plus aux impératifs biologiques modernes, cette solution est aujourd’hui rarement retenue.
Les overlays en céramique ou en composite de laboratoire ont été proposés ces dernières années et présentaient l’avantage d’une moindre mutilation tissulaire avec des limites périphériques très simples et bien audessus de la JEC des marges habituelles. Cependant, ils présentaient et continuent de présenter un inconvénient majeur, à savoir la destruction des crêtes proximales afin d’assurer l’assise mécanique et de respecter les recommandations des fabricants. Des épaisseurs importantes de réduction de l’ordre de 1 à 1,5 mm étaient requises. Malgré le strict respect de ces dernières, il a été observé sur des suivis à moyen et long terme des fractures de cosmétique ou de matériau dans la région proximale (chiping). L’avènement des technologies CAD CAM ou des techniques de céramique pressée a sensiblement modifié ces carences mécaniques en raison d’une plus grande densité du matériau (fraisage à partir d’un bloc de céramique ou de composite) et du recours à un simple maquillage de surface.
Afin de mieux coller aux réalités biologiques et de respecter encore plus les structures résiduelles, il devient possible de réaliser des préparations a minima dont le but est d’obtenir :
– une préservation des crêtes proximales quand cellesci sont présentes (une grande majorité de cas) ;
– une diminution des épaisseurs de réduction (0,5- 0,8 mm) en raison d’une moindre sollicitation des restaurations (absence de tension au niveau proximal).
En effet, de par la persistance de l’architecture proximale, les crêtes continuent de jouer pleinement leur rôle mécanique. Les restaurations ultrafines à distance des crêtes se retrouvent donc à travailler uniquement en compression, ce qui est très bien toléré par les deux familles de matériaux (composite ou céramique) (fig. 19 à 22).
Les formes de ces préparations ultraconservatrices peuvent se caractériser de la manière suivante :
– délimitation d’un rectangle dans la face occlusale à l’aide d’une fraise boule bague verte (coffret Komet LD0717) et rouge entre les fossettes proximales à 1 à 3 mm sous les sommets cuspidiens en fonction du délabrement. Dans tous les cas, la préparation devra toujours être à distance des sommets cuspidiens (en retrait) ou les englober si l’usure est plus importante. Les limites doivent être à distance des impacts occlusaux afin d’assurer la pérennité du joint. L’utilisation d’une fraise boule bague verte et rouge semble être une solution intéressante pour réaliser un angle net cavosuperficiel de 90° pour la pérennité du joint. Les concepts de préparation type « prepless » doivent être évités en raison de la nature de la ligne de finition entre la surface occlusale de la dent et la restauration. Le biseau ainsi créé n’aurait pas vocation à assurer la résistance mécanique nécessaire face aux impacts et aux charges occlusales (chiping, délitement, coloration). Il est donc impératif de réaliser une trace nette ;
– réduction et homogénéisation des différentes gorges si elles sont présentes à l’aide d’une fraise à inlay ;
– inclusion des cuspides palatines lorsqu’elles sont elles-mêmes érodées par l’usure pour amorcer un retour en palatin, et ce toujours dans le but “d’asseoir” la restauration dans un “cadre” stable.
Dans le cas de lésions multiples (palatines et/ou vestibulaires) associées à une usure occlusale, sur les prémolaires et molaires, il faudra réaliser deux pièces distinctes en prenant soin de laisser une « bande d’émail » entre elles, cette poutre faisant office de « résistance » qui raccorde les deux crêtes proximales et sert de soutien aussi bien à la restauration occlusale que vestibulaire, permettant ainsi d’assurer la solidité de la dent. Ainsi, le praticien se retrouve à recourir à la technique « sandwich » décrite au niveau antérieur (facette palatine et vestibulaire) dans le secteur postérieur. Les prémolaires sont reconstruites par addition d’une facette vestibulaire et d’un inlay occlusal afin de restituer le volume initial de la dent. Ainsi, le gain biologique est très sensible, notamment dans la région proximale et palatine.
Lorsque la sévérité des lésions est plus importante, on procède à des pièces plus enveloppantes reposant toujours sur l’anatomie proximale existante, mais où les faces occlusale et vestibulaire ne font plus qu’une pièce unique au lieu d’un sandwich (fig. 18).
Les 3 types de table top (fig. 23)
– Table top intra cuspidien
– Table top cuspidien
– Table top occluso vestibulaires : veneerlay
Temporisation
Que ce soit dans un but cosmétique ou fonctionnel, l’étape de la temporisation doit être simple, rapide pour s’inscrire dans un protocole clinique prévisible et reproductible.
Le même matériel (clé en silicone et résine bis GMA) sera utilisé pour la réalisation des provisoires. Le procédé est identique à celui réalisé lors du projet esthétique, la différence résultant au niveau de la situation dentaire (dents préparées avec de l’adhésif photopolymérisé mais sans mordançage préalable). Ainsi, les provisoires ne sont plus retirés après la prise, mais finis directement en bouche. Après ajustage des restaurations provisoires et contrôle de leur adaptation occlusofonctionnelle, les impacts statiques en OIM et les trajets de propulsion et latéralité sont matérialisés en bouche à l’aide d’un papier marqueur sur les provisoires. Le volume disponible peut être alors quantifié à l’aide d’un compas d’épaisseur par lecture directe au niveau des zones d’occlusion.
Fabrication et mise en place des restaurations
« Fraiser et maquiller ou presser et maquiller »
La technologie CAD CAM et les différents blocs à disposition permettent aujourd’hui de remplir le cahier des charges de nos restaurations.
Nous assistons à une simplification des procédures de laboratoire avec une disparition de la stratification et un remplacement par un maquillage de surface sur les restaurations issues des blocs fraisés qui donne d’excellents résultats dans le secteur postérieur, et des résultats prometteurs dans le secteur antérieur. Aussi, les restaurations voient leur résistance mécanique renforcée après collage et le risque de chipping sensiblement diminué. On peut ainsi combiner dans le cas de sandwich un bloc nanocéramique (Lava Ultimate, 3M ESPE) dans les régions fonctionnelles pour préserver l’émail antagoniste et des blocs cosmétiques en disilicate de lithium (e.max CAD, Ivoclar Vivadent) pour optimiser l’intégration esthétique (fig. 24 à 27).
Collage des restaurations [15]
Les restaurations sont essayées dans un premier temps :
– essayage mécanique en vérifiant la précision d’adaptation des pièces ;
– essayage optique : intégration colorimétrique à l’aide d’une pâte d’essai (Vitique veneer, DMG ; variolink veneer, Ivoclar Vivadent ; Enamel Hri flow Dentin, Mycerium).
Les sandwichs (facettes vestibulaires et palatines) sont collés simultanément, mais dent par dent. Les table tops sont collés également selon le procédé de la digue individuelle (fig. 28a et b à 38).
Conclusion
Les facettes en céramique ou plutôt les restaurations adhésives en céramique sont aujourd’hui l’outil moderne de la reconstruction de l’organe dentaire [16] en raison de plusieurs avantages indéniables :
– biologiques (préservation tissulaire maximale) ;
– biomécaniques (restitution de la biomimétique de la dent originelle) ;
– esthétiques (pouvoir mimétique de la céramique collée).
Les facettes, qu’elles soient en céramique, en nanocéramique, en composite, à visée cosmétique ou fonctionnelle, ne sont que l’expression d’un projet esquissé au départ du traitement dont le rôle est primordial. En effet, c’est bien au stade de son élaboration que tout le traitement va se jouer. Une fois celui-ci validé esthétiquement et fonctionnellement, il sera utilisé précieusement comme un GPS afin d’être converti en traitement final.
L’auteur souhaiterait associer le groupe Style italiano dont l’objectif est de développer sans cesse des techniques accessibles, reproductibles et donc réalisables par le plus grand nombre.
Un remerciement particulier à Gerald Ubassy pour son implication et son talent dans la réalisation au laboratoire de ce cas clinique.
Spécialisé en Implantologie, prothèse implantaire, greffes osseuses et greffes gingivales, le Docteur Patrice Margossian est installé comme Chirurgien dentiste à Marseille, sur l’avenue du Prado.P. Margossian, S. Koubi, E. Loyer, G. Maille, A. Sette, G. Laborde
L’INFORMATION DENTAIRE n° 29 – 3 septembre 2014
L’odontologie prothétique est depuis plusieurs années dans sa mutation numérique. L’implantologie et la prothèse sur implants suivent bien entendu le même processus.
Cette révolution a commencé par l’arrivée dans nos laboratoires des techniques de CFAO qui se sont progressivement substituées aux techniques artisanales. Ces données numériques permettent de réaliser des pièces prothétiques usinées sur différents types de matériaux (métal, céramique, résine) avec une précision et une fiabilité supérieures à la méthode conventionnelle. La CFAO n’est pas juste une nouvelle mise en oeuvre, elle a également permis de faciliter la conception des infrastructures prothétiques tout en garantissant une précision d’adaptation optimale. Dans le domaine de l’implantologie, cette révolution a débuté au début des années 90 grâce aux travaux de Matt Andersson qui réalisa des piliers anatomiques personnalisés, issus du scannage mécanique d’une maquette en résine (Nobel Procera). Plus récemment, les palpeurs mécaniques ont laissé la place au scanner optique garantissant un enregistrement plus simple et plus précis des indexations implantaires (fig. 1). L’étendue des domaines d’application de la CFAO en implantologie est immense, allant de la réalisation simple d’un pilier anatomique à celle, plus complexe, de grandes barres usinées destinées aux réhabilitations de l’édentement complet. La CFAO ne se limite pas à la réalisation d’infrastructures prothétiques au sein des laboratoires de prothèse. En effet, l’avancée technologique des dix dernières années dans le domaine des empreintes optiques intrabuccales a permis d’accéder à un usage implantaire [1]. La réalisation d’empreintes optiques sur implants permet d’obtenir une chaîne totalement numérique évitant les erreurs relatives à la prise d’empreinte conventionnelle, la coulée du modèle de travail et la chaîne métallurgique.
La numérisation de la dentisterie a également ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine du diagnostic et de la planification. Il est en effet d’ores et déjà possible de superposer des données d’imagerie et de CAO (Conception Assistée par Ordinateur), créant ainsi un véritable trait d’union entre le domaine chirurgical et le domaine prothétique [2]. Ce qui suit a donc pour objet, au travers de différentes applications cliniques, de nous faire voyager dans le monde de l’implantologie numérique.
Édentement intercalaire : restauration scellée sur 2 implants mandibulaires en position de 45 et 46.
Il s’agit d’une situation très classique de 2 implants intercalaires en sites de 45 et 46. Une option de prothèse scellée a été ici retenue pour optimiser l’intégration fonctionnelle et esthétique des tables occlusales. Une empreinte conventionnelle est prise en technique porte-empreinte ouvert avec un matériau polyéther. Deux piliers anatomiques en titane (Nobel Procera) et une armature en chrome-cobalt (CrCb) sont commandés au laboratoire (fig. 2 et 3). L’utilisation du logiciel de CAO permet une mise en forme simple et rapide du design des piliers.
Dans le même temps, une armature est modélisée sur les piliers. Il est possible en temps réel, grâce à ces logiciels, de superposer en transparence le projet thérapeutique final en 3D sur l’armature, ce qui se révèle une aide précieuse dans la réalisation des formes de contour adaptées au soutien du futur matériau cosmétique. Il est de même très intéressant de pouvoir mesurer en toutes zones les épaisseurs de matériau afin de garantir la stabilité mécanique à long terme de la reconstruction. À cet effet, des sécurités préenregistrées dans les logiciels permettent de respecter les épaisseurs
minimales préconisées par l’industriel.
Il faut noter au niveau de la conception des piliers que le positionnement des limites cervicales et les formes de contour transgingivales sont optimisés pour assurer un parfait soutien de la muqueuse péri-implantaire et une élimination aisée des excès de ciment (fig. 4). L’ensemble de ces pièces est essayé cliniquement afin de valider la parfaite passivité de l’armature (fig.. 5a) et d’effectuer l’enregistrement de l’occlusion. L’armature, une fois céramisée par le prothésiste, est scellée de manière conventionnelle et un grand soin est porté à l’élimination des excès de ciment (fig. 5b). L’utilisation de piliers et d’armatures usinées par CFAO permet de s’affranchir des problèmes liés à la métallurgie conventionnelle dans les laboratoires de prothèse. Ainsi, grâce à la CFAO, la passivité des armatures supra-implantaires devient moins opérateur dépendant et offre donc au plus grand nombre la précision d’adaptation nécessaire à la réalisation de prothèses supra-implantaires.
Édentement terminal : restauration transvissée sur 3 implants
Ici, nous pouvons totalement transposer le discours du cas précédent au cas d’une restauration transvissée sur pilier implantaire (ici, pilier Multi Unit Abutment de Nobel Biocare). Avec les mêmes fonctionnalités de logiciel, il est possible d’usiner une armature totalement passive avec des formes garantissant un parfait soutien du matériau céramique. L’utilisation d’alliages précieux recommandée pour la conception d’armatures par la technique artisanale devient dans ce cas obsolète, car l’usinage permet d’obtenir des pièces prothétiques parfaitement adaptées quel que soit le type de matériau.
Trois matériaux sont disponibles pour ce type de restauration : la zircone [3] (fig. 6, 7 et 8), le titane, le CrCb (fig. 9, 10 et 11).
La prothèse transvissée permet en plus de se dédouaner de la gestion des excès de ciment et garantit une dépose facile en cas de besoin. La CFAO est donc, dans ce type de situation, une aide indiscutable quant à la fiabilité de réalisation de la procédure prothétique.
Édentement antérieur : bridge transvissé direct implant
Dans le secteur antérieur, l’utilisation de systèmes tout céramique est fortement recommandée du point de vue biologique, mais surtout optique. En effet, la transmission de la lumière au niveau coronaire, comme dans la zone transmuqueuse, permet d’éviter l’effet grisé lié à la présence d’une armature métallique et potentialise donc l’intégration esthétique. Grâce à l’utilisation d’implants à connectique externe, il est possible de réaliser de petits bridges transvissés en zircone directement sur des implants multiples. La situation clinique montre un bridge de 12 à 22 réalisé après une extraction-implantation immédiate des 4 incisives maxillaires. La mise en place d’un provisoire immédiat, associée à des techniques de chirurgie mucco-gingivale, a permis un bon modelage des tissus mous péri-implantaires (fig. 12 et 13). Les formes de contour de l’armature du bridge en zircone correspondent à une réduction homothétique du projet prothétique, afin de garantir ici aussi un bon soutien de la céramique cosmétique (fig. 14 et 15). De même, en accord avec les recommandations actuelles de la communauté scientifique [4], il est important de créer des formes concaves dans la zone transgingivale vestibulaire. L’utilisation de logiciels de CFAO permet de générer facilement ces formes, tout en restant dans les épaisseurs minimales de matériau afin de ne pas risquer la fracture mécanique de l’armature (fig. 16). L’association du matériau céramique avec la mise en oeuvre CFAO augmente la prédictibilité du résultat sans toutefois minimiser le talent de stratification du céramiste, lequel conditionne grandement le rendu esthétique de la restauration finale (fig. 17 et 18).
Édentement total
Les armatures de prothèses ostéo-ancrées ont toujours été, de par leur étendue, un défi technique pour les prothésistes dentaires. En effet, dans une technique de coulée d’alliage conventionnelle, plus une restauration est grande, plus sa passivité est susceptible d’être compromise, nécessitant fréquemment de recourir à des soudures primaires.
L’arrivée de la CFAO a permis l’usinage de grands blocs de titane, assurant une parfaite adaptation des infrastructures pour un coût et un poids réduits comparés à ceux engendrés par les techniques conventionnelles de coulées en alliages précieux [5]. Une approche numérique à l’aide du logiciel permet, par double scannage ici aussi, la superposition du montage des dents prothétique avec celles de la modélisation de l’armature (fig. 19). Comme en technique céramo-métallique, il est capital que le matériau cosmétique en résine (dent et fausse gencive) soit parfaitement soutenu par l’armature, afin d’éviter toute rupture mécanique lors de la mastication. De même, les sections d’armature sont calculées en fonction du matériau sélectionné afin de garantir l’intégrité mécanique à long terme de la prothèse. Sur ce type de restaurations, les empreintes en plâtre font référence, en raison de leur excellente stabilité dimensionnelle et de leur grande rigidité [6]. Le modèle sera alors scanné nu, puis avec le montage. Le logiciel de CAO offre une aide précieuse à la modélisation, en proposant différentes formes d’armature et de finition (intrados titane ou résine, différentes formes de secteur en T ou en L (fig. 20). La passivité est d’abord vérifiée sur le modèle, puis validée cliniquement (fig. 21 et 22). La finition cosmétique sera alors finalisée (fig. 23).
Empreinte optique intrabuccale implantaire
Après avoir envahi les laboratoires de prothèse, la mutation numérique a poursuivi sa progression jusqu’au sein de nos cabinets. Initialement réservée aux restaurations partielles et unitaires dentoportées, elle a bénéficié de nombreuses évolutions technologiques et s’applique désormais aux restaurations multiples et aux supports implantaires. Il est en effet aujourd’hui possible d’enregistrer, via un capteur optique, la position d’implants dentaires et de commander la restauration prothétique au laboratoire. Une grande majorité des systèmes d’empreinte optique disponibles aujourd’hui sur le marché offrent cette possibilité [7] (Cerec, 3shape, ZFX…). Il faut toutefois préciser qu’à ce jour, seules les restaurations de petite étendue sont envisageables et ce en restauration de type scellé dans la majorité des cas.
La prise d’empreinte optique d’un implant est dans les faits plus simple que la prise d’empreinte optique d’une préparation sur dent naturelle. Dans le cas des implants en effet, il n’y a pas de zone spécifique telle que la limite cervicale ou le profil d’émergence radiculaire, particulièrement difficiles à enregistrer de par leur position juxta ou infragingivale. Avec l’implantologie, l’empreinte optique a donc une indication toute trouvée, mais l’absence de jeu desmodontal nécessite une précision d’enregistrement et d’usinage supérieure.
L’indexation de la position de l’implant se fait grâce à la mise en place d’un scanbody sur la tête de l’implant, permettant la localisation de son positionnement spatial. Seul le système implantaire Biomet 3i propose à ce jour une indexation directe sur le pilier de cicatrisation grâce à un encodage spécifique [8] (Système Encode) (fig. 24). L’empreinte optique permet d’avoir une chaîne totalement numérique, évitant ainsi toutes les erreurs liées aux variations dimensionnelles des matériaux d’empreinte et de réplique. L’obtention d’un modèle physique reste toutefois nécessaire à la réalisation de la stratification cosmétique des restaurations. Ces modèles sont réalisés la plupart du temps par des techniques stéréo-lithographique.
En fonction du système utilisé, un poudrage de la zone d’enregistrement est nécessaire afin de limiter les phénomènes de réflexion lumineuse. Trois enregistrements sont nécessaires : arcade maxillaire, arcade mandibulaire, arcades en occlusion (fig. 25 et 26). Ces données numériques sont transférées via Internet vers le laboratoire de prothèse qui va modéliser les piliers et l’armature [9]. Le modèle stéréo-lithographique inclut la forme des piliers anatomiques modélisés par le prothésiste, sur lesquels va venir se positionner l’armature (fig. 27).
Il sera bien entendu envisageable, dans un avenir très proche, d’avoir des modèles avec inclusion de répliques de piliers transvissés implantaires afin de positionner des armatures pour prothèses transvissées. Il faut garder à l’esprit que dans ce type de configuration, la précision est donnée par le fichier numérique et non par le modèle qui inclut obligatoirement, du fait de la procédure d’insertion des répliques, une erreur non négligeable. Voilà pourquoi nous émettons des réserves sur la procédure Encode lorsqu’elle est réalisée par l’intermédiaire d’une empreinte conventionnelle et non optique [10].
La validation de la passivation de l’armature reste toutefois cliniquement nécessaire. Une fois la stratification réalisée, les piliers seront vissés et la restauration scellée (fig. 28, 29 et 30).
Pour sa part, le système Cerec (Sirona) permet, en plus de cette version indirecte via le laboratoire, d’usiner la restauration directement dans le cabinet grâce à une petite unité d’usinage (Sirona MC-XL). Cet usinage se limite toutefois aux piliers anatomiques et aux coiffes unitaires monoblocs transvissées en céramique (disilicate de lithium). L’empreinte des arcades est prise ici sans poudrage (scanbody en place) et la modélisation est directement faite par le praticien avec l’assistance du logiciel (fig. 31 et 32).
La restauration peut être essayée avant cristallisation, afin d’optimiser les réglages de l’occlusion et des points de contact. Après sa cristallisation et son maquillage, la restauration en céramique sera collée sur une embase métallique. Enfin, la coiffe sera vissée ou scellée sur l’implant (fig. 33). Bien entendu, une voie indirecte par le laboratoire reste toujours possible grâce à l’envoi des fichiers par Internet.
Jumelage des données d’imagerie et de prothèse
La réussite d’un traitement implantaire est essentiellement basée sur la mise en relation du projet prothétique avec le volume osseux du patient. L’incorporation directe du modèle (fichier STL) dans le fichier radio (fichier DICOM) permet une lecture directe de la faisabilité du traitement par l’adéquation des impératifs chirurgicaux et prothétiques. Le cas échéant, la nécessité de pratiquer une greffe osseuse afin d’optimiser la position des implants sera mise en évidence.
À ce stade, le projet de prothèse peut être issu d’une cire de diagnostic (wax up) physique sur le modèle comme d’une cire de diagnostic virtuelle modélisée sur le logiciel de CAO (NobelClinician (Nobel Biocare), Simplant (Materialise), Cerec SIrona). Une fois la planification réalisée, l’objectif de cette nouvelle approche est de réaliser un guide chirurgical permettant d’optimiser la position de l’implant pour réduire le risque d’erreur. Le cas clinique suivant illustre le remplacement d’une incisive latérale lactéale par un implant de petit diamètre (NobelActive NP). La situation initiale indique, du fait de la présence d’une concavité apicale marquée (fig. 34), la nécessité de réaliser une greffe osseuse d’apposition. Cette nouvelle configuration osseuse a pu être confrontée à notre projet prothétique grâce à l’utilisation du logiciel NobelClinician (fig. 35). Nous avons ainsi pu réaliser l’extraction virtuelle de la 12 et voir l’impact positif de la greffe osseuse sur le volume tissulaire. La superposition du wax up permet de trouver la position 3D idéale de l’implant (fig. 36). Une fois la planification terminée, un guide chirurgical à appui dentaire peut être commandé pour sécuriser une chirurgie sans lambeau (fig. 37). Ce guidage sera plus ou moins directif en fonction de l’utilisation soit d’un guide pour foret de 2 mm, soit par un guidage jusqu’au foret terminal.
Le système Sirona propose quant à lui les mêmes fonctionnalités logicielles en ajoutant la possibilité d’intégrer le modèle 3D issu d’une empreinte optique intrabuccale. La modélisation du projet thérapeutique est faite ici grâce à l’interface Cerec, ce qui évite une étape de laboratoire pour les configurations les plus simples (fig. 38).
Cette nouvelle possibilité de jumelage des données radiologiques et de CAO n’est pas juste une fonction supplémentaire, c’est à notre sens un vrai bond en avant dans le diagnostic, l’analyse et le traitement implantaire.
Conclusion
La CFAO et l’outil numérique au sens large ont révolutionné la discipline implantaire depuis le diagnostic jusqu’à la réalisation des prothèses. Les évolutions dans ce domaine nous rapprochent chaque jour de la conception d’un patient virtuel. L’amélioration du diagnostic, tout comme l’établissement d’un projet thérapeutique global intégrant virtuellement l’ensemble des paramètres anatomiques, prothétiques, esthétiques et fonctionnels, sont de nature à nous confirmer que la numérisation de notre profession est un bienfait incontestable.
Installé à Marseille, le Docteur Patrice Margossian est Chirurgien dentiste spécialisé dans les implants dentaires, greffes osseuses, greffes de sinus et greffes de gencive.S. KOUBI, G. GÜREL, P. MARGOSSIAN, R. MASSIHI, H. TASSERY
ROS – SEPTEMBRE 2014, Rev Odont Stomat 2014; 41:00-00
STEFEN KOUBI.MCU PH, département d’odontologie conservatrice, Faculté Aix-Marseille. GALIP GÜREL. Professeur visiteur, Facultés Aix-Marseille et New York University, pratique privée Istanbul. PATRICE MARGOSSIAN. MCU PH, département de prothèse fixée, Faculté Aix-Marseille. RICHARD MASSIHI. Pratique privée, Paris. HERVÉ TASSERY. PU-PH, département
département d’odontologie conservatrice, Faculté Aix-Marseille.
RÉSUMÉ
Le traitement de l’usure dentaire en général et de l’érosion en particulier est devenu un sujet d’actualité depuis une dizaine d’années. Afin de limiter la destruction des tissus résiduels lors des techniques restauratrices, différentes techniques peu invasives ont vu le jour. L’objectif de cet article est, après avoir présenté certains concepts novateurs, de proposer un protocole de restauration particulier grâce auquel les épaisseurs des préparations sont guidées par des masques (mock-up) issus d’un projet alliant fonction et esthétique. Bien que révolutionnaire d’un point de vue conceptuel, il est indispensable d’appliquer à cette technique une méthodologie stricte afin d’optimiser le pronostic de ce type de traitement.
INTRODUCTION
Le traitement de l’usure dentaire en général et de l’érosion en particulier est devenu un sujet d’actualité depuis une dizaine d’années. Bien que la prévalence des lésions n’ait cessé d’augmenter, les traitements ne sont toujours pas parfaitement codifiés, ce qui rend parfois leurs pronostics aléatoires. Les gouttières occlusales de protection et les composites de « dépannages » occupent en effet encore une place non négligeable dans l’arsenal thérapeutique des praticiens, de même que les restaurations périphériques souvent mutilantes. Ces dernières années viennent cependant de voir l’avènement de techniques économes en tissus dentaires, grâce aux progrès du collage. Celles-ci présentent un important avantage sur le plan biologique, car les dents sont très peu, voire pas du tout, préparées.
L’objectif de cet article est, après avoir présenté certains concepts novateurs, de proposer un protocole de restauration particulier grâce auquel les épaisseurs des préparations sont guidées par desmasques (mockup) issus d’un projet alliant fonction et esthétique.
I. USURE ET ÉROSION : UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE
L’usure dentaire est indépendante du métabolisme microbien. Elle désigne toute altération des tissus durs de la dent liée à une lésion non carieuse. Elle entraîne un épaississement des bords libres des incisives et un aplatissement des dents cuspidées. Toutes ces modifications morphologiques rendent les dents plus massives et plus courtes.
Lorsqu’elle devient anormalement importante, l’usure altère la fonction et l’esthétique. Les pertes initiales de fragments dentaires entraînent alors des modifications morphologiques, des troubles fonctionnels et sensoriels (hypersensibilité), des rétentions alimentaires au niveau des zones cervicales et au niveau interdentaire, suite à l’effondrement des crêtes marginales. Tout praticien doit savoir dépister ces altérations structurelles, mais surtout il doit savoir identifier leurs étiologies afin de freiner leur développement, d’éviter les récidives et d’améliorer le pronostic des traitements envisagés. Le diagnostic différentiel des différentes altérations des tissus dentaires doit de plus être clairement établi avant d’entreprendre tout traitement restaurateur.
L’usure érosive (attaque acide) est actuellement l’une des préoccupations majeures de la santé publique, en particulier chez les jeunes individus, souvent « surconsommateurs » de sodas et/ou parfois souffrant de troubles du comportement alimentaire (TCA) ou d’un bruxisme, de l’éveil et/ou du sommeil. Bien que largement relayée par la presse scientifique et par les médias, cette problématique n’est pas toujours connue par les odontologistes qui proposent souvent des solutions de « façade » qui ne prennent que rarement en compte les causes profondes du phénomène. Elles sont le plus souvent délabrantes, alors qu’elles devraient être le moins invasives possible [Lussi et Jaegi, 2012].
II. TRAITEMENT DES LÉSIONS ÉROSIVES AVANCÉES : ACTUALISATION DES CONCEPTS
Jusqu’à il y a encore quelques années, les patients qui présentaient une usure érosive importante « bénéficiaient » de traitements d’urgence (gouttières occlusales, petites restaurations en composite) ou de solutions très mutilantes (restaurations périphériques en vue de recréer l’esthétique et la fonction, avec le risque à court et moyen terme d’assister à des fractures des matériaux cosmétiques ou de la dent elle-même).
Cette approche est actuellement révolue, puisqu’il est recommandé de reporter le plus tard possible les traitements invasifs afin d’éviter d’entamer le capital tissulaire des dents, que le patient soit jeune ou âgé. À cet effet, depuis la fin des années 2000, de nouvelles perspectives ont vu le jour, ce qui a significativement modifié l’approche « classique », peu conservatrice, des lésions érosives [Vailati et coll., 2008a, b, c ; Spreafico, 2010 ; Dietschi et Argente, 2011 ; Fradeani et coll., 2012].
Plusieurs classifications ont ainsi été proposées, mais la plus pertinente est celle qui permet d’adapter la nature et la forme des restaurations à la perte tissulaire observée. Cette dernière, nommée ACE (Anterior Classification of Erosion) par Vailati et Belser [2010], est un véritable outil clinique qui permet au praticien de corréler le niveau de destruction tissulaire (important, moyen ou faible) à un certain type de restauration. Le traitement est innovant, il devient prévisible et reproductible. Il fait appel aux dernières avancées dans le domaine de l’adhésion et des biomatériaux (procédé de fabrication CAD CAM, à base de bloc de céramique ou de composite, céramique pressée, etc.), ce qui permet d’optimiser les performances mécaniques et esthétiques des restaurations.
En effet, selon Magne et Belser [2003], l’avènement de la dentisterie adhésive a profondément bouleversé le mode de pensée du praticien : « La dent et la préservation tissulaire deviennent le centre de nos préoccupations en lieu et place de la nécessité d’adapter celles-ci au cahier des charges des matériaux. La biologie devient enfin le pilier essentiel de cette nouvelle ère. »
III. TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE
La technique en trois temps ou « Three-step technique » [Vailati et coll., 2008a, b, c] est probablement la technique de restauration des lésions érosives la plus emblématique, en raison de sa systématisation. Comme toujours, il est important de se demander si ce qui semble idéal et simple sur le plan théorique l’est également sur le plan pratique, à savoir réalisable par le plus grand nombre de praticiens. Le but de ce travail, qui s’appuie sur cette technique, est de proposer une simplification des procédures, afin de faciliter sa mise en application.
PRINCIPES DE LA « THREE-STEP TECHNIQUE »
Cette technique repose sur trois grandes étapes :
Étape 1. Reconstruction de l’anatomie occlusale perturbée afin de rétablir la nouvelle dimension verticale d’occlusion (DVO) et l’esthétique. Une maquette, ou mock-up, permet à cet effet de matérialiser la reconstruction finale. La validation du projet (intégration esthétique et fonctionnelle) peut prendre 1 à 6 semaines. Les restaurations d’usage sont ensuite réalisées au cours de la séquence suivante.
Étape 2. Reconstruction des secteurs postérieurs, d’abord au maxillaire puis à la mandibule, à l’aide de gouttières utilisées directement en bouche, garnies de composite utilisé en méthode directe, afin de faciliter la création d’un nouveau guidage antérieur. Au niveau des dents antérieures, des facettes palatines en composite et/ou en céramique sont réalisées en technique indirecte.
Étape 3. Restauration de l’esthétique antérieure par restaurations partielles vestibulaires collées en céramique, une fois la nouvelle occlusion établie (calages postérieur et antérieur).
DÉTERMINATION DE LA NOUVELLE DVO
Dans la plupart des cas, une augmentation de la DVO est réalisée afin de reconstruire sur une épaisseur adéquate la morphologie occlusale et afin d’éviter une mutilation excessive des tissus dentaires. La raison esthétique de cette augmentation n’est que peu souvent retenue. En effet, chez la majorité des patients présentant une usure marquée, il est rare de noter une dysharmonie faciale, car les égressions dentaires et alvéolaires compensent le plus souvent l’usure.
Chez les patients qui présentent une perte de la DVO en raison d’un bruxisme de l’éveil et/ou du sommeil sévère, l’usure des dents peut ne concerner que certains secteurs, mais les décisions thérapeutiques doivent toutes inclure la reconstruction coronaire de l’ensemble des dents. Aucune approche segmentaire n’est en effet acceptable [Molina et coll., 2003]. Cette nouvelle DVO est établie directement en bouche demanière empirique à l’aide d’un JIG en résine placé entre les arcades au niveau antérieur, ce qui permet de créer les conditions de reconstruction des dents postérieures en créant un espace interocclusal suffisant. Notons que la reconstitution des secteurs postérieurs par technique directe demeure une étape difficile du traitement.
APPROCHE SIMPLIFIÉE
L’objectif principal de cet article est de proposer une simplification de la « Three-step technique », en faisant appel à des outils pédagogiques éprouvés, tout en gardant ses lignes directrices. Une fois le wax-up réalisé au laboratoire, plusieurs questions se posent :
– comment le transférer de manière fiable dans la cavité buccale ?
– comment connaître la profondeur idéale des préparations dans les régions postérieures ?
– quelle forme doit-on donner aux préparations ?
Pour répondre à ces trois questions et pour présenter notre nouvelle approche thérapeutique, nous nous appuierons sur un cas clinique.
IV. APPLICATION CLINIQUE
A. PRÉSENTATION DU CAS
Une patiente de 25 ans se présente à la consultation pour un problème fonctionnel (« Mes dents me font mal au chaud et au froid ») et esthétique (« Mes dents sont jaunes et je suis insatisfaite de mon sourire ») (fig. 1 et 2). Elle est également consciente que ses dents s’usent par grincement, la nuit et le jour. Des antécédents d’anorexie-boulimie sont également mis en évidence lors de l’anamnèse. Elle ne veut pas que l’on prépare ses dents, ou très peu, et elle refuse de recourir à des couronnes exigeant des préparations coronaires périphériques mutilantes.
L’examen clinique révèle une usure peu marquée sur la face vestibulaire des dents antérieures, avec une abrasion des bords libres du bloc incisivocanin maxillaire supérieur et inférieur à l’origine de ses doléances esthétiques (fig. 3). Les faces palatines et linguales montrent des plages érosives importantes, avec des destructions importantes de l’émail palatin. Les faces occlusales des dents postérieures sont également usées, avec des plages dentinaires apparentes (fig. 4). L’émail est totalement absent au niveau de certaines zones, mais l’intégrité structurelle des dents postérieures demeure cependant correcte (fig. 5).
L’examen occlusal en positions statique et dynamique montre une fonction canine et une propulsion normale. La ligne du sourire ne révèle pas d’anomalie particulière.
B. PROPOSITION DE TRAITEMENT
Restauration de l’arcade maxillaire supérieure et inférieure en recréant une anatomie palatine et occlusale idéale ; celle-ci sera permise grâce à une légère augmentation de la DVO afin de créer les conditions spatiales nécessaires à la restauration de la morphologie palatine antérieure. Cette proposition a été acceptée et validée.
C. TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE
– Prévisualisation et validation par le patient [Gürel et Bichacho, 2006 ; Magne et Belser, 2004 ; Magne et Magne, 2008].
Préalablement à tout diagnostic et à toute proposition thérapeutique, un enregistrement de la position du maxillaire par rapport au visage est réalisé afin de pouvoir disposer sur le modèle de travail initial sur lequel le wax-up va être réalisé, des deux repères esthétiques les plus importants du visage que sont la ligne bipupillaire et l’axe médian du visage. Pour cela, un dispositif récemment commercialisé, le Ditramax®, est utilisé [Margossian et coll., 2010, 2011]. Avec cet outil, les possibilités d’erreurs lors de la construction de la nouvelle ligne du sourire sont quasiment nulles.
Des empreintes à l’alginate sont ensuite réalisées afin de procéder à la réalisation d’un wax-up destiné à recréer l’anatomie idéale des dents postérieures et la morphologie idéale des dents antérieures (fig. 6).
Des cales en résine composite sont alors réalisées dans la bouche de la patiente, de chaque côté, au niveau des zones postérieures, afin de permettre d’évaluer successivement la hauteur disponible lors des préparations. Une autre approche consiste à reconstruire à main levée l’anatomie palatine perdue à l’aide de composite afin d’enregistrer l’ensemble de l’occlusion à partir de cette butée d’enfoncement que représente la nouvelle face palatine. Une fois ces butées occlusales réalisées, il est important de procéder à l’enregistrement de cette nouvelle DVO créée pour le rétablissement d’une morphologie naturelle à l’aide d’un silicone d’enregistrement. Celui-ci sera précieux pour le positionnement des deux arcades sur l’articulateur en vue de la réalisation des wax-up maxillaire et mandibulaire dans le nouvel espace occlusal recréé. Il est à noter que le wax-up réalisé par le technicien est fondamental, car il détermine toutes les étapes des futures restaurations, tant postérieures qu’antérieures.
– Mock-up indirect
Une clé en silicone est réalisée au cabinet à partir du wax-up. Elle doit être la plus enveloppante possible et s’appuyer sur les rebords alvéolaires et le palais afin de disposer d’une butée d’enfoncement lors de son insertion en bouche ; si l’on ne prend pas garde à l’obtention de cette stabilité, il demeure difficile pour le praticien d’exercer la pression nécessaire sur la clé, ce qui peut aboutir soit à son écrasement contre les dents existantes, soit à un espace trop important entre les deux. La clé en silicone est remplie à l’aide d’une résine injectable Bis-GMA chémopolymérisable (Luxatemp Star®-DMG), afin d’utiliser les avantages esthétiques de ce matériau, mais également de profiter de sa facilité d’utilisation (fig. 7).
Des meulages sélectifs sont souvent réalisés sur le masque (mock-up) obtenu après le retrait de la clé, afin d’obtenir l’occlusion la plus stable possible, et ce bien qu’un wax-up et qu’un montage en articulateur aient préalablement été réalisés. Ces réglages requièrent l’attention du praticien durant quelques minutes mais ils sont essentiels pour la suite du traitement (fig. 8).
Une autre difficulté inhérente à ce type de réhabilitation demeure la stabilisation des mock-up en résine pendant la phase de test qui peut durer plusieurs semaines. Le caractère parafonctionnel de cette patiente associé à l’absence de préparation des dents accroît de façon exponentielle la difficulté de maintenir en place ces dispositifs.
Dans les secteurs postérieurs, il est donc proposé de solidariser les secteurs molaires et prémolaires pour une meilleure stabilisation (fig. 9). C’est pourquoi un mordançage et l’application d’un adhésif sur les faces occlusales sont réalisés afin d’optimiser la rétention du mock-up postérieur.
De plus, la clé en silicone servant à réaliser le mock-up doit être réalisée à l’aide d’un silicone lourd, puis d’un silicone light (wash technique) sur le wax-up afin d’améliorer la précision de l’anatomie et l’élimination des excès au niveau cervical. Le mock-up ainsi réalisé est d’une précision remarquable. L’intégration esthétique et fonctionnelle est validée par la patiente (fig. 10).
Ces derniers mois ont vu l’avènement d’une nouvelle génération de gouttière rigide dont l’insertion intrabuccale est facilitée, ce qui induit une grande précision du mock-up tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique. Une fois réalisé sur le modèle, le wax-up est scanné. Il est alors visualisé sur l’écran d’un ordinateur et une gouttière est d’abord élaborée virtuellement, puis matérialisée à l’aide d’une imprimante 3D (Intelligence Origin Corporation, États-Unis). Un rebasage au silicone light est alors effectué. La friction créée au niveau des faces vestibulaires et palatines offre ainsi une position d’insertion unique (fig. 11).
D. PRÉPARATIONS DENTAIRES
Elles répondent au principe d’économie tissulaire, car la reconstruction est souvent additive pour compenser la légère perte de DVO que l’égression alvéolo-dentaire n’a pu compenser.
LES PRÉPARATIONS ANTÉRIEURES
Toujours soucieux de réduire l’extension des préparations ainsi que le coût biologique [Edelhoff et Sorensen, 2002], différentes techniques ont été proposées. Les préparations pour facettes vestibulaires sont aujourd’hui parfaitement codifiées. Elles font appel à l’utilisation d’un mock-up qui sert de guide de préparation. Dans le cas présent, les pertes de substances vestibulaires dans le secteur antérieur étant faibles, les préparations se limitent à un simple dépolissage dans le but d’assurer la continuité et la stabilité de la facette palatine. La face palatine recevra simplement une légère logette au milieu du cingulum afin de stabiliser la restauration lors du collage.
LES PRÉPARATIONS POSTÉRIEURES
Deux questions se posent au praticien une fois que le mock-up est placé en bouche et qu’il est validé.
– Jusqu’où la fraise doit-elle pénétrer ?
Pour les préparations postérieures, il est possible d’utiliser la méthode décrite par Gürel [2003, 2005], qui se base sur la réduction dumock-up alors qu’il est positionné sur les dents. Il semble en effet opportun de le maintenir en place au stade des préparations afin de réaliser une réduction homothétique, en utilisant une fraise boule de diamètre connu et placée à l’horizontale de manière à bénéficier d’une butée d’enfoncement par l’intermédiaire de son mandrin.
Différentes rainures doivent ainsi être réalisées (versant interne de la cuspide vestibulaire, sillon central, versant interne cuspide palatine) (fig. 12 et 13). Cependant, si la destruction tissulaire est étendue aux cuspides support de l’occlusion, la pièce prothétique doit intégrer l’anatomie cuspidienne complète sans que cela nécessite forcément une importante préparation. Ainsi le clinicien dispose-t-il de l’information la plus précieuse afin d’éviter tout délabrement inutile.
Lors de la réalisation de ces rainures, il est important de ne pas empiéter sur les régions proximales afin d’optimiser les préparations sur le plan biologique.
– Quelles formes de préparations adopter pour les restaurations postérieures ?
Il faut préciser qu’étant donné la faible épaisseur des préparations, celles-ci peuvent être réalisées dans la majorité des cas sans pratiquer d’anesthésie. Les restaurations partielles collées ont pour vocation de protéger la dent mais aussi de recréer l’anatomie occlusale initiale qui autorisera l’augmentation de la DVO. Pour y parvenir, plusieurs options thérapeutiques ont été proposées ces dernières années. Initialement, la couronne périphérique a été pendant longtemps la solution de choix pour remplir ce cahier des charges ; ne répondant plus aux impératifs biologiques modernes, cette solution n’est aujourd’hui que rarement retenue.
Les overlays en céramique ou en composite de laboratoire ont également été utilisés ces dernières années. Ils présentent l’avantage d’une moindre mutilation tissulaire avec des limites périphériques très simples et bien audessus de la jonction émail-cément, soit des limites habituelles. Cependant, ces derniers présentaient et continuent de présenter un inconvénient majeur, à savoir la destruction des crêtes proximales afin d’assurer l’assise mécanique et de respecter les recommandations des fabricants. Des épaisseurs importantes de réduction, de l’ordre de 1 à 1,5 mm, étaient requises. Malgré le strict respect de ces dernières, il a été observé sur des suivis à moyen et long terme des fractures de cosmétique ou de matériau dans la région proximale (chiping). L’avènement des technologies CAD CAM ou des techniques de céramique pressée a sensiblement modifié ces carences mécaniques en raison d’une plus grande densité du matériau (fraisage à partir d’un bloc de céramique ou de composite) et du recours à un simple maquillage de surface.
Afin de mieux coller aux réalités biologiques et de respecter encore plus les structures résiduelles il devient aujourd’hui possible de réaliser des préparations a minima dont le but est d’obtenir :
– une préservation des crêtes proximales quand celles-ci sont présentes (la grande majorité des cas) ;
– une diminution des épaisseurs de réduction en raison d’une moindre sollicitation des restaurations (absence de tension au niveau proximal).
En effet, de par la persistance de l’architecture proximale, les crêtes continuent à jouer pleinement leur rôle mécanique. Les restaurations ultrafines à distance des crêtes se retrouvent donc à travailler uniquement en compression, ce qui est très bien toléré par les deux familles de matériaux, les composites et les céramiques (fig. 14 et 15).
Les formes de ces préparations ultraconservatrices peuvent se caractériser de la manière suivante :
– délimitation d’un rectangle dans la face occlusale à l’aide d’une fraise boule bague verte (coffret Komet LD0717) et rouge entre les fossettes proximales à 1 à 3 mm sous les sommets cuspidiens en fonction du délabrement. Dans tous les cas, la préparation devra toujours être à distance des sommets cuspidiens (en retrait) ou les englober. Les limites doivent être à distance des impacts occlusaux afin d’assurer la pérennité du joint. L’utilisation d’une fraise boule bague verte et rouge semble être une solution intéressante pour réaliser un angle net cavosuperficiel de 90° assurant la pérennité du joint. Les concepts de préparation type prepless doivent être évités, en raison de la nature de la ligne de finition entre la surface occlusale de la dent et la restauration. Le biseau ainsi créé n’aurait pas vocation à assurer la résistance mécanique nécessaire face aux impacts et aux charges occlusales (chiping, délitement, coloration). Il est donc impératif de réaliser une trace nette ;
– réduction et homogénéisation des différentes gorges à l’aide d’une fraise à inlay ;
– inclusion des cuspides palatines lorsqu’elles sont elles-mêmes érodées par l’usure pour amorcer un retour en palatin, et ce toujours dans le but d’« asseoir » la restauration dans un « cadre » stable.
La séquence de traitement
Il est fortement recommandé de traiter dans un premier temps l’arcade maxillaire, de procéder au collage des restaurations et d’utiliser comme antagoniste de référence le mock-up mandibulaire déjà validé en bouche. Une fois l’arcade maxillaire traitée, on procède de la même manière au niveau de l’arcade mandibulaire. Pourquoi une telle planification ?
Au niveau du laboratoire il est extrêmement délicat de réaliser des pièces si peu rétentives, fines sur deux arcades distinctes pour le réglage de l’occlusion notamment. On multiplie aussi les possibilités d’erreurs, donc de retouches ultérieures. Or, compte tenu de la finesse de ces dernières, il est préférable d’éviter les retouches intempestives. Le réglage se fera donc lors de la première partie (arcade supérieure traitée) au détriment du mock up en résine de la mandibule afin de préserver l’intégrité des pièces collées.
Les empreintes
Les empreintes du secteur postérieur ne nécessitent aucune précaution particulière (pas de nécessité de fil rétracteur en raison du caractère superficiel des limites). Concernant les empreintes dans le secteur antérieur, un fil rétracteur unique est mis en place sur les 10 dents antérieures (Ultrapak OOO®). Afin d’éviter les déchirements du silicone au niveau proximal, le comblement de l’embrasure palatine par une résine fluide photopolymérisable est préférable (Resin block®-Ultradent).
Temporisation
Reprenant les mêmes outils utilisés lors de la réalisation du mock-up, à savoir une clé en silicone et une résine fluide injectable (Luxatemp star®-DMG), il devient simple et rapide de réaliser cette étape. Pour des raisons évidentes de stabilisation mécanique aussi bien au niveau antérieur que restaurations provisoires sont solidarisées entre elles, en particulier au niveau postérieur car elles sont très fines ; cependant, si elles venaient à casser dans l’attente de l’insertion des pièces définitives, les cales d’occlusion en résine permettraient de les remplacer instantanément). Généralement, afin d’éviter la fracture de ces dernières lors de leur retrait pour la mise en place du scellement provisoire, il est aujourd’hui proposé d’appliquer préalablement sur les préparations séchées de l’adhésif sans mordançage, puis de le photopolymériser. Des adhésifs fortement chargés sont préconisés (Optibond FL®-Kerr).
Les provisoires, une fois en place, ne sont plus désinsérées et le praticien peut procéder, directement en bouche, aux finitions des limites à l’aide d’une fraise flamme de faible granulométrie – bague rouge – dont l’action sur la résine Bis-GMA n’est plus à démontrer. Cette approche simplifiée ne présente pas de danger sur le plan biologique en raison de la faible épaisseur des préparations (amélaire le plus souvent). Il est important de souligner que la bonne préparation des clés en silicone (coupées à la limite cervicale et rebasées au silicone light) facilite le clivage quasi parfait des excès au niveau cervical. Dans le cas de préparations dentinaires, il sera recommandé de réaliser le scellement dentinaire immédiat (Immediate Dental Sealing) préconisé par Magne et Douglas [1999] avec le même adhésif, mais précédé de l’étape de mordançage et d’application de primer afin d’obtenir une couche de protection dentinaire.
Élaboration des restaurations
Les restaurations sont réalisées, dans le cas présenté ici, en disilicate de lithium (E Max Press®-Ivoclar) en raison de son aptitude au collage, de son pouvoir mimétique et de sa simplicité de mise en oeuvre. Elles sont très légèrement sous-calibrées. Il faut noter que la nature dumatériau à adopter pour restaurer une arcade dépend du matériau ou du tissu dentaire présent au niveau de l’arcade antagoniste : on utilisera du composite si on se trouve face à de l’émail (leurs coefficients d’usure étant proches), et de la céramique si l’on se trouve face à de la céramique (fig. 16).
Mise en place des restaurations
Le collage des restaurations représente la pierre angulaire de la pérennité des restaurations,mais demeure aussi la bête noire de nombreux praticiens, inquiets suite à des échecs antérieurs (technique de collage, champ opératoire, choix de l’adhésif, choix de la pâte de collage, décollement, sensibilités postopératoires…).
Essayage des restaurations
– Mécanique : l’ajustage et la précision d’adaptation sont capitaux pour assurer la longévité de la restauration.
– Esthétique : cette étape concerne les restaurations antérieures en raison de l’impact esthétique. Pour cela, les pâtes d’essais à base de glycérine (try in), permettent de simuler la colorimétrie finale de la restauration en place et offrent la possibilité au praticien de sélectionner la teinte (Vitique veneer®-DMG) ou la luminosité et la fluorescence (Variolink veneer®, enamel HRi flow Dentin®) la plus adéquate.
Choix de l’adhésif
Les restaurations partielles présentent un avantage biologique important. Pour cela, elles s’affranchissent complètement des dogmes « mécanistes » de la prothèse traditionnelle. La rétention de ces restaurations repose donc intégralement sur la puissance du collage. C’est pourquoi les systèmes adhésifs avec un mordançage préalable doivent être retenus, car ils présentent les valeurs d’adhésion les plus élevées (All Bond Ace TE®-Bisico) (fig. 17).
Les colles
Il est préférable aujourd’hui de faire appel à des colles photopolymérisables, exclusivement pour des raisons d’esthétique, de facilité de manipulation et de meilleure stabilité optique dans le temps (contrairement aux colles chémopolymérisables). Certains auteurs préconisent l’utilisation d’un composite de restauration ; il est important de noter que la viscosité de ces matériaux nous oblige à les réchauffer préalablement afin de les fluidifier (Calset).
La finesse des restaurations partielles antérieures traditionnelles (0,5 mm) doit orienter le praticien le plus souvent vers des colles à forte luminosité afin d’assurer un soutien optique. En effet, le recours à des masses transparentes peut se révéler catastrophique, avec un effet final grisâtre. C’est pourquoi des colles à forte luminosité sont souvent requises pour optimiser la luminosité finale de la restauration (variolink veneer value + 2 ivoclar vivadent, enamel HRi flow dentine A1 mycerium).
Le champ opératoire
Depuis plus d’une décennie, le recours à une digue individuelle demeure la règle systématique de notre enseignement pour différentes raisons :
– finesse des digues actuelles (Nicton®-Bisico) qui ne trouble pas l’insertion complète de la restauration au niveau proximal ;
– concentration uniquement sur la dent à traiter et non sur les éléments périphériques (salive, joue, langue, rouleau de coton…) ;
– possibilité de microsabler les restaurations afin d’optimiser le collage (et d’éviter au patient la nocivité de l’inhalation de l’oxyde d’alumine) ;
– élimination des excès de pâte de collage plus aisée.
Le collage proprement dit
Une fois le champ opératoire mis en place (utiliser un fil dentaire pour que la digue qui a été placée sous l’ailette du crampon puisse franchir le point de contact), la dent est microsablée à l’oxyde d’alumine entre 30 et 50 microns (cela élimine l’adhésif qui a permis le collage des provisoires), puis mordancée à l’acide orthophosphorique à 37%. (Dentoprep®-Bisico). Les étapes d’application du primer et de l’adhésif sont alors réalisées (40 secondes), suivies par un séchage de surface (répétées plusieurs fois afin d’optimiser les interfaces), et une photopolymérisation d’une durée d’environ 1 minute suit.
La pièce est préparée à l’acide fluorhydrique (20 secondes), rincée, puis silanée et finalement recouverte d’adhésif non photopolymérisé. Le composite de collage est ensuite mis en place dans l’intrados de la facette et des mini-overlays. On procède à l’élimination des excès de composite, puis l’insolation est réalisée pendant 40 secondes sur chaque face à très haute intensité (supérieure à 1 000 mW/cm2, lampe Bluephase 20i)
– l’Oxyguard, visant à permettre la totale polymérisation de la première couche du matériau de collage à l’abri de l’oxygène présent dans l’air, ne se justifie que lorsqu’aucune retouche n’est à effectuer, ce qui n’est pas le cas en raison de l’élimination des excès de colle. Après dépose du champ opératoire, concernant les facettes vestibulaires, la finition au niveau cervical est réalisée à l’aide d’une lame de bistouri no 12 en traction afin de ne pas altérer le glacé de surface de la céramique.
Les vérifications de l’occlusion se font en positions statique et dynamique afin d’assurer la bonne intégration fonctionnelle de la réhabilitation. Concernant les facettes occlusales, un polissage mécanique est réalisé au niveau des marges à l’aide de fraises de faible granulométrie, puis à l’aide de pointes siliconées.
La combinaison « restauration-matériau de collage-dent » constitue un « nouveau matériau composite » d’une résistance égale à celle d’une dent.
Enfin, le recours à un éclaircissement afin d’améliorer la luminosité du sourire est effectué. Ce dernier doit être réalisé une fois le traitement terminé afin que les dents érodées soient protégées (fig. 18).
CONCLUSION
Selon Belser [2010], « le praticien d’aujourd’hui est confronté à la difficulté d’oublier les règles strictes des préparations pour prothèse conjointe pour rentrer dans un nouveau monde, celui du collage, où la préservation tissulaire devient le coeur des préoccupations ».
Le traitement de l’usure chez des patients de plus en plus jeunes représente un challenge important à relever pour le praticien. En raison des limites toujours repoussées des performances atteintes par les matériaux actuels, il devient possible de réhabiliter les dents avec un coût biologique très faible. Ce type d’approche minimaliste a pour but d’aller dans le sens d’une simplification des procédures, ce qui offre au praticien un cadre de travail précis et reproductible.
ABSTRACT
The treatment of dental wear in general and the erosion in particular has become a topical issue for about ten years. In order to check the destruction of residual tissues during restorative procedures, minimally invasive techniques have been developed. The purpose of this article is to propose, after describing several innovative concepts, a specific restoration protocol during which the preparations thicknesses are guided by the mock-up technique, stemming from a procedure combining function and aesthetics. Although this technique is revolutionary from a conceptual point of view, it is absolutely necessary to follow a strict methodology in order to optimize the prognosis of this kind of treatment.
INTRODUCTION
The treatment of tooth wear in general and erosion in particular has become a topical subject over the last ten years. Although the prevalence of the lesions has been increasing, the treatments are not always adequately codified, which sometimes makes their prognosis uncertain. Indeed, occlusal protection splints and temporary composites still play a significant role in the practitioners’ therapeutic arsenal, as well as the peripheral restorations which are often mutilating. Over the last few years however, new tooth tissue saving restoration techniques have come up, thanks to the evolution in the bonding techniques. These techniques are biologically attractive because teeth do not need to be prepared, or very little.
The purpose of this article is to propose, after describing several innovative concepts, a specific restoration protocol during which the thicknesses of preparations are guided by the mock-up technique, stemming from a procedure combining function and aesthetics.
I. WEAR AND EROSION: A PUBLIC HEALTH ISSUE
Tooth wear is independent from the microbial metabolism. It refers to any alteration of a tooth hard tissues due to a non-carious lesion. Tooth wear provokes a thickening of the free edges of the incisors and a flattening of cuspid teeth. All these morphological alterations make teeth larger and shorter.
When it abnormally extends, tooth wear alters the function and the aesthetics. The initial losses of tooth fragments then provoke morphological modifications, functional and sensorial disorders (hypersensitivity), food retentions in the cervical and interdental zones, following the collapse of marginal ridges.
Every practitioner must know how to detect these structural changes. Above all, he/she must know how to identify their etiologies in order to slow down their development, avoid recurrence and improve the prognosis of the planned treatments. Besides, the differential diagnosis of the various tissue changes must be clearly made, before starting any restorative treatment.
The erosive wear (acid attack) is currently one of the major public health issues, in particular in young people who often « over consume » sodas and/or sometimes suffer from eating, disorders or fromawake and/or sleep bruxism. Although widely reported in the scientific press and the media, this problem is not always grasped by the odontologists who often provide superficial solutions, that seldom take into account the underlying causes of the process. These are generally damaging solutions, whereas they should be minimally invasive (Lussi and Jaegi, 2012).
II. TREATMENT OF THE ADVANCED EROSIVE LESIONS: CONCEPTS UPDATE
Still a few years ago, patients suffering from an important erosive wear received emergency treatments (occlusal splints, small composite restorations), or were treated with very mutilating solutions (peripheral restorations to recreate aesthetics and function, with the short and medium-term risk of fractures of the cosmetic materials or the tooth itself).
This approach is now obsolete since it is recommended to postpone for as long as possible the invasive treatments in order to avoid damaging the teeth connective tissues, whether the patient is young or old. For that purpose, since the end of the 2000s, new perspectives have been developed that considerably changed the « traditional » treatments of the erosive lesions, which were not very conservative (Vailati et al., 2008a, b, c; Spreafico, 2010, Dietschi and Argente, 2011; Fradeani et al, 2012).
Several classifications were thus suggested; the most relevant allows to adapt the nature and the shape of the restorations to the recorded tissue loss. This classification named ACE (Anterior Classification of Erosion) by Vailati and Belser (2010), is a real clinical tool which allows the practitioner to correlate the level of tissue destruction (high, average or low) with a certain type of restoration. The treatment is innovative, it also is predictable and reproducible. It uses the latest advances in the field of adhesives and biomaterials (CAD CAM manufacturing process, with ceramic or composite blocks, pressed ceramic, etc.), thus optimizing the mechanical and aesthetic performances of the restorations.
Indeed, according to Magne and Belser (2003), the development of the adhesive dentistry has considerably changed the practitioner’s way of thinking: “the tooth and the tissue preservation are now the central focus of our concerns instead of the necessity to adapt these to the specificities of the chosen materials. Biology finally becomes the main pillar of this new era”.
III. TECHNICAL PROCESS
The “three-step technique” (Vailati et al. 2008a, b, c) is probably the most emblematic restoration technique for the erosive lesions, because of its systematization. As usual, it is important to wonder whether what seems ideal and simple in theory remains so in the practical field, meaning it can be performed by the majority of the practitioners. The purpose of this study, based on this specific technique, is to simplify the procedures in order to make it easier to perform.
THE « THREE-STEP TECHNIQUE » PRINCIPLES
This technique features three main stages:
– Stage 1. Reconstruction of the affected occlusal anatomy in order to restore the new vertical dimension of occlusion (VDO) and the aesthetics. For that purpose, a mock up allows to materialize the final reconstruction. The project validation (aesthetic and functional integration) may take from one to six weeks. The basic restorations are performed later, during the following session.
– Stage 2. Reconstruction of the posterior sectors, starting with the maxilla and then the mandible, using splints directly placed in mouth, filled with composite according to the direct method, in order to facilitate the creation of a new anterior guide. As for the previous teeth, palatal composite and/or ceramic facets are made with the indirect method.
– Stage 3. Restoration of the anterior aesthetics with vestibular ceramic-bonded partial restorations after the occlusal adjustment (posterior and anterior adjustments).
ASSESSMENT OF THE NEW ADEQUATE VDO
In most cases, the VDO is increased in order to reconstruct the occlusal morphology on a proper thickness as well as to avoid an excessive mutilation of dental tissues. The aesthetic motive for this increase is seldom taken into account. Indeed, for most of the patients suffering from severe tooth wear, it is rare to note a facial disharmony, because the dental and alveolar extrusions generally compensate for the wear. In patients suffering from a decrease of the VDO due to a severe awake and/or sleep bruxism, tooth wear may only affect specific sectors, but the therapeutic decisions have to include the coronal reconstruction of all the teeth. Indeed, there is no suitable fragmented approach (Molina et al. 2003). This new VDO is directly defined in mouth in an empirical way using a resin Lucia JIG placed between the arches in the anterior sector which enables to create the conditions for a reconstruction of the posterior teeth by creating the adequate interocclusal space. We must keep in mind that the reconstruction of the posterior sectors with the direct technique remains a difficult stage of the treatment.
SIMPLIFIED APPROACH
The main purpose of this article is to propose a simplification of the » three-step technique », by using proven educational tools, while sticking to its guidelines. Once the wax-up has been made in the laboratory, several questions arise:
– How can we reliably put it in mouth?
– How can we assess the adequate depth of the preparations in the posterior sectors?
– What shape must we give to the preparations?
To answer these three questions and describe our new therapeutic approach, we are going to use a clinical case.
IV. CLINICAL APPLICATION
A. CASE DESCRIPTION
A 25-year-old patient comes to a consultation for a functional problem (“my teeth are sensitive to heat and cold”) as well as an aesthetic issue (“my teeth are yellow and I don’t like my smile”) (fig. 1 and 2). She is also aware that her teeth wear out due to grinding, at night and during the day. A history of anorexia and bulimia is also highlighted during the anamnesis. She does not want her teeth to be prepared, or very little and she refuses crowns requiring mutilating peripheral coronal preparations.
The clinical examination shows a slight wear on the vestibular faces of the anterior teeth, with an abrasion of the free edges of the lower and upper maxillary incisor-canine block at the origin of the aesthetic complaints (fig. 3). The palatal and lingual faces show important erosive strips with considerable destructions of the palatal enamel. Occlusal faces of the posterior teeth are alsoworn outwith areas of visible dentin (fig. 4). The enamel has totally disappeared in certain zones, but the structural integrity of the posterior teeth remains however decent (fig. 5).
The occlusal examination in static and dynamic positions shows a normal canine function and propulsion. The look of the smile shows no specific anomaly.
B. TREATMENT PLAN
Restoration of the lower and upper maxillary arch by recreating a perfect occlusal palatal anatomy; this will be possible thanks to a slight increase of the VDO to create the spatial conditions necessary to the restoration of the anterior palatal morphology. This proposal was accepted and validated.
C. TREATMENT TECHNIQUE
Previsualization and validation by the patient (Gürel and Bichacho, 2006; Magne and Belser, 2004; Magne and Magne, 2008).
Before making any diagnosis and choosing any therapeutic plan, it is necessary to record the position of the maxillary in relation to the face in order to report on the initial work model from which the wax up will be made, the two main aesthetic marks of the face, i.e the bi-pupillary and the medial axis. For that purpose, a recently marketed device, the DITRAMAX®, is used (Margossian et al. 2010, 2011). With this tool, it is almost impossible to make mistakes during the creation of the new contour of the smile.
Then, alginate impressions are made in order to manufacture a wax up intended to recreate the ideal anatomy of the posterior teeth as well as the ideal morphology of the anterior teeth (fig. 6).
Wedges in composite resin are then placed in the patient’s mouth, on each side, in the posterior zones in order to successively assess the usable height during the preparations. Another approach consists in reconstructing freehand the initial palatal anatomy with composite in order to record the entire occlusion from this depth stop that is the new palatal face. Once these occlusal stops are made, it is important to record the new VDO created to restore a natural morphology with a silicone bite registration. This will be helpful to position both arches on the articulator in order to make the maxillary and mandibular wax up within the newly recreated occlusal space. The wax-up manufactured by the technician is a key element because it determines all the stages of the future restorations, posterior and anterior.
Indirect mock up
A silicone key is made from the wax-up in the dental office. It must be as enveloping as possible and lean on the alveolar edges and the palate to have a depth stop during its insertion in mouth; if we do not take care of this stability, it will be difficult for the practitioner to exercise the required pressure on the key, which may either lead to its crushing against the existing teeth or to an excessive space between both.
The silicone key is filled with an injectable chemopolymerizable resin Bis-GMA (Luxatemp Star® – Dmg), for the aesthetic properties of this material as well as its ease of use (fig. 7).
Selective grinding is often performed on the mock-up obtained after the removal of the key in order to get the most stable occlusion, even though a wax-up and an assembly on the articulator were previously performed. These adjustements do require the practitioner’s attention during a few minutes but they are essential to the following stages of the treatment (fig. 8).
Another difficulty inherent to this type of rehabilitation remains the stabilization of the resin mock-up during the testing period which can last several weeks. This patient’s parafunctional habits associated with the absence of preparation of the teeth exponentially increased the difficulty to keep the devices in place.
In the posterior sectors, it is then suggested to solidarize the molars and premolars sectors for a better stabilization (fig. 9). That is why etching is performed and an adhesive is used on the occlusal faces to optimize the retention of the posterior mock-up later.
On the other hand, the silicone key used to make the mock-up must be made with a heavy silicone and then a lightweight silicone (wash technique) on the wax-up to improve the accuracy of the anatomy and help eliminate excesses in the cervical zone. The resulting mock-up is extremely accurate. The aesthetic and functional integration is validated by the patient (fig. 10).
Over the last few months, a new generation of rigid splints with an easier intraoral insertion has been marketed, providing a great accuracy of the mock-up, both functional and aesthetics. Once made on the model, the wax-up is scanned. It is then displayed on a computer screen and a splint is designed, first virtually then manufactured with a 3D printer (Intelligence Origin Corporation, USA). A relining with light silicone is then performed. The friction created on the vestibular and palatal faces thus provide a unique position of insertion [fig. 11].
D. DENTAL PREPARATIONS
They must meet the principle of tissue preservation because reconstruction is often additive to make up for the slight loss in VDO that the alveoli-dental extrusion could not compensate for.
– Anterior preparations
Aiming at reducing the extension of the preparations as well as the biological cost (Edelhoff and Sorensen, 2002) various techniques were proposed. The preparations of vestibular facets are now perfectly codified. They use a mock-up as a preparation guide. In this particular case, the loss of vestibular substance in the anterior sector being slight, the preparations consist in a simple surface roughening in order to keep the continuity and the stability of the palatal facet. As for the palatal face, a small hole – and nothing more – will be drilled in the middle of the cingulum to stabilize the restoration during bonding.
– Posterior preparations
The practitioner must answer two questions when the mock-up is placed in mouth and validated.
How deep must the bur go ?
As for the posterior preparations, we can use the method described by Gürel (2003, 2005). It is based on the reduction of the mock-up while placed on teeth. Indeed, it seems best to keep it in place during the preparation stage in order to perform a homothetic reduction, by using a round bur of a specific diameter and placed horizontally in order to have a depth stop through its chuck. Several grooves must then be made (inner side of the vestibular cuspid, central furrow, inner side of the palatal cuspid) (fig. 12 and 13).
However, if the tissue destruction has spread to the cuspids bearing the occlusion, the prosthetic part has to integrate the complete cuspid anatomy without necessarily requiring considerable preparation.
The clinician has thus the most precious information to avoid any unecessary decay. When making these grooves, it is important not to encroach on the proximal zones to biologically optimize the preparations.
What kind of preparations should be performed for the posterior restorations?
It is necessary to underline that, given the small thickness of the preparations, most of them can be performed without anesthesia.
Bonded partial restorations are made to protect the tooth but also to recreate the initial occlusal anatomy that will allow the increase of the VDO. To reach this goal, several therapeutic options have been proposed over the last few years. Initially and for a long time, the peripheral crown had been the best option to meet these requirements; however, since it cannot meet the new biological requirements, this option is now rarely chosen.
Laboratory ceramic or composite overlays have also been used over the last few years. They ensure a smaller tissue mutilation with very simple peripheral limits located far above the cemento-enamel junction, i.e the usual limits. However, these inlays still feature a major drawback, that is the destruction of the proximal crests in order to ensure the mechanical basis and to follow the manufacturers’ recommendations.
Considerable thicknesses of reduction -from1 to 1, 5mm were required. Even when complying with the required thicknesses, medium and long-term follow-ups showed some fractures in cosmetics or material in the proximal region (chipping). CAD/CAM technologies as well as the pressed ceramic techniques considerably made up for these mechanical failures thanks to a higher density of the material (milling from a ceramic or composite block) and to a simple surface retouching.
In order to stick closer to the biological realities and take a greater care of the residual structures, it is now possible to perform minimal preparations aiming at:
– Preserving proximal crests when they exist (in a great majority of cases)
– Lessening thicknesses of reduction due to a smaller stress of the restorations (no tension in the proximal sector)
Indeed, due to the persistence of the proximal architecture, crests can keep on playing fully their mechanical role. Consequently, the ultra-thin restorations remote fromcrests turn out to work only in compression, which is very well tolerated by both materials families, composites and ceramics (fig. 14 and 15).
Here are the main specificities of the shapes of these ultra preservative preparations:
– Delimitation of a rectangle in the occlusal face with a round bur, green “ring” (Komet Kit LD0717) and red “ring” between the proximal dimples, 1 to 3 mm under cuspid crests depending on the decay. In any case, the preparation must always keep its distance from the cuspid crests (set back) or include them. The limits must be remote from the occlusal impacts in order to guarantee the durability of the joint. The use of a round bur with green and red rings seems to be an interesting solution to perform a clear 90° cavosurface angle providing the durability of the joint. Preparation concepts such as “prepless” must be avoided because of the nature of the finish line between the occlusal surface of the tooth and the restoration. The bevel thus created would not be able to provide the necessary mechanical resistance to impacts and occlusal loads (chipping, splitting, coloring). It is thus necessary to make a precise line.
– Reduction and homogenization of the various grooves with a bur for inlay.
– Inclusion of the palatal cuspids when they are also affected by the wear to initiate a return to palatal, still for the purpose to “build” the restoration in a stable “frame”.
Treatment sequence
It is strongly recommended to start treating the maxillary arch and bind the restorations first and use the mandibular mock up already validated in mouth as the reference antagonist. Once the maxillary arch is treated, we can carry out exactly the same process on the mandibular arch. Why do we choose such a treatment planification?
In a laboratory, it is extremely difficult to make parts that are so thin and not very retentive on two different arches particularly for the occlusal adjustment. We also multiply the possibilities of errors and thus of retouching. Besides, considering the necessary accuracy of retouching, it’s better to avoid inconvenient alterations. The adjustment will thus be made during the first part of the treatment (when the superior arch is treated) to the detriment of the resin mock up of the mandible in order to protect the integrity of the bonded parts.
Impressions
The impressions of the posterior sector do not require any specific precaution (it is not necessary to use a retraction thread because of the superficial characteristic of the limits). As for the impressions in the previous sector, a single retraction thread is placed on the ten anterior teeth (Ultrapak OOO®). To avoid tearings of the silicone in the proximal sector, the filling of the palatal embrasure with a photopolymerizable fluid resin is recommended (Resin block®- Ultradent).
Temporization
Taking the same tools used to make the mock up, i.e a silicone key and an injection fluid resin (Luxatemp star® – Dmg), this stage can be performed quickly and easily.
For obvious reasons of mechanical stabilization, both in the anterior and posterior zones, it is important to preserve the monoblock aspect of the temporary (temporary restorations are solidarized in particularly in the posterior zone because they are very thin; however, should they break before the insertion of the definitive parts, the occlusal wedges in resin would allow to replace them immediately). To avoid fractures of the latter during their removal to perform the temporary sealing, it is now generally suggested to apply beforehand a non-etching adhesive on dried preparations, and then photopolymerize it. High-load adhesives are recommended (Optibond FL® – Kerr).
Once placed, the temporary teeth are not disinserted and the practitioner can, directly in mouth, finish the margins using a flame bur with a low grain size – red ring; its action on the bis-gma resin is now well-known. This simplified approach is not biologically hazardous because of the small thickness of the preparations (mostly enamel). It is important to underline that an adequate preparation of the silicone keys (cut on the cervicalmargin and rebased with light silicone) facilitates an almost perfect cleavage of the excesses in the cervical zone. In the case of dentin preparations, it is better to perform an Immediate Dental Sealing recommended by Magne and Douglas (1999) with the same adhesive but preceded by the etching stage and the application of primer in order to obtain a dentin protection coating.
Elaboration of the restorations
In the present case, the restorations are made with lithium disilicate (E Max Press® – Ivoclar) because of their bonding properties, their mimetic ability and their easy use. They are very slightly under calibrated. It is important to note that the nature of the material used to restore an arch depends on the material or on the existing dental tissue on the antagonist arch: we will use composite when there is enamel opposite (their wear coefficients are close) and ceramic when there is ceramic opposite (fig. 16).
Placement of the restorations
Bonding is the key to the durability of restorations but it is also themost challenging stage to practitioners who may be anxious after several previous failures (bonding technique, operative field, choice of the adhesive, choice of the bonding paste, loosening, post-operative sensitivity…).
Fitting of the restorations
– Mechanical fitting: the adjustment and the fitting accuracy are major factors to ensure the longevity of the restoration
– Aesthetics: this stage deals with the previous restorations because of the aesthetic impact. Glycerin try-in pastes enable to simulate the final colorimetry of the restoration in place and allow the practitioner to select the most adequate color (Vitique veneer® – Dmg,) luminosity and fluorescence (Variolink veneer ®, enamel HRi flow Dentin®).
Choice of the adhesive
Partial restorations have a considerable biological advantage. For that purpose, they are totally free from the « mechanistic » doctrine of traditional prosthesis. The retention of these restorations is thus entirely based on bonding strength. That is the reason why adhesive systems with preliminary etching must be used because they have the highest bond strength (All Bond Ace TE®-Bisico) (fig. 17).
Adhesives
Nowadays, it is better to use photopolymerizable adhesives, particularly for reasons of aesthetics, their ease of manipulation and their higher optical stability in time (unlike chemopolymerizable adhesives). Some authors recommend the use of a restoration composite; it is important to note that, due to the viscosity of these materials, it is necessary to warm them before fluidifying them (Calset).
The thinness of the traditional anterior partial restorations (0,5mm) generally leads the practitioner to use adhesives with a high luminosity in order to provide an optical support. Indeed, the use of transparent masses may be disastrous with a greyish final effect. That is why adhesives with a high luminosity are often required to enhance the final luminosity of the restoration (variolink veneer value + 2 ivoclar vivadent, enamel HRi flow dentin A1 mycerium).
The operative field
For more than a decade, the use an individual dam has been the systematic rule in our practice for various reasons:
– The thinness of the current dams (Nicton® – Bisico) does not hinder the complete insertion of the restoration in the proximal zone.
– The focus is only on the tooth being treated and not on the peripheral elements (saliva, cheek, tongue, cotton roll…).
-Micro sandblasting the restorations can be performed to optimize the bonding (and to prevent the patient from inhaling the toxic fumes of aluminium oxide).
– Eliminating excesses of bonding paste is easier.
Bonding per se
Once the operative field is ready (use dental floss so that the dam which is placed under the coffer dam clamp can go over the contact point), the tooth is micro sandblasted with aluminium oxide 30 to 50 microns (the process eliminates the adhesive bonding the temporary teeth) then etched with 37% orthophosphoric acid. (Dentoprep® – Bisico).
The primer and the adhesive are then applied (40 seconds), followed by a surface drying (the different stages are repeated several times to optimize the interfaces). A photopolymerization lasting about 1 minute then follows.
The part is prepared with fluorhydric acid (20 seconds), rinsed, silanized and finally covered with some non photopolymerized adhesive. The bonding composite is then poured in the intrados of the facet and the mini overlays. It is necessary to eliminate excesses of composite and then insolation is performed during 40 seconds on each face with very high intensity (superior to 1000mW/ cm2, Bluephase Lamp 20i) – (the Oxyguard enabling the total polymerization of the 1st coat of the bonding material shielded from the oxygen present in air can be used only when no retouching is necessary which is not the case because of the elimination of adhesive excess ). After the operative field has been removed and as for the vestibular facets, the finish in the cervical zone is made with a bistoury blade n° 12 exerting traction so that the glazed surface of the ceramic is not altered.
The assessment of the occlusion is made in static and dynamic positions in order to provide a proper functional integration of the rehabilitation. As for the occlusal facets, a mechanical polishing is performed around the margins with burs with a small grain size and then with silicone tips.
The combination “restoration-bonding material-tooth” turns out to be a “new composite material” as strong as a tooth.
Finally, a whitening is performed to improve the luminosity of the smile. This must be done after the treatment is completed so that the eroded teeth are protected (fig. 18).
CONCLUSION
According to Belser (2010), “today’s practitioner has to face a considerable difficulty: he has to forget the strict rules of preparations for fixed prosthesis to enter a new era, the era of bonding, where tissue preservation is at the core of all concerns.”
The treatment of tooth wear in younger and younger patients is a challenge the practitioner must complete. As the limits are continually pushed by the performances
of the current materials, it becomes possible to rehabilitate teeth with a very low biological cost. This type of minimalist approach aims at a simplification of the procedures, providing the practitioner a precise and reproducible working environment.
LABORDE G., ANDRIEU P., MAILLE G., SETTE A., NIBOYET C., FERDANI A., MARGOSSIAN P.
ROS – SEPTEMBRE 2014; Rev Odont Stomat 2014;43:132-148
RÉSUMÉ
Ce rapport de cas illustre le traitement d’un cas d’usure d’origine intrinsèque ainsi que son approche décisionnelle, clinique et technique qui se veulent modernes :
1. L’élaboration du projet morpho-fonctionnel puis sa validation clinique par le patient et l’équipe soignante, avant toute intervention, son influence bénéfique tout au long du traitement.
2. La préservation tissulaire et principes adhésifs utilisés, les vitrocéramiques renforcées et mordançables.
3. Un choix d’outils, de techniques et de procédures toujours, simples, efficaces et fiables.
4. L’importance de qualité de la communication avec le laboratoire. In fine, cette approche moderne permet la fusion entre équilibre neuro-musculo-articulaire (fonction et économie d’énergie) et équilibre du sourire, au sein du visage (esthétique et économie tissulaire).
INTRODUCTION
La dernière décennie du 20ème siècle fut, dans le domaine de la Dentisterie Restauratrice et de la Prothèse Fixée, celle de divers développements :
1. Des phénomènes d’adhérence sur les tissus dentaires minéralisés, mais aussi sur les surfaces prothétiques métalliques, composites et céramiques (von fraunhofer JA. 2012 ; Marshalla SJ. et coll à paraître).
2. Des matériaux céramiques à matrice vitreuse renforcée à la leucite (Empress®), au disilicate de Lithium (Emax) et aux céramiques de haute ténacité capable de jouer le rôle d’infrastructure pour soutenir la céramique cosmétique de stratification,maillon faible des systèmes céramo-céramiques (Laborde G. et coll 2004).
3. De l’ostéointégration en implantologie offrant des solutions à tous types d’édentement grâce à des racines artificielles d’une fiabilité remarquable, faisant reculer les principes mutilants de la Prothèse Fixée traditionnelle pour le remplacement des dents absentes (Degidi M. et coll 2013).
4. De la Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) directe et indirecte, aux possibilités de productions diverses, par fraisage, prototypage rapide, stéréolithographie, frittage de poudre, capable d’offrir au plus grand nombre une grande précision des pièces prothétiques que seuls, les meilleurs artisans étaient capables de fournir (Ender A. et coll 2011 ; Seelbach P. et coll 2013).
La première décennie du 21e siècle est celle de l’exploitation clinique de tous ces développements au service des patients et des praticiens, vers une dentisteriemodernemini-invasive adhésive, privilégiant la préservation tissulaire, et faisant reculer la dépulpation (Belser U. 2010 ; Brabant A. 2010 ; Lafargue H ; 2010), “la quasi disparition des tenons et ancrages coronoradiculaires ainsi que la suppression des couronnes unitaires de « première intention », en replaçant ainsi leurs indications actuelles dans le cadre de la ré intervention prothétique” (Tirlet G., Bazos P. 2013).
Le but de ce rapport de cas est d’illustrer une approche décisionnelle moderne, clinique et technique, prenant en compte le projet morphofonctionnel, la préservation tissulaire et les principes adhésifs pour aboutir à une restauration recherchant la fusion entre équilibre neuro-musculoarticulaire (fonction et économie d’énergie) et équilibre du sourire au sein du visage (esthétique et économie tissulaire).
1. LA SITUATION CLINIQUE INITIALE
Mme G. est âgée de 60 ans. Ancienne sportive de haut niveau, son anamnèse ne présente aucun problème de santé générale à ce jour. À l’interrogatoire, elle signale de nombreux épisodes de vomissements remontant à l’époque de ses compétitions.
La consultation est motivée par le descellement récurrent de couronnes antérieures et une demande de restaurations plus appropriées pour améliorer son sourire.
1A. EXAMEN CLINIQUE DE LA SITUATION INITIALE
Vue de face en occlusion (fig. 1a), 11, 12 et 21 sont couronnées et présentent des problèmes parodontaux inflammatoires et des diastèmes. Il existe une forte usure d’abrasion des dents maxillaires, très accentuée au niveau des postérieures droites. Toutes les couronnes cliniques sont courtes.
À l’ouverture de la bouche (fig. 1b), les dents mandibulaires du secteur droit sont très égressées, et 41 et 42 sont en position vestibulée. Elles ne présentent pas de phénomène usure d’abrasion notable. 46 et 47 sont couronnées, et un bridge traditionnel remplace 36 par deux ancrages périphériques sur 35 et 37. Les autres dents mandibulaires sont indemnes. Les dents maxillaires présentent des érosions occluso-palatines sévères, sur toute l’arcade, différenciées du secteur antérieur vers les secteurs postérieurs (fig. 1c). Au niveau des secteurs prémolaires et canines les érosions palatines vont jusqu’au niveau gingival. Mis à part 11, 12 et 21 couronnées, présentant des diastèmes et des problèmes parodontaux inflammatoires, les dents maxillaires sont exemptes de carie ou de restauration.
L’examen par palpation musculaire et articulaire (diagramme de Farrar) est normal. Il n’existe pas de problèmes de Dysfonctionnement de l’Appareil Manducateur (DAM).
1B. EXAMEN RADIOGRAPHIQUE PAR CLICHÉS RÉTROALVÉOLAIRES
11, 21, 46 et 47 sont des Coiffes Céramo-Métalliques (CCM) unitaires sur dents dépulpées porteuses de Reconstitutions Corono-Radiculaires (RCR) métalliques coulée. 22 est pulpée et coiffée (CCM), tandis que 35 et 37 ont les piliers pulpées d’un bridge CCM remplaçant la 36.
Les lésions érosives sont nettement visibles sur les clichés maxillaires. Sur le plan endodontique, 47 présente une image radio-claire au niveau de la racine distale, et 21, une image de résorption interne sur la partie mésiale de sa racine.
1C. DIAGNOSTIC
Du point de vue diagnostique, le décalage transversal important entre les
milieux inter-incisifs est du à l’agénésie de l’incisive latérale droite et non
à un problème intra-articulaire ou une dysmorphie de la mandibule.
Nous avons affaire à des érosions intrinsèques, uniquement maxillaires,
différenciées du secteur antérieur vers les secteurs postérieurs, et sans
érosionsmandibulaires, caractéristiques de vomissements acides récurrents
(boulimie nerveuse). De plus, 11, 12, 21, ont été couronnées postérieurement
à la période des régurgitations acides car le matériau céramique palatin
reste intact. Soumises à inflammation parodontale avec perte d’attache, à
l’évolution des destructions érosives par usure dentinaire et à une perte de
Dimension Verticale d’Occlusion (DVO), elles ont donc migré avec l’apparition
de diastèmes.
Du point de vue pronostique, l’arrêt des vomissements est une condition sine qua non à l’indication de matériau céramique pour toute restauration.
2. ANALYSE ESTHETIQUE ET FONCTIONNELLE DE LA SITUATION INITIALE
2A. ANALYSE ESTHÉTIQUE INITIALE DU SOURIRE
L’examen esthétique du visage se fait grâce à la photographie du visage, patiente debout, regardant l’objectif de l’appareil. Il fige sur des images la dynamique labiale du sourire et du rire au sein du visage pour observer, lister et classer les problèmes à résoudre.
Pendant le sourire
– Les dents maxillaires ne sont pas visibles (fig. 2a).
– La Ligne Bi-Commissurale (LBC) n’est pas tout à fait parallèle à la Ligne Bi-Pupillaire (LBP).
– Les lèvres sont d’épaisseur moyenne.
Pendant le rire
– La ligne du sourire est disharmonieuse (fig. 2b).
– Les milieux interincisifs sont décalés.
– Le milieu interincisif maxillaire est oblique.
– Les dents sont courtes.
– Les lèvres sont fines.
2B. ENREGISTREMENT ET TRANSFERT AU LABORATOIRE DES RÉFÉRENCES ESTHÉTIQUES DU VISAGE
Les références esthétiques du visage, la LBP et Ligne Médiane (LM), et le Plan de Camper (PC) sont enregistrés à l’aide d’un dispositif conçu à cet effet, le Ditramax® (Margossian et coll 2010 ; Margossian et coll 2011) (fig. 3a, 3b). Grâce à un guide de marquage fixé au cadre du système, les références esthétiques du visage peuvent être transférées sur le modèle d’étude maxillaire en plâtre (fig. 3c). Au sein du modèle maxillaire, il devient tout à fait possible d’évaluer la concordance ou l’incohérence de la ligne des collets et/ou de la courbure incisive qui doivent être sensiblement parallèle à la LBP pour suggérer l’harmonie du sourire et du rire (fig. 4).
2C. ANALYSE FONCTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE DES MODÈLES INITIAUX
Ainsi indexé aux références esthétiques du visage, le modèle d’étude maxillaire est monté sur un articulateur ASA avec un arc facial. Ainsi l’analyse occlusale instrumentale fonctionnelle prend en compte les critères esthétiques du visage (fig. 5).
3. ÉLABORATION ET VALIDATION DU PROJET MORPHO-FONCTIONNEL
Le projet morpho-fonctionnel et sa validation, dans le sourire, au sein du visage du patient est la phase capitale du traitement car elle va en contrôler toutes les étapes, de la calibration des préparations pour la meilleure économie tissulaire, en passant par la réalisation des prothèses transitoires qui doivent être une proposition fonctionnelle et esthétique aboutie, facilitant l’élaboration des prothèses d’usage.
3A. ÉLABORATION DU PROJET MORPHO-FONCTIONNEL
Elle dépend des objectifs fixés pour la reconstruction suite à une démarche intellectuelle spécifique à la résolution des problèmes listés tout au long de la phase diagnostique et faisant intervenir les thérapeutiques proprothétiques associées. La démarche devient morphologique (wax-up) en prenant en compte les objectifs architecturaux de la reconstruction.
Il est nécessaire d’augmenter la Dimension Verticale d’Occlusion (DVO) et de la quantifier au niveau de la tige incisive. Pour cela, il faut :
• Situer la position du bord libre de l’incisive centrale grâce à la dynamique labiale de la position de repos au rire forcé.
• Respecter les proportions de l’incisive centrale (Rapport largeur/ Longueur = 75 à 85 %) puis les proportions dento- dentaires.
• Limiter le surplomb et le recouvrement.
• Créer de l’espace.
– Pour limiter la mutilation amélaire et/ou dentinaire.
– Pour favoriser une adhésion forte à l’émail.
Dans ce cas clinique, l’augmentation de la DVO au niveau de la tige incisive est estimée à 5mm (« Règles des tiers ») (Orthlieb JD. 2002). La position du bord libre de l’incisive centrale devient capitale sur le plan architectural. Il est absolument nécessaire de réviser sa place dans les critères de reconstruction occlusale d’une réhabilitation prothétique buccale (Orthlieb JD. et coll, 2001). Il faut lui donner la primeur, donc une place avant les critères architecturaux de la mandibule pour l’établissement du plan d’occlusion, et probablement avant le choix de la position de référence, toujours discuté à ce jour (OIMversus Relation Centrée (RC) versus Position de Déglutition sur le chemin de Fermeture (PDF)) et la position de thérapeutique (Occlusion de Relation Centrée (ORC) versus Antéposition à partir de la RC, OIMsur le chemin de fermeture de fermeture en déglutition).
Le projet morpho-fonctionnel est élaboré par addition de cire après avoir mis de dépouille, sur le modèle, la morphologie de 11, 21, et 22. Avant le transfert du projet morpho-fonctionnel, nous avons pris soin de déposer 11, 21, 22 et repris ou fait les traitements endodontiques et la thérapeutique initiale parodontale. Ceci a permis de supprimer toute interférence avec la morphologie des dents initiales et a réduit l’inflammation parodontale.
3B. VALIDATION FONCTIONNELLE ET ESTHÉTIQUE DU PROJET MORPHO-FONCTIONNEL
Le projet morpho-fonctionnel est transféré in situ sur la patiente grâce à une clé en silicone et de la résine composite pour provisoire autopolymérisable (fig. 6a et 6b). Une analyse esthétique et fonctionnelle du sourire, au sein du visage, est réalisée et validée grâce à un « mock up » proposée à la patiente (fig. 7).
Cette validation va permettre la production de tous types de guide (pour les préparations, la chirurgie parodontale ou la mise en place d’implant) et la réalisation de prothèses transitoires de deuxième intention.
4. ÉTAPES CLINIQUES ET COMMUNICATION AVEC LE LABORATOIRE
4A. ÉTAPES PRÉLIMINAIRES
Après retour aux informations pour corriger les défauts d’hygiène et suite a la validation clinique du projet morpho-fonctionnel, les traitements endodontiques sont repris (11, 21) ou réalisé (22) ainsi que les fauxmoignons. Le traitement parodontal d’assainissement est développé et amène une nette amélioration de la situation gingivale avec un repositionnement de la gencive marginale compatible avec un rapport largeur/longueur des incisives centrales cohérent (75 à 85 %). La réalisation des restaurations postérieures (« overlays » en vitro céramique Emax® sur 16, 17 et coiffes 46, 47 avec infrastructure zircone puis « overlays » en vitro céramique Emax® sur 26, 27 et bridge 35 à 37 avec infrastructure zircone, le tout avec conservation de la vitalité pulpaire) est mené à bien en deux étapes successives dans la nouvelle OIMavec des moyens simples. Les empreintes d’arcades complètes sont associées à un enregistrement par table occlusale sur les préparations, le tout monté sur un articulateur avec une table de montage.
4B. LES PRÉPARATIONS PÉRIPHÉRIQUES CONVENTIONNELLES VS LES PRÉPARATIONS ADHÉSIVES
Les préparations périphériques traditionnelles pour une CCM ou une CCC nécessitent des épaisseurs vestibulaires minimales (fig. 8a) :
– de 1 mm jusqu’à 1,4 mm au niveau cervical,
– de 1,5 mm au niveau médian,
– de 1,5 à 2mm au niveau incisif ou occlusal.
Les préparations périphériques adhésives nécessitent seulement 0,8 mm pour assurer la résistance à long terme après collage les Restaurations Adhésives Céramiques (RAC) de type « Full Emax® » (fig. 8b et 8c). Les préparations postérieures de type « overlays » ont des limites largement supra-gingivales et favorisent l’économie tissulaire (fig. 8d).
Le projet morpho-fonctionnel validé dirige les préparations grâce à la technique de pénétration contrôlée et des guides de coupe en silicone, favorisant ainsi l’économie tissulaire (Laborde G., Lasserre JF., 2010 ; Lasserre JF., Laborde G., 2010).
Les limites cervicales amélaires garantissent l’adhésion forte des céramiques vitreuses. L’hybridation du tissu dentaire suite aux préparations permet de fermer la plaie dentinaire (Magne P, Belser U., 2003 ; Koubi S. et coll, 2010) Ces préparations peuvent être partielles et pérennes (facette antérieure ou « table top » postérieure) et mettent en valeur la dentisterie adhésive mini invasive (Edelhoff D., Sorensen JA. 2002 ; Laborde G., Lasserre JF., 2010 ; Lasserre JF., Laborde G., 2010 ; Lafargue H., 2010).
4C. EMPREINTES ET MODÈLES
Pour des limites para-gingivales ou intrasulculaires, l’accès au sulcus est assuré par la technique du double cordonnet. La prise d’empreinte utilise la technique 1 temps/2 viscosités aux élastomères, polyvinylsiloxanes (PVS) ou polyéthers (fig. 9a) (Laborde et coll, 2010).
Afin de pouvoir couler plusieurs modèles issus de la même empreinte sans détériorations des informations de celle-ci, de la cire est placée sur la partie externe de la rétraction gingivale (fig. 9b) (Laborde et coll 2010). Cette technique évite le déchirement du matériau silicone dans la réplique en plâtre du sillon gingival lors du démoulage. Au moins deux modèles sont ainsi coulés, un maître modèle et un modèle de secours.
La mise en évidence des limites cervicales est inutile car elles sont parfaitement lisibles, sans détourage. Puis la cire est supprimée de l’empreinte à la vapeur afin de pouvoir couler un modèle avec l’intégralité du parodonte marginal en plâtre. La cire peut rester sur le modèle (fig. 9c). Sa suppression à la vapeur permet la mise en évidence des limites cervicales, sans danger pour l’intégrité de celles-ci lors du détourage. Il est capital de conserver la partie non préparée de l’anatomie naturelle du pilier. Cette anatomie non préparée permet d’organiser le profil d’émergence de la restauration dans la continuité du profil naturel de la dent.
Souvent la cire reste dans l’empreinte après coulée du premier modèle, il est alors possible de doubler ce modèle. La suppression à la vapeur permet de couler l’empreinte en définissant sur le modèle l’intégralité du parodonte marginal pour servir de modèle « fausse gencive en plâtre », ou de modèle de secours (Laborde et coll 2010).
Le maître modèle préparé sert à la réalisation des pièces prothétiques (fig. 10a). Il est indexé aux références esthétiques du visage. La séparation desModèles Positifs Unitaires (MPU) est faite selon l’axe vertical du visage pour renforcer la perception de la future orientation du milieu interincisif (fig. 10b).
Le modèle non fractionné sert à la validation des pièces prothétiques (fig. 10c et 10d). Il est aussi indexé aux références du visage. Il sert de modèles de contrôle pour l’insertion des pièces, pour le réglage fin des points de contact. Coulé avec la fausse gencive en plâtre, il sert à définir les meilleurs profils axiaux, au dessus du profil d’émergence déjà conçu sur le maître modèle, pour éviter les trous noirs (fig. 10e). Il peut servir de modèle de secours, en cas de détériorations du maître modèle.
4D. MONTAGE CROISÉ DES MODÈLES SUR ARTICULATEUR ASA
ÉTAPE 1 : Le montage du modèle des préparations de 15 à 25 sur Articulateur Semi Adaptable (ASA) est réalisé avec un arc facial arbitraire.
ÉTAPE 2 : Un jeu de cires Moyco® sectorielles sur les préparations (fig. 11a, 11b , 11c) est confectionné avec le provisoire en place sur la 21 qui joue le rôle de butée antérieure à la Dimension Verticale (DV) de la nouvelle Occlusion d’Intercuspidation Maximum (OIM). L’enregistrement est assisté par le calage molaire précédemment restauré. Positionné entre le maître modèle des préparations et le modèle antagoniste, ce jeu de cires assure le calage précis de ceux-ci. Ils sont collés entre eux à la cire collante et la tige incisive de l’articulateur est réglée à zéro. Du plâtre Snow White n°2® de Kerr est utilisé pour finir l’assemblage du modèle mandibulaire antagoniste sur l’articulateur (fig. 11d).
ÉTAPE 3 : Le maître modèle est déposé de l’articulateur. Sans modifier la tige incisive, le modèle fonctionnel des provisoires est collé en OIM au modèle mandibulaire avec de la cire collante. Du plâtre Snow White® vient terminer le montage croisé du modèle des provisoires sur articulateur (fig. 11e).
4E. ÉLABORATION PROTHETIQUE AU LABORATOIRE
En plus des références esthétiques et du plan de Camper sur les modèles maxillaires, le montage croisé du modèle fonctionnel des provisoires sur articulateur permet d’obtenir des informations fonctionnelles sur (fig. 12) :
• La situation
– de l’OIM,
– des bords libres validés par la dynamique labiale du sourire.
• L’importance du surplomb et du recouvrement (clé en silicone).
• Les pentes de guidage, incisif et canins (autres clés en silicone).
Ainsi des clés en silicone, réalisés sur l’articulateur, permettent de dupliquer sur les restaurations d’usage :
– la situation des bords libres et occlusaux des dents maxillaires sur les pièces prothétiques en cours de réalisation grâce à une clé en silicone indexés sur les faces vestibulaires du modèle antagoniste (fig. 12b),
– les pentes de guidage grâce à une clé en silicone indexée sur les bords incisifs et les faces occlusales du modèle inférieur qui enregistre les faces palatines et occlusales du modèles des provisoires en augmentant le tige incisive de 1 mm. Cette clé va permettre lors du montage de la céramique de modeler les surfaces palatines et occlusales aux fonctions validés et réglées sur les provisoires (fig. 12c).
Cette possibilité que donne le montage croisé de repositionner le maître modèle en lieu et place du modèle fonctionnel des provisoires et vice versa permet au céramiste de confectionner des clés morphologiques très utiles lors du montage de la céramique. Recherchant les objectifs d’une mise en forme en un minimum de cuissons, à la fois fonctionnel et esthétique, il va pouvoir, grâce à ces clés, se concentrer sur la stratification vestibulaire et incisale, si importante pour les effets optiques des bords libres.
5. INTEGRATION DES RESTAURATIONS
5A. INTÉGRATION CLINIQUE ET OCCLUSALE
Le bilan radiologique permet de visualiser les détails d’adaptation (fig. 13). Malgré la différence initiale entre le plan d’occlusion postérieur Droit (D) et Gauche (G) (voir fig. 1a et 1b), nous avons pu rétablir une OIM assurant le calage et le centrage, moyennant un compromis occlusal dans le secteur maxillaire D. Il consiste à partir de la 16 à avoir des points de contact en OIM limité aux versants vestibulaires des cuspides vestibulaires afin d’éviter tous contacts non travaillants lors de la diduction à G (fig. 14). Du coté opposé, l’OIM en postérieur est calée et centrée selon des contacts A, B, C dans le plan frontal, garant de la stabilité vestibulo-palatine du secteur d’arcade (fig. 14).
Du point de vue du guidage, un compromis est établi à cause de l’agénésie de 12. La canine initiale est transformée en latérale et la prémolaire naturelle en canine prothétique, pour des raisons esthétiques. Le guidage vers l’OIM se modifie et débute sur le partie distale du bord libre de la canine naturelle transformée en latérale, puis est prise en charge, pour la fin du retour en OIM, par la PM transformée en canine (fig. 14).
Le guide incisif est réparti de façon symétrique et prépondérante sur les incisives centrales et, de façon plus limitée sur les incisives latérales prothétiques (fig. 14).
Finalement, cette organisation de l’OIM demeure tout à fait fonctionnelle comme elle l’est restée sur les prothèses transitoires dont les guidages ont été dupliqués sur les prothèses d’usage grâce au montage croisé sur articulateur.
5B. INTÉGRATION CLINIQUE ET ESTHÉTIQUE
La stratification des bords libres des dents antérieures des restaurations en vitrocéramique Emax® et ses effets opalescents, ainsi que les états de surfaces sont particulièrement réussis et tout à fait en accord avec l’âge de la patiente (fig. 15). Le montage croisé des modèles est une source d’informations inestimables, grâce aux différentes clés en silicone issues de la prothèse transitoire qu’il génère. Il facilite une élaboration esthétique et fonctionnelle avec un minimum de cuisson. Du point de vue morphologique, la transformation de la canine en latérale et de la première prémolaire en canine du coté droit de l’arcade rend l’agencement dentaire harmonieux (fig. 15 et 16).
La diversité de stratification des restaurations amène une composition colorimétrique du plus bel effet, en accord avec les dents de l’arcade antagoniste (fig. 16).
Le compromis occlusal a des répercussions sur l’esthétique. Certes les bords libres et cuspidiens du secteur droit ne sont pas dans le même plan que ceux du secteur gauche, mais l’esthétique du sourire, au sein du visage, est très satisfaisant après traitement (fig. 16 et 17). Ceci est dû au fait que, près de l’axe vertical du visage, l’orientation des bords libres et des contours gingivaux des centrales est en accord avec l’orientation de la LBP. Le compromis esthétique et fonctionnel représente également une forme de diversité plus éloignée de l’axe de symétrie des arcades, qui va si bien à un sourire (fig. 17) !
CONCLUSION
Nous possédons aujourd’hui un arsenal thérapeutique fabuleux, tant dans la décision que dans les procédures. Chaque fois que nous réfléchissons avant d’agir, nous progressons au fil des évolutions des décennies précédentes. Aujourd’hui, nous ne soupçonnons pas encore ce que le progrès ne manquera pas de nous apporter !
La position du bord libre de l’incisive centrale devient capitale sur le plan architectural. Il est absolument nécessaire de réviser sa place dans les critères architecturaux de reconstruction lors d’une réhabilitation prothétique étendue Il faut lui donner la primeur, et probablement la placer avant le choix de la position de référence et de la position thérapeutique, toujours discutés à ce jour (Orthlieb et coll 2001).
L’économie d’énergie est un principe moderne sociétal, qui s’applique à la « fonction » d’un individu et qui est caractérisé dans la sphère buccale par une « harmonie neuro-musculo-articulaire ». De la même façon, l’économie tissulaire associée à l’adhésion est un principe moderne chirurgical non invasif qui s’applique à « l’esthétique » d’un individu et qui, dans le domaine de l’Odontologie Reconstructrice, est caractérisé par une « harmonie du sourire au sein du visage ».
ABSTRACT
This case report illustrates the treatment of a case of wear due to an intrinsic origin as well as its resolutely modern decisional, clinical and technical approach:
1. Preparation of the morphofunctional project and its clinical validation both by the patient and the medical team before any procedure is performed, its positive influence throughout the treatment.
2. Tissue preservation and adhesive principles, reinforced and etching vitroceramics.
3. A choice of tools, techniques and procedures that are always simple, efficient and reliable.
4. Importance of a good communication with the laboratory.
In fine, this modern approach allows the fusion between the neuromuscular and articular balance (function and energy saving) and the balance of smile in the face (aesthetics and tissue saving).
INTRODUCTION
The last decade of the 20th century brought many advances in the field of Reconstructive Dentistry and Fixed Prosthodontics:
1. Adhesion procedures on mineralized dental tissues, but also on metal, composite and ceramic prosthetic surfaces (von Fraunhofer JA. 2012; Marshalla SJ. et al., to be released).
2. Ceramic materials with a leucite-reinforced glassy matrix (Empress®), with lithium disilicate (Emax) and high tenacity ceramic providing an infrastructure to support the stratified cosmetic ceramic, the weak link in the all-ceramic systems (Laborde G. et al., 2004).
3. Osseointegration in implantology providing solutions to all types of missing teeth situations thanks to highly reliable artificial roots, reducing the mutilating consequences of conventional fixed prosthesis in the replacement of missing teeth (Degidi M et al., 2013).
4. From direct and indirect Computer-Aided Design and Manufacturing (CADCAM) enabling different types of production using grinding, rapid prototyping, stereolithography, powder sintering – all these techniques can now provide to the largest number an outstanding accuracy of the prosthetic components that only the most skilled craftsmen were capable of supplying (Ender A. et al., 2011; Seelbach P. et al., 2013).
The first decade of the 21th century is a phase of clinical exploitation of all these developments in the service of patients and practitioners, heading towards a minimally invasive adhesive modern dentistry, favoring tissue preservation, and reducing endodontics necessities (Belser U. 2010; Brabant A. 2010; Lafargue H; 2010), “the almost total disappearance of coronal radicular posts and anchors as well as minimalizinz the nécessity of full coverage single crowns, thus replacing their current indications in the framework of a prosthetic re-treatment” (Tirlet G., Bazos P, 2013).
The purpose of this case report is to illustrate a technical, clinical andmodern decision-making approach, taking into account the morpho-functional project, the tissue preservation and the principles of adhesion to provide a restoration achieving a combination between the neuromuscular and articular balance (function and energy saving) and the harmony of the smile in the face (esthetics and tissue saving).
1. INITIAL CLINICAL SITUATION
Mrs G. is 60-year-old former high-level sportswoman. Her anamnesis shows no health problem to this day. During the first consultation, she mentions numerous vomiting episodes when she was competing as an athlete.
The consultation is due to numerous episodes of loosening of her anterior crowns as well as a request for more appropriate restorations to improve her smile.
1A. CLINICAL EXAMINATION OF THE INITIAL SITUATION
Front view in occlusion (fig. 1a), 11, 12 and 21 are crowned and show inflammatory periodontal lesions as well as diastemas. There is a considerable abrasion wear on the maxillary teeth, more severe on the right posterior teeth. All the clinical crowns are short.
When the mouth is opened (fig. 1b), the mandibular teeth in the right sector are in severe overeruption, and 41 and 42 are in a vestibular position. They do not show any significant sign of abrasive wear. 46 and 47 are crowned, and a conventional bridge replaces 36 with two full coverage anchors on 35 and 37. The other mandibular teeth are healthy.
The maxillary teeth show severe occlusal palatal erosive wear, on the entire arch, differentiated from the anterior sector towards the posterior sector (fig. 1c). In the sector of premolars and canines, palatal erosion extends to the gingival area. Except for the crowned teeth 11, 12 and 21, showing diastemas and inflammatory periodontal lesions, the maxillary teeth show no carious lesions and do not need any restoration.
The examination using joint and muscle palpation (Farrar diagram) shows no anomality. There are no problems related to a dysfunction of the manducatory apparatus.
1B. RADIOGRAPHIC EXAMINATION WITH RETROALVEOLAR X-RAYS
11, 21, 46 and 47 are single ceramo-metal crowns placed on endodontic treated teeth bearing inlay-core restorations. 22 is vital and is capped (ceramo-metal crown), whereas 35 and 37 have vital abutments for a ceramo-metal bridge replacing 36.
The erosive lesions are clearly visible on the maxillary X-rays. Endodontically, 47 shows a radioclear image around the distal root, and 21 an image of internal resorption on the mesial part of its root.
1C. DIAGNOSIS
As far as the diagnosis is concerned, the considerable transverse gap between the interincisor midlines is due to the agenesis of the right lateral incisor and not to an intra articular disorder or a dysmorphia of the mandible. These are intrinsic, exclusively maxillary erosions, differentiated from the anterior sector towards the posterior sectors, with no mandibular erosion, typical of recurring acid vomiting (bulimia nervosa). Besides, 11, 12, 21, were crowned after the episodes of acid reflux because the palatal ceramic material has remained intact. Affected with periodontal inflammation with attachment loss, subject to the evolution of erosive destruction with dentin wear and to the loss of Occlusal Vertical Dimension (OVD), they have consequently
migrated and diastemas appeared.
As for the prognosis, it is first absolutely necessary to stop the vomiting episodes before planning to use ceramic material for any type of restoration.
2. ESTHETIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE INITIAL SITUATION
2A. INITIAL ESTHETIC ANALYSIS OF THE SMILE IN THE FACE
The esthetic examination of the face is carried out with a photography of the face, while the patient is standing and looking at the lens of the camera. It freezes on images the labial dynamics of the smile and the laughter in the face in order to observe, report and classify the problems to be solved.
When the patient is smiling
– The maxillary teeth are not visible, (fig. 2a).
– The intercommissural line is not completely parallel to the interpupillary line.
– The lips are of average thickness.
During laughter
– The smile line is disharmonious (fig. 2b).
– The interincisor midline is misplaced.
– The maxillary interincisor midline is oblique.
– Teeth are short.
– Lips are thin.
2B. RECORDING THE FACIAL ESTHETIC DATA AND TRANSFERRING THEM TO THE LABORATORY
The facial esthetic data, interpupillary line, facial midline and Camper’s plane, are registered with a specific device, Ditramax® (Margossian et al., 2010; Margossian et al., 2011) (fig. 3a, 3b). Thanks to a marking guide set on the system framework, the facial esthetic references can be transferred on the plaster maxillary working cast (fig. 3c). Within the maxillary cast, it is thus completely possible to assess the concordance or the lack of consistency in the cervical line alignment and/or incisal curve which must be noticeably parallel to the interpupillary line to suggest the harmony in smile and laughter (fig. 4).
2C. FUNCTIONAL AND ESTHETIC ANALYSIS OF THE INITIAL MODELS
Indexed to the facial esthetic references, the maxillary working cast is set on an ASA articulator with a facial arc. The functional instrumental occlusal analysis thus takes into account the esthetic criteria of the face (fig. 5).
3. DEVELOPING AND VALIDATING A MORPHOFUNCTIONAL PROJECT
The morphofunctional project and its validation, in the smile, according to the patient’s face, is the most important stage in the treatment because it will determine all the other stages, from the calibration of the preparations for optimal tissue saving to the manufacturing of temporary prostheses which must be an accomplished functional and esthetic proposal, making easier the preparation of the definitive prostheses.
3A. PREPARATION OF THE MORPHOFUNCTIONAL PROJECT
It depends on the objectives that were set for the reconstruction after a specific planning process to resolve the issues listed throughout the diagnostic phase and bringing up the associated pre-prosthetic therapeutics. The approach becomesmorphologic (waxup) since it takes into account the architectural objectives of the reconstruction.
It is necessary to increase the Occlusal Vertical Dimension (OVD) and measure it at the level of the incisal pin. For that purpose, it is necessary to:
• Localize the position of the free margin of the central incisor using the the labial dynamics from rest position to forced laughter.
• Respect the proportions of the central incisor (width/length ratio = 75 to 85%) and then the dentodental proportions.
• Limit the overjet and the overbite.
• Create some space.
– To limit the enamel and/or dentin mutilation.
– To favor a strong adhesion to the enamel.
In this clinical case, the increase of the OVD at the incisal pin is 5mm (« Rule of Thirds ») (Orthlieb JD. 2002). The position of the free margin on the central incisor is extremely important on the architectural plane. It is absolutely necessary to consider its location according to the criteria of occlusal reconstruction in an oral prosthetic rehabilitation (Orthlieb JD. et al., 2001). It must be the top priority and must preceed the architectural criteria of the mandible in the adjustment of the occlusal plane, and probably before the choice of the reference position, which is still being discussed (MIO versus Centric Relation (CR) versus Swallowing Position on the path of closure and the therapeutic position (Centric Relation Occlusion – CRO) versus Anteposition from CR, MIO on the path of closure during swallowing).
The morphofunctional project is waxed after preparing on the model, the morphology of 11, 21, and 22. Before placing the morphofunctional project, we removed the crowns on 11, 21, 22 and performed the endodontic treatments and the initial periodontal therapeutics. This stage allowed to eliminate any interference with the morphology of the initial teeth and also reduces the periodontal inflammation.
3B. ESTHETIC AND FUNCTIONAL VALIDATION OF THE MORPHOFUNCTIONAL PROJECT.
The morphofunctional project is placed in situ on the patient with a silicone key and some composite resin for autopolimerizable temporary prosthesis (fig. 6a and 6b). An esthetic and functional assessment of the smile is performed and validated with a mock up provided to the patient (fig. 7).
This validation allows to manufacture all types of guides (for preparations, periodontal surgery or the placement of the implant) as well as a secondary temporary prostheses.
4. CLINICAL STAGES AND COMMUNICATION WITH THE LABORATORY
4A. PRELIMINARY STAGES
After checking out hygiene issues and after the clinical validation of themorphofunctional project, the endodontic treatments are redone (11, 21) or performed (22) as well as the abutments. A periodontal deep cleaning is then performed and considerably improves the gingival condition with a repositioning of the marginal gum inadequacy with a consistent width/length ratio of the central incisors (75 to 85%).
The posterior restorations (glass ceramic overlays Emax® on 16, 17 and crowns on 46, 47 with zircon infrastructure, glass ceramic overlays Emax® on 26, 27 and a bridge on 35 to 37 with zircon infrastructure and everywhere, a preservation of the pulp vitality) are performed during two successive stages in the new conventionnal occlusal position with simple methods. Impressions of the entire arches everything set on an articulator with a mounting table.
4B. CONVENTIONAL PERIPHERAL PREPARATIONS VS ADHESIVE PREPARATIONS
The conventional peripheral preparations for a ceramo metal crown or an all ceramic crown require minimal buccal thicknesses (fig. 8a):
– From 1 mm to 1,4 mm in the cervical area,
– From 1,5 mm in the median area,
– From 1,5 to 2mm in the occlusal or incisor area.
The adhesive peripheral preparations only require 0,8 mm to provide a long-term resistance after bonding the Emax® adhesive ceramic restorations (fig. 8b and 8c). The posterior overlay preparations have supragingival margins and favor tissue saving (fig. 8d).
The validated morphofunctional project induces the preparations thanks to the technique of controlled penetration and the silicone cutting guides thus favoring tissue saving (Laborde G., Lasserre JF., 2010; Lasserre JF., Laborde G., 2010).
The cervical enamel preparation limits provide a strong adhesion of glass ceramic. The hybridization of dental tissues following the preparations allows to close the dentin wound (Magne P, Belser U., 2003; Koubi S. et al., 2010). These preparations can be partial and longlasting (anterior or posterior veneer) and highlight the minimally invasive adhesive technics (Edelhoff D., Sorensen JA. 2002; Laborde G., Lasserre JF., 2010; Lasserre JF., Laborde G., 2010; Lafargue H., 2010).
4C. IMPRESSIONS AND MODELS
For para gingival or intra sulcus margins, the access to the sulcus is provided with the double cord technique. To make the impression, the one-step /double-mix technique is used, with elastomers, polyvinylsiloxanes ( PVS) or polyethers (fig. 9a) (Laborde et al., 2010).
In order to cast several models from the same impression without damaging the information, some wax is placed on the external part of the gingival retraction (fig. 9b) (Laborde et al., 2010). This technique avoids the tearing of the silicone material in the plaster replica of the gingival sulcus during demoulding. Two models at least are cast with this method, one master cast and one spare cast.
It is not necessary to highlight the cervical margins because they are perfectly visible, without trimming. Then the wax is taken off the impression with steam in order to cast a plaster model with the entire marginal periodontium. Wax can remain on the model (fig. 9c). Its elimination with steam reveals the cervical limits, with no risk for their integrity during trimming. It is extremely important to keep the unprepared part of the natural anatomy of the abutment. This unprepared anatomy allows to organize the emergence profile of the restoration in the continuity of the natural tooth profile. Wax often remains in the impression after casting the first model, it is then possible to duplicate this model. The elimination with steamallows to cast the impression by defining on the model the entire marginal periodontium that may be used as a « fake plaster gingiva » model, or as a spare model (Laborde et al., 2010).
The master model is used to manufacture the prothesis (fig. 10a). It is indexed to the esthetic facial references.
Single Positive Models are cut and positionned according to the vertical axis of the face in order to optimize the perception of the future orientation of the interincisive midline (fig. 10b).
The uncut model is used to validate the prothesis (fig. 10c and 10d). It is also indexed to facial references. It is used as a reference model during the insertion of parts and is also used to adjust accurately the contact points. Cast with the fake plaster gingiva, it allows to define accuratly the axial profiles, above the emergence profile already made from the master model in order to avoid black holes (fig. 10e). It may be used as a spare model if the master model is damaged.
4D. CROSS MOUNTING OF THE MODELS ON A ASA ARTICULATOR
STAGE 1: the mounting of the model for the preparations on 15 to 25 on the semi adjustable articulator (ASA) is completed with an arbitrary facial arch.
STAGE 2: A set ofMoyco® sectoralwax on the preparations (fig. 11a, 11b, 11c) is made with the temporary prosthesis placed on 21 playing the role of an anterior stop in the Vertical Dimension (VD) of the new Maximal Intercuspal Occlusion (MIO). The registration is ensured by the posterior molar contact. Positioned between the master model of the preparations and the antagonist model, this wax set provides the accurate wedging of both
models. They are stuck to each other with bonding wax and the incisive pin of the articulator is set on zero. Some Snow White n°2® plaster by Kerr is used to complete the mounting of the antagonist mandibular model on the articulator (fig. 11d).
STAGE 3: themastermodel is removed fromthe articulator. Without modifying the incisive pin, the functional model of the temporary prosthesis is stuck in occlusion to the mandibular model with bonding wax. Some SnowWhite® plaster is used to complete the cross mounting of the model of the temporaries on the articulator (fig. 11e).
4E. LAB DESIGN OF THE PROTHESIS
Besides the esthetic references and the Camper plane on the maxillary models, the cross mounting of the functional model of the temporaries on the articulator provides functional information on (fig. 12):
• The location
– of the intercuspal occlusal position,
– of the free margins validated by the labial dynamics of the smile.
• The size of the overbite and the overjet (silicone key).
• The guidance slopes, incisive and canine (other silicone keys). Made on the articulator, silicone keys thus allow to duplicate on the definitive restorations:
– The location of the occlusal and marginal positions of themaxillary teeth on the prothesis that are beingmade using a silicone key indexed to the buccal faces of the antagonist model (fig. 12b),
– the guidance slopes using a silicone key indexed to the incisive edges and the occlusal faces of the lower model which registers the palatal and occlusal faces of the model of the temporaries by increasing the incisive rod of 1 mm. During the mounting of the ceramic, this key will allow to model the palatal and occlusal surfaces with validated functions adjusted to the temporaries (fig. 12c).
The cross-mounting allows to reposition the master model in the place of the functional model of the temporaries and vice versa allows the ceramist to make very useful morphological keys during the placement of the ceramic. Willing to fabricate the prothesis in minimum number of firings, the ceramist will be able, with these keys, to focus on the buccal and incisal stratification that is so important to the optical effects of the incisal edges.
5. INTEGRATION OF THE RESTORATIONS
5A. CLINICAL AND OCCLUSAL INTEGRATION
The X-Ray status allows one to observe the adaptation of the final restorations (fig 13). In spite of the initial difference between the right (r) and left (l) posterior plane of occlusion (see fig. 1a and 1b), we were able to restore an intercuspal occlusal position with a minimal compromise in the maxillary right sector. Starting from 16, it consists of having contact points in intercuspal position limited to the buccal slopes of the buccal cuspids to avoid any non-working contacts during mastication on the left (fig. 14). On the opposite side, the intercuspal position in the posterior sector is provided according to contacts A, B, C in the frontal plane, ensuring the buccal-palatal stability of the arch sector (fig. 14).
Concerning the guidance, a compromise is settled because of the agenesia of 12. The initial canine is changed into a lateral and the natural premolar into a prosthetic canine, on esthetic grounds. The guidance to the MIO changes and starts on the distal part of the free margin of the natural canine turned into a lateral and is then handled, in the end of the path back to MIO, by the natural premolar turned into a canine (fig. 14). The incisive guidance is distributed in a symmetric and leading way on the central incisors and, to a lesser extent, on the prosthetic lateral incisors (fig. 14).
Finally, this occlusal adjustment remains totally functional since it remains on the temporary prostheses, the guidances of which have been duplicated on the definitive prostheses thanks to the cross mounting on the articulator.
5B. CLINICAL AND ESTHETIC INTEGRATION
Stratification of the incisal edges of the anterior teeth with glass ceramic Emax® restorations and its opalescent aspect, as well as the surface condition are particularly successful and in perfect adequacy with the patient’s age (fig. 15). The cross mounting of the models is a source of invaluable information, thanks to the various silicone keys made from the temporary prosthesis. It facilitates an esthetic and functional elaboration with a minimum number of firings.
From the morphological point of view, the transformation of the canine into a lateral and the first premolar into a canine on the right side of the arch makes the dental layout harmonious (fig. 15 and 16).
The diversity in the stratification of the restorations gives a very beautiful colorimetric composition, in harmony with the teeth on the antagonist arch (fig. 16). The occlusal compromise has repercussions on theesthetics. Although the incisal and cuspid edges of the right sector are not in the same plane as those of the left sector, the esthetics of the smile is very satisfactory after treatment (fig. 16 and 17). This is due to the fact that, near the vertical axis of the face, the orientation of the incisal edges and the gingival outlines of the central teeth is in harmony with the orientation of the interpupillary line. The esthetic and functional compromise also gives a type of diversity more distant from the symmetry axis of the arches, which fits a smile very well (fig. 17)!
CONCLUSION
A tremendous therapeutic arsenal is currently at our disposal, both in the field of decisions and procedures. Each time we think before acting, we can make some progress thanks to the evolutions of the previous decades. We cannot figure out today what kind of advances will occur in the future !
The location of the free margin of the central incisor is a key issue on the architectural plane. It is absolutely necessary to think about its place in the architectural criteria of reconstruction during a vast prosthetic rehabilitation. It must be the absolute priority that must probably come before the choice of the reference position and the therapeutic position, which are still being discussed (Orthlieb et al., 2001).
Energy saving is a societal modern principle, which applies to the “function” of an individual and is characterized in the oral sphere by a neuro-musculararticular “harmony”. In the same way, tissue saving associated with adhesion is a modern non invasive dental concept which applies to a person’s “esthetics” and which, in the field of Reconstructive Dentistry, is characterized by the “harmony of the smile in the face”.
A. SETTE, G. LABORDE, M. DODDS, G. MAILLE, P. MARGOSSIAN
Stratégie prothétique mai-juin 2014 vol 14, n° 3
Comment vérifier le parallélisme entre les lignes bi-pupillaire et bi-commissurale ? Quel est le protocole photographique utilisé dans cette étude biométrique ? Quels sont les résultats sur les symétries faciales ?
L’esthétique du sourire est créée par l’harmonie de la composition dento-gingivale dans le sourire au sein du visage de nos patients. Certains principes fondamentaux, universellement reconnus, déterminent notre appréciation de ce qui est considéré comme esthétiquement attrayant (1, 2).
À notre époque, santé et élégance sont des atouts majeurs, et les espérances des patients et l’image qu’ils ont de leur personne nous contraignent à toujours améliorer les standards en dentisterie, et à répondre à des demandes de plus en plus pressantes pour réussir des prothèses naturelles (3). Une analyse faciale, dento-labiale, dentaire, gingivale est un point de départ indispensable à une réhabilitation prothétique. En effet, une analyse esthétique préalable à un traitement prothétique donne au praticien l’information nécessaire au choix des meilleures approches en fonction de chaque individu (4, 5).
La communication entre le praticien et le prothésiste est indispensable à l’obtention du résultat prévisible recherché. La transmission des données esthétiques au laboratoire permet, quant à elle, d’aider le céramiste à optimiser le résultat afin d’obtenir un sourire en harmonie avec le visage (6). L’objectif de ce travail consiste à établir des standards quant à l’utilisation des plans de références faciaux lors de reconstruction dentaire et gingivale.
En dentisterie esthétique, il est admis que la restauration doit être en accord avec la gencive, le sourire, et plus globalement, avec le visage du patient, lui-même défini par le cadre facial, représenté par des référentiels horizontaux et verticaux (7), ce qui suppose une analyse faciale, dento-labiale optimale.
De nombreux auteurs ont montré que la Ligne Bi-Pupillaire (LBP) doit être considérée comme la référence horizontale de nos thérapeutiques, de même que la Ligne Sagittale Médiane (LSM) doit être considérée comme référence verticale (4, 8). Jusqu’à aujourd’hui, aucune étude n’a montré la pertinence de l’utilisation de l’horizon comme référence horizontale. En est-il est de même pour les attitudes thérapeutiques à adopter dans les situations d’asymétries faciales (7), qu’elles soient verticales ou horizontales ?
Cette étude a plusieurs objectifs :
• vérifier s’il existe un parallélisme entre les lignes bi-pupillaire (LBP), bi-commissurale (LBC), l’horizon et un cadre facial de référence du visage,
• définir quelle est la référence horizontale la plus pertinente à utiliser lors d’une réhabilitation esthétique ,
• mesurer les angles formés entre le plan esthétique, le plan de Francfort et le plan de Camper,
• vérifier dans une vue de profil du visage que le plan esthétique est confondu avec l’horizon lorsque le patient a la tête droite et qu’il fixe son regard au loin.
Parallèlement, pour intégrer ces notions, il nous semble nécessaire d’évaluer le seuil de perception du parallélisme entre deux lignes par l’oeil humain, et donc intégrer une restauration dans un visage, avec des axes de références harmonieux, permettant de répondre aux traitements restaurateurs du secteur antérieur maxillaire.
Enfin, l’ensemble du protocole établi doit permettre une analyse de la symétrie faciale horizontale et verticale dans un plan frontal. Cette analyse permet de démontrer si un visage est symétrique ou non, et, le cas échéant, de qualifier et quantifier cette asymétrie. Cette partie de l’étude est destinée à comprendre comment intégrer au mieux dans nos thérapeutiques les notions de symétrie/asymétrie.
Matériels et Méthodes
Protocole photographique
Le protocole utilisé dans cette étude consiste en la réalisation d’une série de photographies du visage : trois de face (repos – sourire léger – sourire forcé), et
une de profil à l’aide d’un appareil photographique
numérique (Nikon D90). Ce protocole est réalisé sur 160 étudiants en Odontologie de la Faculté de Marseille. Une information complète est délivrée à chacun d’eux. Un délai de réflexion de 48 heures est respecté et les sujets ne sont inclus dans l’étude qu’après avoir posé toutes leurs questions sur le protocole à l’investigateur principal. De plus, ils doivent avoir lu, approuvé et signé un consentement éclairé. Les critères d’exclusion sont :
– les photographies floues ou non cadrées,
– le sujet fermant les yeux,
– le sujet ne regardant pas droit devant lui ou ne se tenant pas droit,
– sujet sans aucun antécédent de traitement orthodontique ou de reconstruction prothétique sur les dents antérieures,
– sujet sans passé traumatique au niveau de la face.
Le nombre de sujets nécessaires pour cette étude a été calculé pour mettre en évidence de façon significative une différence de 1° entre la ligne bi-pupillaire et le plan horizontal de référence, avec un risque d’erreur de première espèce α = 5 % et une puissance (1-β) = 80 %. Le nombre de sujets nécessaire est évalué à 45 individus.
L’appareil photographique est positionné sur un trépied à la hauteur des yeux du patient et réglé de façon à reproduire l’horizontalité. De même, un dispositif laser (Black et Decker) permet la projection sur un arrière-plan monochrome d’une ligne horizontale et d’une ligne verticale. Les clichés sont pris, sujets debout regardant l’objectif de l’appareil. L’ensemble des photographies est réalisé à une distance d’un mètre et trois mètres pour chacun d’eux.
Analyse des photos
Les photographies sont ensuite transférées sur un ordinateur (Imac®-MacosX®), et exploitées grâce au logiciel Keynote® (2011). Sur la photographie de face de chaque sujet, un cadre que nous avons dénommé cadre facial de référence est réalisé par conception numérique afin de préciser la position spatiale et l’axe du visage. Ce cadre rectangulaire est tracé en vert sur une photo de face de façon à circonscrire harmonieusement le visage du patient. Sa médiane définie la référence verticale du visage. À partir de cette médiane, des parallèles délimitent verticalement ce cadre facial, et deux perpendiculaires ferment horizontalement le cadre (fig. 1). Six observateurs, 3 dentistes et 3 non-dentistes, ont validé le positionnement harmonieux du cadre de référence autour du visage.
Ensuite, les lignes de référence horizontales (LBC-LBP) sont tracées en jaune sur les photographies (fig. 1). Des segments bleus tracés sous la ligne bi-pupillaire permettent de quantifier une éventuelle asymétrie faciale horizontale (fig. 2). Enfin, sur les photos de profil, le plan de Camper est représenté en bleu (fig. 3).
Mesure du seuil de perception du parallélisme par l’oeil humain
Deux segments, l’un de 6 cm représentant la LBP, l’autre de 4 cm pour la ligne LBC sont tracés parallèlement sur une feuille, espacés de 7 cm (distance LBC au bord libre de l’incisive centrale). On réalise des duplicatas de ces tracés, en faisant varier l’angle initialement nul, par paliers de 0,5 degrés. Des tracés de -3° à 3° sont alors obtenus et présentés aléatoirement, chaque sujet, à hauteur du regard et à une distance de 1 mètre et 3 mètres. Chaque sujet doit exprimer son ressenti sur le parallélisme ou non des droites (fig. 4).
Résultats
Expérience 1
Analyse des lignes de référence
Les variables mesurées sont les angles observés entre les lignes bi-pupillaire, bicommissurale, d’horizon, l’horizontale du cadre, le plan incisif et le plan de Camper et la différence entre les distances « pupille droite – LSM » et « pupille gauche – LSM ». Il s’agit donc uniquement de variables quantitatives continues. Les tests statistiques utilisés dans l’étude du parallélisme des lignes horizontales, pour comparer une moyenne à une valeur théorique ou deux moyennes entre elles, sont le test Z et le test des « randomized blocks » pour comparer plusieurs moyennes sur échantillons appariés. Le test statistique utilisé dans l’étude de la symétrie du visage, est
un test de Student apparié.
Tous ces tests sont mis en place avec un risque d’erreur α = 5 % et une puissance (1-β) = 80 %.
Les tests statistiques réalisés ont permis d’objectiver les moyennes suivantes :
– 0,51° entre la ligne bi-pupillaire et l’horizon du cadre,
– 1,97° entre la ligne bi-pupillaire et l’horizon laser,
– 0,67° entre la ligne bi-pupillaire et la ligne bi-commissurale,
– 0,96° entre la ligne bi-pupillaire et le plan incisif,
– 2,18 mm d’asymétrie horizontale, (mesure LSM – pupille droite/LSM – pupille gauche),
– 1,75° entre l’horizon du cadre et l’horizon laser.
Symétrie/Asymétrie (fig. 5)
La symétrie faciale existe chez 36 % des sujets de l’étude. Une majorité des sujets (64 %) photographiés présentent des asymétries faciales. Elle se décompose ainsi :
– 52,4 % d’asymétries horizontales (différence de largeur droite/gauche) ,
– 6,9 % d’asymétries verticales (différence de hauteur droite/gauche, niveau orbitaire) ,
– 4,7 % d’asymétries mixtes, verticales et horizontales.
L’asymétrie horizontale est souvent importante avec 31 % des sujets présentant une différence de largeur entre le côté gauche et le côté droit supérieure à 1,5 mm.
Orientation latérale du plan esthétique
Dans une vue de profil, la différence entre le plan de Camper et de Francfort est de 18°. Le plan esthétique est situé 8° audessus du plan de Camper et 10° en dessous de Francfort.
Expérience 2
Seuil de perception du parallélisme par l’oeil humain
Le tableau I met en évidence que, dans les conditions de l’expérimentation, le seuil de perception du parallélisme par l’oeil humain à 3 mètres pour percevoir le strict parallélisme se situe autour de 0,5° pour environ 4 % (± 1%) des observateurs. À partir de 1°, environ 27 % (± 2%) de la population perçoit l’absence de parallélisme. Cette sensibilité est légèrement supérieure lorsque l’observation se fait à 1 mètre.
Discussion
L’analyse faciale est une étape clé de tout traitement esthétique. Les standards esthétiques empiriques de reconstruction (4, 8, 11) doivent être confrontés à des études biométriques pour confirmer ou infirmer ces notions. Contrairement à ce qui a déjà été fait dans la littérature (12-13), il nous est paru important de comparer les lignes de référence anatomiques, horizontale (LBP) et verticale (LSM) par rapport aux axes de reconstruction idéale du visage repéré avec le cadre facial de
référence DITRAMAX® (vert).
La comparaison de l’axe vertical déterminé par le cadre de référence nous a permis de faire la différence entre de vraies asymétries faciales et un port de tête incliné. Contrairement à Lee, notre étude montre que l’horizon de référence est inefficace, avec une divergence importante d’environ 2°:
– 0,51° de moyenne entre la ligne bi-pupillaire et l’horizontale du cadre ;
– 1,97° de moyenne entre la ligne bi-pupillaire et l’horizon laser.
En effet, le tableau II met en évidence le degré de fiabilité des inter-relations entre les lignes horizontales :
– très efficientes entre, LBP, Hc, LBC.
– efficientes entre LBP, HC et PI
– inefficaces quant à Hr.
La seconde expérience a pour objectif de déterminer le seuil de perception du parallélisme par l’oeil humain entre deux lignes simulant la ligne bi-pupillaire et le plan incisif. Par des variations d’angle de la ligne incisive sur une photo de visage modifiée par informatique, Behrend (14) trouve une sensibilité d’environ 1° avec 21 observateurs. Dans notre étude, le test se limite à l’observation de deux lignes, sans l’influence du visage, afin de focaliser sur la sensibilité de l’oeil à percevoir
le strict parallélisme. Ce test fait avec 160 observateurs, montre une sensibilité supérieure à 0,5° pour 5 % de la population et à 1° pour le plus grand nombre (tableau I).
Ces résultats montrent un pouvoir discriminant de l’oeil humain à partir de 1°. Ainsi, dans 88,4 % des cas (36 % de symétriques + 53 % d’asymétries horizontales, voir fig. 5) la ligne bi-pupillaire reste la principale référence horizontale de reconstruction.
A contrario 11,6 % des sujets (asymétriques verticaux + asymétriques mixtes, voir fig. 5) présentent donc un caractère d’asymétrie verticale qui conduit à choisir un axe de reconstruction horizontal différent. Au-delà du seuil de perception de l’oeil humain (1°), cet axe est souvent la moyenne des orientations entre LBP et LBC. La médiane du cadre de référence (vert) devient la référence verticale de reconstruction. En pratique clinique, c’est le cadre facial de référence (vert) qui défini les axes, horizontal et vertical, du visage. Au-delà du potentiel de discrimination de l’oeil (1°), une photo visage, DITRAMAX® en place permet de mettre en évidence les références verticale et horizontale de la reconstruction (fig. 6.) La LBP ne peut plus être la référence horizontale. Il est alors possible d’évaluer l’importance de la correction au niveau des pupilles (fig. 7).
Ceci est en accord avec les résultats de Behrend (14), qui obtient une influence significative de l’ensemble de ces lignes sur le choix de l’axe horizontal de reconstruction, en incluant un axe vertical représenté par la perpendiculaire à la ligne inter-méatique. La ligne bi-commissurale est la plus importante après la ligne bipupillaire, car très proche de la zone de reconstruction (tableau I).
Dans cette étude sur 160 sujets, l’angle moyen entre la ligne inter-méatique et le plan de référence horizontal esthétique est de 1,5° (SD 0,9°). De nombreux auteurs (4, 5) ont décrit les conséquences
cliniques du manque de parallélisme entre la ligne inter-méatique, qui est la référence horizontale des arcs faciaux, avec le plan esthétique horizontal. Dans cet exemple, une prothèse antérieure parfaitement horizontale sur l’articulateur présente, une fois en bouche, un défaut d’alignement esthétique majeur. Il est par conséquent important de communiquer au laboratoire l’orientation du plan esthétique antérieur horizontal et sagittal afin de garantir la bonne intégration esthétique des prothèses.
De nombreux auteurs ont souligné que la majorité des visages sont naturellement asymétriques (9, 15). Nous trouvons en effet dans notre étude que 64 % des
sujets présentent un caractère d’asymétrie (fig. 5). Il est toutefois important de faire la différence entre l’asymétrie verticale et horizontale. Au sein de la population étudiée, les asymétries se répartissent de la façon suivante : 52,4 % des sujets présentent une asymétrie horizontale, 6,9 % verticale et 4,7 % mixte, horizontale et verticale (fig. 5).
L’asymétrie horizontale droite/gauche, bien que fréquente, n’est pas problématique du point de vue clinique, car elle ne modifie pas les axes esthétiques de reconstruction (LBP et LSM). Elle est en général associée à un décalage latéral du milieu interincisif lié au différentiel de croissance entre le côté droit et gauche de la face.
Sur l’ensemble de la population étudiée, la répartition des sujets ayant un port de tête incliné est (tableau III) :
– peu importante pour les sujets symétriques (15 %) ;
– nettement majoritaire pour les sujets asymétriques verticaux (75 %) ;
– très importante pour les sujets asymétriques horizontaux (48,6 %) et mixtes (62 %).
Enfin, en accord avec les résultats de Lee, en vue de profil, le plan esthétique se situe entre les plans de Francfort et Camper à environ 9° de chacun d’eux (7). Ce plan donne l’axe de vision du modèle selon l’aspect naturel et assure ainsi la bonne gestion de la courbure incisive. Si le prothésiste travaille dans l’alignement au plan de Camper, il aura tendance à rallonger les incisives centrales, et inversement s’il suit le plan de Francfort. Il est là aussi capital que le prothésiste perçoive le modèle dans la situation la plus proche possible de l’aspect naturel du visage, c’est-à-dire environ 10° au-dessus du plan de Camper.
Conclusion
Cette analyse biométrique des visages a permis de valider des règles couramment utilisées dans le domaine de l’esthétique faciale. La ligne bi-pupillaire (LBP) est la référence horizontale des traitements dentaires en secteur esthétique pour 88,4 % des patients (sujets avec symétrie verticale + ceux avec symétrie horizontale + sujets avec asymétrie horizontale). La référence verticale de ces traitements est toujours la médiane du cadre de référence (vert).
Ce cadre de référence est aussi une aide à la perception des asymétries verticales qui représentent environ 11,6 % des sujets. De tels patients sont traités eu utilisant comme référence horizontale soit :
• la ligne bi-commissurale (LBC) lorsqu’elle est parallèle à la ligne horizontale du cadre de référence,
• la bissectrice de l’angle formé par LBP et LBC lorsqu’elle n’est pas parallèle à la ligne horizontale du cadre de référence.
Enfin, la sensibilité de l’oeil humain à percevoir des différences de parallélisme entre les lignes LBP et LBC se situe aux environs de 1°, le choix de la référence horizontale est alors indifférent.
Dans le plan sagittal, la différence entre le plan de Camper et de Francfort est de 18°. Le plan esthétique est situé 8° au-dessus du plan de Camper et 10° en dessous de Francfort.
Koubi S., Gurel G., Margossian P., Chabrand M., Massihi R., Kuday H., Tassery H.
Réalités Cliniques 2014. Vol. 25, n° 4
Résumé
Le traitement de l’usure est devenu un sujet d’actualité (1) depuis la fin des années 2000 car bien que sa prévalence n’a cessé d’augmenter au cours des 20 dernières années, les perspectives de traitement demeuraient sombres pour le patient et les dents concernées.
Les gouttières et les composites de dépannages ont occupé une place importante. L’autre alternative étant le recours à des solutions beaucoup trop mutilantes sur le plan biologique. Ces dernières années ont vu l’avènement, grâce au collage, de techniques de reconstruction complète des arcades essentiellement additives. Ces dernières présentent surtout un avantage important sur le plan biologique car les dents sont très peu voire pas du tout préparées. Si ces techniques sont révolutionnaires sur le plan du concept, leur mise en oeuvre peut sembler sous certains aspects délicate.
Implication Clinique
L’objectif de cet article est de proposer un protocole de traitement précis, reproductible en faisant appel à des outils éprouvés pédagogiquement avec les facettes, des formes de préparations nouvelles simplifiées afin de faciliter encore plus l’accès des praticiens à ce type de traitement.
État des connaissances actuelles
À la fin des années 2000, de nouvelles perspectives furent proposées, modifiant de manière significative notre approche « classique » peu conservatrice du traitement des lésions d’usure (2-7).
Plusieurs classifications ont été proposées, mais la plus pertinente permet d’adapter la nature et le design des restaurations à la perte tissulaire observée ; cette dernière appelée ACE par ses auteurs (8), devient un outil clinique pour le praticien afin de corréler le niveau de destruction tissulaire (important, moyen, faible) à un type de restauration spécifique dans une approche prévisible et reproductible.
Ainsi, les concepts de traitements innovants faisant appel aux dernières avancées dans le domaine de l’adhésion et des biomatériaux (procédé de fabrication CAD CAM à base de bloc de céramique ou de composite, céramique pressée, simplification du processus de réalisation des restaurations) permettent d’optimiser les performances mécaniques et esthétiques des restaurations. En effet, l’avènement de cette dentisterie adhésive a profondément bouleversé le mode de pensée du praticien : la dent et la préservation tissulaire deviennent le centre de nos préoccupations en lieu et place de la nécessité d’adapter celles-ci au cahier des charges des matériaux. La biologie devient enfin le pilier essentiel de cette nouvelle ère (9).
Le projet esthétique et fonctionnel La nouvelle DVO
L’analyse clinique (fig. 1 à 7)
Dans les cas d’usure, le repositionnement des futurs bords libres des 2 incisives centrales par ajout de composite à main levée est une étape simple, mais importante afin de communiquer au laboratoire le repère le plus précieux pour la construction du nouveau sourire par le biais du wax up. Pour cela une empreinte des nouvelles proportions est réalisée ainsi que son antagoniste. Une fois les bases esthétiques posées, il est primordial de créer les conditions fonctionnelles nécessaires au rallon-gement du bloc incisivo-canin afin d’assurer la pérennité des futures restaurations.
Pour cela, le recours à l’augmentation de la DVO est une des options les plus répandues. Afin de quantifier le besoin de l’augmentation, on reconstruit avec le même procédé que pour les bords libres, les faces palatines des incisives centrales. Plus l’usure est avancée, plus l’apport sera important. On vérifie alors la simultanéité des contacts des deux incisives puis l’espace créé sur les dents adjacentes avec leurs antagonistes pour éviter des reconstructions trop volumineuses toujours déplaisantes pour le patient. Le patient n’est pas manipulé et ferme plusieurs fois de manière à vérifier le bon positionnement. On vérifie alors l’espace créé entre les deux arcades. Celui-ci doit correspondre à l’épaisseur de la pièce souhaitée.
Chez la majorité des patients présentant une usure marquée, il est rare de noter une dysharmonie faciale, en raison d’une égression compensatrice des process alvéolaires supports des dents usées.
L’augmentation de la DVO est presque exclusivement motivée par la biologie. En effet, l’espace ainsi créé se substitue à la réduction tissulaire.
Le troisième élément indispensable à la communication avec le laboratoire est l’enregistrement des références esthétiques du visage (ligne bipupillaire et axe médian) afin de les retranscrire sur le modèle de travail. Pour cela, un dispositif du nom de Ditramax est utilisé (10, 11).
La réalisation du wax up
Une fois toutes ces informations collectées, le prothésiste peut procéder à l’élaboration du wax up et reconstruire dans l’espace défini la morphologie perdue. Un wax up complet des deux arcades est alors réalisé. Il va permettre de matérialiser le volume à recréer. L’un des écueils les plus fréquents est le transfert de ce dernier en bouche.
Reconstruction de la morphologie perdue et de l’esthétique : le mock up esthétique et fonctionnel
Classiquement, on faisait appel à une clé en silicone complète incluant une surface palatine la plus large possible pour la stabilisation. Cependant il n’existe pas de butée d’enfoncement précise lors de l’insertion de la clé en silicone. Récemment, l’apport du digital a simplifié de manière significative cette dernière étape. En effet le wax up est scanné afin de disposer d’une empreinte 3D. Une fois scanné, un logiciel permet d’apposer une couche d’épaisseur calibrée sur le nouveau relief occlusal comme si on positionnait virtuellement une gouttière. Celle-ci est ensuite fabriquée par une imprimante 3D puis rebasée à l’aide d’un silicone light afin d’optimiser la friction et la précision de la gouttière lors de son insertion en bouche. Cette gouttière en résine rigide est alors essayée en bouche puis remplie par une résine Bis-GMAfluide (Luxatemp star DMG) afin d’être placée en bouche (fig. 8). Son insertion est simple, précise. L’occlusion est alors vérifiée afin de valider l’intégration fonctionnelle du mock up. Ce dernier préfigure de manière très précise la nouvelle occlusion dans la nouvelle DVO ainsi que la ligne du sourire (fig. 9).
Planification thérapeutique lors de la réhabilitation complète des deux arcades une fois le mock up fonctionnel validé :
– traitement de l’arcade maxillaire avec préparation guidée à travers le mock up au niveau antérieur et postérieur.
Le mock up mandibulaire sert d’antagoniste.
– collage de l’arcade maxillaire et préparation guidée à travers le mock up au niveau mandibulaire.
– collage de l’arcade mandibulaire.
La dentisterie guidée : une nécessité pour le praticien
L’idée directrice est d’utiliser le mock up esthétique et fonctionnel comme un guide de préparation aussi bien pour les facettes vestibulaires que pour les tables tops occluso-postérieurs.
Deux questions majeures se posent alors :
– quelle profondeur de préparations pour nos restaurations postérieures ?
– quelles formes de préparation ?
Dans les réhabilitations de denture usée, il est important de souligner le caractère novateur des préparations en raison de leur approche moderne. La reconstruction est souvent additive et l’espace existant entre le volume initial et le volume final est déjà existant.
Les préparations antérieures
Toujours soucieux de réduire l’extension de nos préparations ainsi que le coût biologique (12) différentes techniques ont été proposées. Les préparations pour facettes vestibulaires sont aujourd’hui parfaitement codifiées ; en effet elles font appel à l’utilisation d’un mock up qui sert de guide de préparation. Ainsi, la fraise dont le calibrage est connu peut pénétrer à travers le mock up afin de créer l’espace nécessaire pour la future restauration et garantir la réduction tissulaire nécessaire (fig. 10) (13-17). Cette technique proposée au début des années 2000 a connu un grand succès en raison de sa pédagogie et a ouvert une nouvelle voie dans la démocratisation des facettes en céramique. Dans le cas clinique présent, une variante de cette approche moderne a été utilisée afin d’optimiser la réduction tissulaire au niveau du secteur postérieur. En effet, aujourd’hui les techniques de pénétrations contrôlées à partir d’un mock up sont parfaitement maîtrisées dans le secteur antérieur.
Les préparations postérieures
Quelle profondeur de pénétration ?
Il a été proposé d’utiliser la méthode des préparations à partir du mock up antérieur pour l’adapter aux préparations postérieures ; en effet, une fois le mock up réalisé en bouche, stabilisé puis validé, il semble plus opportun de le maintenir en place au stade des préparations afin de réaliser une réduction homothétique à ce dernier en utilisant une fraise boule de diamètre connu et placée à l’horizontale de manière à bénéficier d’une butée d’enfoncement par l’intermédiaire de son mandrin.
Ainsi, différentes rainures (au nombre de 3) doivent être réalisées (versant interne de la cuspide vestibulaire, sillon central, versant interne cuspide palatine) (fig. 11, 12, 13). De ce fait, le clinicien dispose de l’information la plus précieuse afin d’éviter toute surpréparation.
Lors de la réalisation de ces rainures il est important de ne pas empiéter sur les régions proximales afin d’optimiser les préparations sur le plan biologique et biomécanique.
Quelles formes de préparations pour les restaurations postérieures ?
Il faut préciser qu’étant donné la faible épaisseur des préparations, celles-ci peuvent être réalisées dans une majorité de cas sans pratiquer d’anesthésie.
Les restaurations partielles collées ont vocation à protéger la dent, mais aussi à recréer l’anatomie occlusale initiale qui autorisera l’augmentation de la DVO.
Pour y parvenir, plusieurs options thérapeutiques ont été proposées au cours des années.
Initialement, la couronne périphérique fut pendant longtemps la solution de choix pour remplir ce cahier des charges ; ne répondant plus aux impératifs biologiques modernes cette solution est aujourd’hui rarement retenue. Les overlays en céramique ou en composite de laboratoire ont été proposés ces dernières années et présentaient l’avantage d’une moindre mutilation tissulaire avec des limites périphériques très simples et bien au-dessus de
la JEC des marges habituelles. Cependant, ces derniers présentaient et continuent de présenter un inconvénient majeur, à savoir la destruction des crêtes proximales afin d’assurer l’assise mécanique et de respecter les recommandations des fabricants. Des épaisseurs importantes de réduction de l’ordre de 1 à 1, 5 mm étaient requises. Malgré le strict respect de ces dernières, il a été observé sur des suivis à moyen et long terme des fractures de cosmétique ou de matériau dans la région proximale (chiping). L’avènement des technologies CAD CAM ou des techniques de céramique pressée a sensiblement modifié ces carences mécaniques en raison d’une plus grande densité du matériau (fraisage à partir d’un bloc de céramique ou de composite) et du recours à un simple maquillage de surface.
Afin de mieux coller aux réalités biologiques et de respecter encore plus les structures résiduelles, il devient possible de réaliser des préparations a minima dont le but est d’obtenir :
– une préservation des crêtes proximales quand celles-ci sont présentes (une grande majorité de cas),
– une diminution des épaisseurs de réduction (0,5- 0,8 mm) en raison d’une moindre sollicitation des restaurations (absence de tension au niveau proximal).
En effet, de par la persistance de l’architecture proximale, les crêtes continuent de jouer pleinement leur rôle mécanique. Les restaurations ultrafines à distance des crêtes se retrouvent donc à travailler uniquement en compression ce qui est très bien toléré par les deux familles de matériaux (composite ou céramique) (18) (fig. 14 à 17). Les formes de ces préparations ultraconservatrices peuvent se caractériser de la manière suivante :
– délimitation d’un rectangle dans la face occlusale à l’aide d’une fraise boule bague verte (coffret Komet LD0717) et rouge entre les fossettes proximales à 1 et à 3 mm sous les sommets cuspidiens en fonction du délabrement. Dans tous les cas, la préparation devra toujours être à distance des sommets cuspidiens (en retrait) ou les englober si l’usure est plus importante. Les limites doivent être à distance des impacts occlusaux afin d’assurer la pérennité du joint. L’utilisation d’une fraise boule bague verte et rouge semble être une solution intéressante pour réaliser un angle net cavosuperficiel de 90° pour la pérennité du joint. Les concepts de préparation type « prepless » doivent être évités en raison de la nature de la ligne de finition entre la surface occlusale de la dent et la restauration. Le biseau ainsi créé n’aurait pas vocation à assurer la résistance mécanique nécessaire face aux impacts etaux charges occlusales (chiping, délitement, coloration). Il est donc impératif de réaliser une trace nette ;
– réduction et homogénéisation des différentes gorges si elles sont présentes à l’aide d’une fraise à inlay ;
– inclusion des cuspides palatines lorsqu’elles sont ellesmêmes érodées par l’usure pour amorcer un retour en palatin et ce, toujours dans le but « d’asseoir » la restauration dans un « cadre » stable.
Dans le cas de lésions multiples (palatines et/ou vestibulaires) associées à une usure occlusale, sur les prémolaires et molaires, il faudra réaliser 2 pièces distinctes en prenant soin de laisser une « bande d’émail » entre elles. Cette poutre faisant office de « résistance » qui raccorde les 2 crêtes proximales, sert de soutien aussi bien à la restauration occlusale que vestibulaire, permettant ainsi d’assurer la solidité de la dent. Ainsi, le praticien se retrouve à recourir à la technique « sandwich » décrite au niveau antérieur (facette palatine et vestibulaire) dans le secteur postérieur. Les prémolaires sont reconstruites par addition d’une facette vestibulaire et d’un inlay occlusal afin de restituer le volume initial de la dent. Ainsi, le gain biologique est très sensible, notamment dans la région proximale et palatine (19).
Lorsque la sévérité des lésions est plus importante, on procède à des pièces plus enveloppantes reposant toujours sur l’anatomie proximale existante, mais où la face occlusale et vestibulaire ne font plus qu’une pièce unique au lieu d’un sandwich (fig. 18).
Les 3 types de tables tops :
– table top intracuspidien,
– table top cuspidien,
– table top occluso-vestibulaire : veneerlay.
Aspects biomécaniques : étude in vitro comparative entre les tables tops et les overlays
Une pré-étude in vitro récente portant sur la biomécanique des restaurations partielles collées postérieures, plus particulièrement sur la résistance à la fracture a été menée au sein de la faculté d’odontologie de Marseille (18) (fig. 19 et 20).
L’objectif de cette étude est de comparer la résistance mécanique de 2 types de design cavitaire au niveau des molaires et prémolaires maxillaires et mandibulaires afin de mieux comprendre l’intérêt biologique et mécanique que représente la préservation des crêtes proximales. Les enseignements que l’on peut tirer de cette étude sont les suivants.
Le recours à des restaurations de type table top ne fragilise pas la dent bien au contraire, au regard des résultats obtenus.
On peut donc légitimement penser qu’à solidité égale nous disposons avec les tables tops d’une option beaucoup moins délabrante (fig. 21).
Le choix du matériau n’a pas d’impact sur la résistance à la fracture des dents restaurées. Il n’existe en effet pas de différence significative entre les dents restaurées en emax et avec le LAVA ultimate Ceci confirme les résultats du travail de Magne en 2012 avec un intérêt majeur des restaurations ultrafines à base de nanocéramique ou disilicate de lithium dans les régions fonctionnelles pour les traitements de l’usure (21).
Fabrication des restaurations
Les restaurations sont réalisées, dans le cas présenté, en disilicate de lithium (emax CAD Ivoclar Vivadent) en raison de leur aptitude au collage, de leur pouvoir mimétique et de leur simplicité de mise en oeuvre (fig. 22, 23 et 24). Il faut noter que la nature du matériau à adopter pour restaurer une arcade dépendra de l’arcade antagoniste : on utilisera du composite ou des nanocéramiques (Lava Ultimate 3M ESPE) si on se trouve face à de l’émail naturel (leurs coefficients d’usure étant proches) et de la céramique si l’on se trouve face à de la céramique.
Mise en place des restaurations
Le collage des restaurations représente la pierre angulaire de la pérennité des restaurations, mais demeure aussi la bête noire de nombreux praticiens inquiets suite à des échecs antérieurs (technique de collage, champ opératoire, choix de l’adhésif, choix de la pâte de collage, décollement, sensibilités postopératoires…) (fig. 25 à 30).
Conclusion
Le praticien fait face aujourd’hui à la difficulté d’oublier les règles strictes des préparations pour prothèse conjointe pour rentrer dans un nouveau monde, celui du collage, où la préservation tissulaire devient le coeur de nos préoccupations (21).
Le traitement de l’usure chez des patients de plus en plus jeunes représente un challenge important à relever pour le praticien. En raison des limites toujours repoussées par les performances atteintes par les matériaux actuels, il devient possible de réhabiliter les patients avec un coût biologique très faible. Cette équation délicate entre biologie, esthétique et fonction peut être posée. Ce type d’approche minimaliste a pour but d’aller dans le sens d’une simplification des procédures pour le praticien et de lui offrir un cadre de travail précis afin de rendre ce type de prise en charge reproductible et prévisible.
Remerciements
L’auteur souhaite remercier et associer Hilal Kuday pour son talent et sa passion dans l’art du laboratoire ainsi que le Groupe Style Italiano pour sa volonté de simplification et de démocratisation des restaurations collées par techniques indirectes.
G. MAILLE, G. LABORDE, M. DODDS, A. DEVICTOR, A. SETTE, P. MARGOSSIAN, M. LAURENT
Stratégie prothétique mai-juin 2014 vol 14, n° 3
Quels sont les nouveaux enseignements sur la prise de décision thérapeutique ? Comment les adapter dans le domaine de la prothèse fixée ?
Dans le cadre de la réforme des études en Odontologie, de nouveaux enseignements à propos de « la prise de décision thérapeutique » sont à mettre en place pour les étudiants de O4 (O4 = quatrième année des études odontologiques). Le but de cet article est de proposer une nouvelle forme d’enseignement pour répondre à cette exigence que nous mettons en place à l’UFR de Marseille.
LA PÉDAGOGIE CLINIQUE DANS LES ÉTUDES DE SANTE
La pédagogie utilise des approches d’enseignement et/ou d’apprentissage, diverses et variées. Chaque domaine d’enseignement possède une spécificité et un savoir-faire basé sur des outils pédagogiques privilégiés, sélectionnés et très usités, par exemple :
– Travaux Pratiques (TP), Travaux Dirigés (TD) et Cours Magistraux (CM) dans l’enseignement traditionnel;
– Apprentissages par Problèmes (APR) ou par projet (APP) dans un enseignement plus moderne.
Dans le domaine de la santé, après les gammes de l’apprentissage (TP, TD, CM) la pédagogie clinique est faite avec la prise en charge progressive de patients, des protocoles de soins, et une aide à la thérapeutique souvent construite autour d’arbres décisionnels.
Pourtant, cette forme de pédagogie paraît insuffisante, au vu du petit nombre de patients pris en charge et au manque de démonstrations et d’illustrations cliniques. Mieux qu’un arbre décisionnel, la simulation de situations cliniques par des schématisations et des images cliniques est une aide visuelle précieuse à l’apprentissage de la décision thérapeutique. Il s’agit de présenter une situation clinique idéale et de la comparer à diverses autres problématiques impliquant de nombreux protocoles cliniques pour amener l’apprenant à proposer la solution thérapeutique avec le meilleur rapport bénéfice/coût/sécurité, ou le caractère le moins invasif sur le plan thérapeutique.
PROPOSITION D’UNE NOUVELLE FORME D’ENSEIGNEMENT D’AIDE A LA DECISION THÉRAPEUTIQUE POUR LA PÉDAGOGIE CLINIQUE
Pour illustrer notre propos, nous avons choisi une problématique clinique dont les solutions sont multidisciplinaires et nécessite la prise en compte du rapport du coût/ bénéfice/risque et la connaissance parfaite de divers protocoles cliniques. Il s’agit de trouver une solution clinique appropriée dans le but de rétablir une harmonie plaisante autour d’une incisive centrale maxillaire selon une alternative :
• soit l’incisive centrale maxillaire présente des proportions agréables mais son contexte environnant n’est pas harmonieux (fig. 1),
• soit le contexte environnant et les proportions dentaires agréables sont à corriger afin d’obtenir une harmonie plaisante dans le sourire (fig. 2).
• Le cas n° 0 illustre la situation de référence où l’incisive centrale possède des proportions dentaires respectées et agréables. Son bord libre est dans une position adéquate avec une exposition harmonieuse, du repos au sourire forcé.
• Le cas n° 1 correspond à une sous-exposition du bord libre de l’incisive centrale en position de repos de la lèvre supérieure. La correction du défaut esthétique est solutionnée par une égression orthodontique avec une force douce et continue qui entraîne la dent et le parodonte en position coronaire.
• Le cas n° 2 correspond à une surexposition du bord libre de l’incisive centrale. La correction du défaut esthétique est solutionnée par une ingression orthodontique qui entraîne la dent et le parodonte en position apicale. Le fait de déterminer la position idéale du bord libre grâce à la dynamique des lèvres, du repos au sourire forcé, permet de choisir le moyen le plus adapté pour y parvenir. Le recours à une thérapeutique prothétique n’a pas lieu d’être, sauf si un délabrement coronaire important ne peut être restauré durablement.
Ce type de problématique devient plus complexe dans un contexte où les dents sont courtes pour des raisons diverses (perte de substance dentaire, fracture, attrition, abrasion, bruxisme, éruption passive incomplète, etc.).
Suite à la planification du projet thérapeutique à partir de la situation de référence du bord libre de l’incisive centrale (cas n° 0, fig. 2) le choix des thérapeutiques est considérablement facilité pour les situations à corriger.
• Cas n°1’ le bord libre n’est pas visible au repos mais le contour osseux et gingival vestibulaire est bien positionné. Le choix thérapeutique présente une alternative restauratrice :
• la réalisation d’une Restauration Adhésive Céramique (RAC) partielle est envisagée en l’absence d’autre délabrement,
• la réalisation d’une Restauration Céramo-Céramique périphérique (RCC) est envisagée pour un délabrement très important. La dépulpation de la dent devient nécessaire.
• Cas n°2’ : le bord libre est bien positionné, la couronne clinique est trop courte et l’exposition gingivale trop importante. Le choix thérapeutique présente aussi une alternative pour augmenter la hauteur de la couronne clinique :
• la dent est ingressée par orthodontie pour repositionner le contour osseux et gingival dans la situation de référence cas n° 1’. La restauration de la dent répond à l’alternative prothétique du cas n° 1’,
• une élongation coronaire chirurgicale corrige par soustraction le niveau osseux pour repositionner le contour osseux et gingival dans la situation du cas n° 1’. Du point de vue prothétique, le diamètre de pilier est plus réduit et le rapport couronne racine plus défavorable. Le choix thérapeutique est représenté par l’alternative restauratrice du cas n° 1’.
Cependant, il entraine une résection osseuse chirurgicale avec ses difficultés dans le secteur antérieur et une préparation dentaire périphérique très mutilante. Une RAC est contre-indiquée, seule une RCC ou une Restauration Céramo-Métalique sont autorisées.
• Cas n° 3’ : le bord libre n’est pas visible et la dent est en infraposition. Cette situation nécessite une égression orthodontique accompagnée du parodonte afin de repositionner le contour osseux et gingival dans la situation du cas n° 1’. La restauration de la dent répond à l’alternative prothétique du cas n° 1’.
• Cas n° 4’ : le bord libre est trop visible, le collet trop coronaire avec surexposition dans le sourire. Un repositionnement apical de la dent accompagné du parodonte marginal et la correction de la surexposition du bord libre sont nécessaires. Le repositionnement du parodonte marginal répond à l’alternative orthodontique ou chirurgicale du cas n° 2’. L’exposition souhaitée du bord libre est résolue par l’alternative prothétique du cas n° 1’.
CONCLUSION
Cette nouvelle approche pédagogique clinique doit être développée. Sa mise en place est prometteuse et très appréciée au travers des nouveaux enseignements en travaux dirigés obligatoires dispensés en O4 sur la « prise de décision thérapeutique »
Le Dr Patrice Margossian, Chirurgien dentiste installé à Marseille, est spécialisé en Implantologie dentaire, greffes osseuses, greffes sinusiennes et greffes gingivalesM. DODDS, G. LABORDE, A. DEVICTOR, G. MAILLE, A. SETTE, P. MARGOSSIAN
Stratégie prothétique mai-juin 2014 vol 14, n° 3
Quel est le rôle du sourire dans le traitement restaurateur du secteur antérieur maxillaire ? Quelles réformes esthétiques utiliser dans le diagnostic ? Quelles clés décisionnelles utiliser dans le traitement ?
Les supports de l’information, accessibles au plus grand nombre, accordent aujourd’hui une importance toujours plus grande à l’esthétique du corps, du visage ou du sourire.
L’esthétique s’affiche, l’esthétique se vend et fait vendre. Elle n’en reste pas moins une notion subjective et propre à chacun. La demande des patients est souvent motivée par un problème esthétique. La meilleure réponse thérapeutique est un résultat remplissant trois aspects, le fonctionnel, l’esthétique, la pérennité.
De nombreuses « check-lists » esthétiques ont été proposées dans la littérature odontologique.
Cet article a trois objectifs :
1. la mise en valeur de la « check-list » esthétique qui possède la plus grande pertinence clinique ;
2. la proposition d’une approche clinique moderne avec ses outils décisionnels et thérapeutiques qui permettent d’atteindre les objectifs que doit avoir toute reconstruction antérieure, sectorielle ou plus étendue.
3. La nécessité de corriger la « chronologique » des critères de reconstruction occluso-architecturaux proposés dans la littérature (1) afin de mettre en valeur le rôle de l’incisive centrale maxillaire en tant que référence diagnostique et thérapeutique.
LA PERTINENCE DU DIAGNOSTIC
Rôle du sourire dans l’esthétique
L’impression première que l‘on a d’un individu est souvent basée sur ce que l’on perçoit de son visage. Le regard et le sourire constituent les deux pôles attractifs du visage. En effet, lors d’une relation sociale, ils focalisent toute notre attention et communiquent tous les types d’émotions, verbales et non verbales, d’un individu.
En odontologie, le sourire et le rire représentent la première exposition de l’esthétique
dentaire dans le cadre labial. Notre objectif, dans la réalisation d’une restauration dentaire esthétique, est d’améliorer, voire de mimer, l’apparition et l’illusion du naturel dentaire mis en scène par le sourire.
Esthétique faciale
Dans un visage séduisant, la Ligne Bipupillaire (LB) représente la référence esthétique horizontale du visage (2) dans 88,4 % des cas (3). Seulement 11,6 % des visages montrent une asymétrie verticale (3). Le Plan Sagittal Médian ou la Médiane de LB représente l’axe de symétrie et forme avec la référence horizontale un « T » dont le centrage et la perpendicularité favorisent grandement la perception de l’harmonie du visage (4). Dans le plan sagittal, le dessin des lèvres, supérieures et inférieures, est un élément d’appréciation du profil qui doit servir de guide à la situation des dents (5, 6).
Esthétique du sourire
La ligne du sourire
Dans le but essentiel d’étudier la composante gingivale, Liébart et collaborateurs (7) ont étudié la visibilité du parodonte en fonction de la position de la ligne du sourire au cours d’un sourire naturel et d’un sourire forcé et ont élaboré une classification (Tableau 1, fig. 1) (7).
Les critères d’un sourire idéal
Pour Garber et Salama, le sourire est le résultat d’une relation étroite entre 3 entités, à savoir, les DENTS, le cadre des LÈVRES et la GENCIVE (8).
Néanmoins et de façon historique, les critères référencés comme fondamentaux pour l’esthétique du sourire ont toujours été massivement d’ordre purement dentaire. Carnevale écrit pourtant en 2008 : « Si le parodonte disparaît, l’esthétique également », soulignant le rôle capital joué par l’environnement gingival dans ce domaine (9). De plus en plus, la dimension gingivale s’installe dans les anciens dogmes de l’esthétique à tel point que certaines « check-lists esthétiques », largement utilisées par les praticiens lors du diagnostic préprothétique, se sont vues récemment corrigées pour mettre en avant l’importance capitale du parodonte dans l’appréciation du sourire. On assiste à « la révolution rose ».
Ainsi Magne, en actualisant la « checklist » de Belser (10), démontre que l’esthétique dentaire et l’esthétique gingivale agissent ensemble pour donner au sourire son harmonie et son équilibre. Un défaut dans les tissus environnants ne peut pas être compensé par la qualité des prothèses dentaires et vice versa.
Pour cet auteur, la santé de la gencive et sa morphologie font partie des premiers
paramètres à évaluer.
D’ailleurs, parmi les 5 premiers critères de la « check-list » proposée, 4 font directement référence à l’esthétique de la gencive. Nous avons choisi de développer
cette check-list.
Magne reprend les 14 critères fondamentaux proposés par Belser en 1982 et les ordonne de la façon suivante par ordre d’influence sur le résultat esthétique (11) (fig. 2) :
1. La santé gingivale : une gencive libre rosée et mate ; une gencive attachée texturée souvent avec un aspect « peau d’orange » et couleur corail rosé et une muqueuse alvéolaire mobile et rouge foncé (12).
2. La fermeture de l’embrasure gingivale avec la présence de papilles interdentaires.
3. Les axes dentaires : inclinés de distal en mésial dans le sens apico-incisal, ils s’accentuent en vue frontale, des incisives centrales vers les canines (fig. 3).
4. Le zénith du contour gingival : il est en général décalé en distal par rapport au milieu de la dent. Les préparations prothétiques (pour facettes ou couronnes) veilleront à respecter ce dessin de la gencive (fig. 4).
5. L’équilibre des festons gingivaux : ceux des incisives centrales doivent être très symétriques, car ils sont voisins de l’axe de symétrie vertical de la composition dento-gingivale (4).
Les festons gingivaux des canines sont au même niveau ou plus apicaux que ceux des incisives centrales (4).
Selon Rufenacht le feston gingival des incisives latérales est légèrement plus coronaire que celui des incisives centrales et des canines (défini idéalement comme niveau gingival de Classe 1) (13) (fig. 5).
6. Le niveau des contacts interdentaires : de par les axes et l’anatomie dentaire, le point de contact mésial est plus coronaire que le point de contact distal à partir de l’incisive centrale et ceci jusqu’à la deuxième molaire.
7. Les dimensions relatives des dents : il est difficile d’invoquer des « nombres magiques » issus des principes mathématiques comme le « nombre d’or (1,618) » de Lombardi (14) ou le « pourcentage d’or » de Snow (15) pour déterminer les diamètres mésio-distaux soi-disant idéaux des incisives et canines maxillaires. Ces règles conduisent à une étroitesse excessive de l’arcade maxillaire et à la « compression » des secteurs latéraux comme le suggèrent les mesures de Preston (16). Les résultats de Sterret et coll (17) conduisent à l’énoncé des moyennes suivantes pour les dents antérieures maxillaires :
• la largeur moyenne d’une incisive centrale est de 8,3 à 9,3 mm tandis que sa longueur moyenne varie de 10,4 à 11,2 mm,
• les rapports largeur/longueur coronaires des incisives et canines sont identiques (17),
• les incisives centrales sont plus larges de 2 à 3 mm que les latérales et de 1 à 1,5 mm que les canines (17), les canines sont plus larges de 1 à 1,5 mm que les incisives latérales (17). Classiquement, de nombreux auteurs concluent qu’un rapport largeur/longueur entre 75 et 80 % pour l’incisive centrale est idéal (4), mais attention l’idéal et les proportions sont des outils, pas des objectifs.
8. Les éléments de base de la forme dentaire : les incisives présentent :
• une face mésiale plate (l’angle méso incisif est plus arrondi pour les latérales) ;
• une face distale convexe et un angle disto-incisif arrondi ;
• le bord libre est quant à lui soumis à l’usure fonctionnelle et s’aplatit avec le vieillissement.
Trois types de formes d’incisives centrales ont ainsi été répertoriés : carrée ou rectangulaire, triangulaire et ovoïde (18) (fig. 6).
Les incisives latérales sont essentiellement différentes des centrales par leur taille bien que ce soit la dent où l’on observe le plus de variabilité morphologique (19).
Quant à la canine, son anatomie se résume à une série de courbes ou d’arcs : une face mésiale convexe avec un angle de transition très développé formant un petit lobe ; une face distale plate et une pointe cuspidienne proéminente alignée sur le centre de la racine.
9. La caractérisation de la dent : elle concerne les colorations intenses (taches, fissures, fêlures, lobes dentinaires…) et les détails morphologiques (macro et micromorphologie des surfaces, attrition, abrasion…) (11).
10. Les états de surface : ils influencent directement les effets optiques en réflexion absorption et transmission de la lumière. Chez un jeune patient, l’état de surface est marqué et favorise alors une réflexion accrue de la lumière faisant apparaître les dents plus claires. Avec l’âge, il devient plus lisse et par conséquent les dents « s’assombrissent » (11).
11. La couleur : elle est trop souvent considérée comme l’élément majeur de la réussite esthétique d’une restauration, pourtant une petite erreur de couleur peut passer inaperçue si les autres critères sont respectés (forme et luminosité) (11).
12. La configuration des bords incisifs : les dentures âgées présentent des incisives aux bords rectilignes et usés au contraire des bords incisifs des dents jeunes qui dessinent une ligne convexe, dite positive.
Des incisives plaisantes doivent de plus présenter un bord fin et délicat (11). Les embrasures incisives ont une grande influence sur la définition de ce que l’on appelle l’espace négatif représenté par l’arrière-plan entre les dents maxillaires et mandibulaires lors du rire ou lorsque la bouche est entrouverte. Les angles interincisifs s’ouvrent et deviennent plus obtus, de l’incisive centrale aux prémolaires (fig. 7).
13. La ligne de la lèvre inférieure : la coïncidence des bords incisifs avec la lèvre inférieure est essentielle à un sourire gracieux. Ainsi, des contacts proximaux et des bords libres bien agencés, forment avec la lèvre inférieure des lignes parallèles, révélatrices d’une situation harmonieuse (14, 19) (fig. 8). La ligne incisive est visible chez la plupart des individus, environ 85 % pour Tjan et all (20) et 75 % d’après Owens (21).
14. La symétrie du sourire : elle sousentend une situation et une élévation équivalente des commissures labiales dans le plan vertical, et une analogie à la ligne bipupillaire. Il existe toujours des variations entre les deux côtés du visage et il serait contraire à la nature de croire que l’absolue symétrie est toujours nécessaire (13).
L’harmonie globale du résultat final reste cependant subjective et dépend de l’intégration de ces paramètres avec le sourire du patient, la forme du visage, l’âge et le caractère.
À ces critères objectifs s’ajoutent donc des notions subjectives, mais non moins déterminantes, qui peuvent influencer une perception harmonieuse du sourire hors des règles citées.
Ces diversités restent plaisantes pour des petites variations de forme, de hauteur coronaire, et d’agencement dentaire et gingival (11).
Les clés décisionnelles du traitement
Il est intéressant de constater que cette check-list esthétique est à vocation diagnostique. Elle peut être divisée en trois parties distinctes :
1- Les critères 1 à 5 sont responsables de l’harmonie de la composition gingivale
2- Les critères 6 à 12 sont responsables de l’harmonie de la composition dentaire
3- Les critères 13 à 14 déterminent l’harmonie du sourire.
Ainsi, chacune des parties participe à l’harmonie de l’ensemble, le sourire. Deux clés thérapeutiques sont essentielles au rétablissement d’un sourire plaisant lors
de la réhabilitation esthétique :
La première clé est la détermination de la position du bord libre de l’incisive maxillaire pendant les différentes positions de la lèvre inférieure, du repos jusqu’au rire forcé et lors de l’élocution.
Effectivement, la similitude de courbure de la ligne incisive avec la lèvre inférieure pendant la dynamique labiale du sourire sous-entend une position idéale du bord libre de l’incisive centrale. Le rire forcé limite l’exposition des dents maxillaires en vue frontale. La prononciation du « F » et du « V » précise sa position vestibulopalatine et le « S » définit la dimension verticale phonétique (22).
Il est impératif de comprendre que la position du bord incisif de l’incisive centrale maxillaire est le point de départ de nos restaurations en secteur esthétique. Elle doit guider notre choix, les objectifs étant de rétablir l’exposition des dents maxillaires par les lèvres au repos (de 1 à 5 mm selon l’âge et le sexe) et de rétablir une similitude de la courbure incisive et de la lèvre inférieure pendant la dynamique labiale du sourire (5).
À partir de ce bord libre repositionné, nous pouvons définir les différentes thérapeutiques nécessaires au traitement (23,24) en reprenant les critères de Magne et Belser précédemment décrits (11) (fig. 9).
La deuxième clé de la décision est le respect du rapport anatomique de proportions (largeur/longueur) de la couronne dentaire de l’incisive centrale maxillaire, puis des proportions des dents entre elles en vue frontale (fig. 9). De cette façon, le rétablissement d’un contour gingival harmonieux devient possible (3, 23). En effet, la dimension des dents et leur agencement dans le sourire doivent être déterminés précocement dans le plan de traitement ; il est souvent nécessaire de recouvrer l’harmonie du rose (la gencive) avant de pouvoir rétablir l’esthétique du blanc (les dents). Ces corrections font appel aux techniques parodontales et/ ou orthodontiques (23), parfois orthodontiques et chirurgicales si la correction dépend des bases osseuses.
Dans le domaine prothétique, c’est suite à la correction et la maturation des contours gingivaux, que les modifications morphologiques des dents pourront être faites afin de rétablir l’harmonie dento-gingivale du sourire au sein du visage.
Prise à rebours, la check-list esthétique proposée par Magne devient donc un guide “chrono-logique” à la décision et à la planification thérapeutique (23).
Conclusion
Les références dites esthétiques sont multiples et très souvent contextuelles, celles décrites ici sont évidemment occidentales et ne seraient pas tout à fait les mêmes en Orient.
Parmi toutes ces références, celles du visage, la ligne bi-pupillaire et sa médiane sont indispensables au diagnostic et au traitement des problèmes esthétiques (3) pour 88 % des cas.
Néanmoins, elles sont d’une grande aide afin de planifier nos reconstructions prothétiques. Pour cela, encore faut-il leur attribuer une hiérarchisation afin de les optimiser, et d’organiser notre projet thérapeutique.
Dans la restauration ou la reconstruction de l’esthétique, la situation du bord libre de l’incisive centrale maxillaire représente la première clé de la décision thérapeutique multidisciplinaire (fig. 9). La situation de ce bord libre devient « le déterminant esthétique du déterminant antérieur de l’occlusion (guide antérieur) (24) et finalement aussi de la fonction.
En 2001, un concept d’aide au plan de traitement en prothèse, l’OCTA propose huit critères de reconstruction occlusoarchitecturaux (1). Leur ordre chronologique doit être modifié pour remettre en valeur l’importance diagnostique et thérapeutique de l’incisive centrale maxillaire (article à paraître).
La deuxième clé de la décision est le respect du rapport anatomique de proportions (largeur/longueur) de la couronne dentaire de l’incisive centrale maxillaire, puis des proportions relatives des dents en vue frontale (fig. 9). À partir du bord libre corrigé, les proportions dentaires prévisualisent l’esthétique du blanc. Elles dirigent les corrections thérapeutiques éventuelles du rose avant la finalisation prothétique des dents.
Grâce à cette approche décisionnelle, l’esthétique dento-gingivale pourra être ainsi sublimée dans le sourire au sein du visage, sans pour autant se soustraire aux autres impératifs historiques de la prothèse : fonction, biologie et pérennité. Une fois la santé et l’esthétique gingivale retrouvées ou vérifiées, le point de départ de nos reconstructions est la position du bord libre de l’incisive centrale maxillaire.
Grâce à cette approche décisionnelle, l’esthétique dento-gingivale pourra être ainsi sublimée dans le cadre dento-labial au sein du visage, sans pour autant se soustraire aux impératifs historiques de la prothèse : fonction, biologie et pérennité.